|
Notes de lecture 2004
et A présent de Brigitte Giraud, Stock :
(08/12/2004)
" Chanson de la neige silencieuse " d’Hubert Selby Jr,
Editions de l’Olivier :
Je voulais lire au départ Last Exit to Brooklyn. Mais ce n’est que partie
remise, j’approche donc Hubert Selby Jr par un recueil de nouvelles Chanson de la
neige silencieuse. Ce qui me plaît, c’est la déclaration d’intention de la
quatrième de couverture, reprise de la biographie Selby to Brooklyn. " Bien
sûr que je suis contenu dans mon œuvre, mais je n’ai pas le droit de
m’interposer entre elle et le lecteur. L’ego doit s’effacer, ce qui veut
dire que vous êtes très très vulnérable. ". Ce recueil de nouvelles
fait évidemment penser à Raymond Carver, mais quel recueil de nouvelles d’outre
atlantique ne ferait-il pas penser à ce nouvelliste ? Ce qui en est
approchant : les thèmes du quotidien, la virée entre copains qui tourne à
l’aigre, toute cette incommunicabilité entre les êtres, amis, famille qui semble
être un thème récurrent pour l’Amérique telle qu’on se l’imagine
volontiers coincée. Pas tant que cela car elle a su consacrer Hubert Selby Jr comme chef
de file de la littérature trash. Faut-il pour autant penser à trouver provocations et
violence dans ces nouvelles ? Non, tout comme pour Nathalie Sarraute, le quotidien
glisse imperceptiblement dans l’indicible férocité humaine, mais, comme pour
Carver, avec compréhension, tendresse presque pour les caractères complexes des
individus. Ainsi Hubert Selby Jr rejoint-il ma connaissance américaine au côté de
Faulkner, Carver, mais aussi du peintre Hopper ou encore du cinéaste Michael Moore :
un panorama de la complexité de l’intimité au cœur d’une des sociétés
les plus développées.
(24/11/2004)
"Cours de Linguistique Générale", Ferdinand de
Saussure, Payot :
Après bien des péripéties (voir Saussure, côté gauche en Etonnements) je peux enfin
me plonger dans Saussure, côté droit, aussi bien au sens de tendu, d’aplomb,
rectiligne, direct et abrupt que droit comme légal, la loi, la référence. Et
référence, il y a en la matière tant on peut considérer que ce CLG est le point de
départ de la linguistique moderne. Linguistique moderne qui commence au début du siècle
comme un véritable roman puisque Saussure, né en 1857 (en Suisse comme Frédéric
Sausser, alias Blaise Cendrars), enseigne cette discipline à Genève et ce sont ses cours
entre 1907 et 1911 qui furent repris par deux professeurs après sa disparition en 1913.
Ainsi paru le CLG en 1916.
J’imagine que depuis, les remous universitaires n’ont eu de cesse de destituer,
déboulonner le buste de Saussure, avant de le réhabiliter. Je ne sais pas où en sont
ces querellettes de clochemerles et cela ne m’intéresse pas, juste la découverte de
ce CLG m’attire. Et il faut dire que Saussure me va comme un gant. Le père des
signes, signifiant, signifié et autres fariboles n’a eu de cesse de ne jamais tomber
dans la tentation de prendre parti, de l’enfermement dans une théorie ou une autre
et on se doute de la difficulté que cela représente quand on essaie de définir un
machin aussi impliqué dans notre être, histoire, passé, présent, futur, étendue,
comparativité et règlemenationalité que ce qui touche à la langue, aux langues, aux
langages. Il n’est forcément pas facile de prendre de la hauteur par rapport à un
objet d’étude qui adhère à nos semelles comme un chewing gum. Saussure l’a
fait, qu'il en soit remercié. Et il l’a fait de façon nerveuse, on aurait pu
craindre une certaine mollesse dans le refus de prendre parti, non, c’est une
ouverture au monde alerte et sémillante qu’il nous propose, image pleine de bons
sens de Saussure maîtrisant les boucles de ses lacets de montagne suisse et pour qui le
linguiste " ressemble à l’observateur en mouvement qui va d’une
extrémité à l’autre du Jura pour noter les déplacements de la
perspective. ".
(17/11/2004)
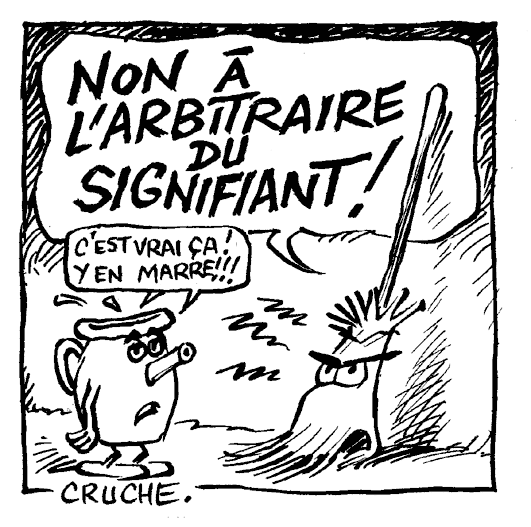
"La journée d’Alexandre Hollan", d’Yves Bonnefoy, Editions
Le temps qu’il fait
Lors de la fabuleuse et hétéroclite exposition du collectionneur Jean Planque (Notes
d’écriture et de lecture du 11/06/2003), j’étais tombé en admiration devant
une nature morte, ou plutôt une vie silencieuse d’Alexandre Hollan. Ayant appris
qu’Yves Bonnefoy lui avait consacré un livre, j’espérais secrètement que le
point de vue d’un poète sur cette œuvre viserait à explorer le cheminement
créatif du peintre. Aujourd’hui en possession de cette biographie, je ne suis
aucunement déçu. Tout d’abord la qualité du livre et des reproductions est très
belle, mais c’est surtout la qualité, la simplicité du texte d’Yves Bonnefoy
mais qui ne cède en aucune manière à la réduction de l’œuvre, qui est
admirable. Ce que j’espérais est là : une journée d’Alexandre Hollan ou
plutôt, ce moment, ce jour, cette clarté et cette ouverture dans la créativité du
peintre. Le texte retrace la manière de travailler de Hollan sur ces deux aspects
principaux, le thème de l’arbre, du feuillage, ces tableaux noirs et blancs à la
fois hermétiques aux premiers abords mais qui deviennent sous l’explication du
poète tellement clairs et vivants, reliés à un moment important et anodin de
l’enfance de l’artiste, mais autobiographique et fondateur. La deuxième partie
de ce livre explore la couleur et la lumière qui m’avait alors séduit dans
l’exposition Jean Planque, mais dont la continuité de la recherche semble lumineuse
et complémentaire. Il est évident que je recherchais, mais sans doute tout comme Yves
Bonnefoy, un lien, un passage entre la créativité de l’écriture et celle
d’Alexandre Hollan. C’est ce que je m’efforce de traduire dans une note
d’écriture complémentaire cette semaine.
(03/11/2004)

Alexandre Hollan, vie silencieuse
Paysage ouvrier, collectif, L'Entre-Tenir
C’est un gros pavé de plus de cinq cent pages et ce n’est sans doute pas assez
pour retracer le travail accompli par l’association L'Entre-Tenir sur le monde ouvrier de Saint-Dizier.
Sujet de choix, comme s’attaquer à une montagne, centaines d’années, combien
de générations accumulées pour construire ce qui est devenu, oui, un paysage.
C’est un roman, avec des chapitres en gros marqués, c’est un travail presque
scolaire, didactique avec des titres ô combien simples mais qui incitent au regard :
observons un lycée, un quartier, un village une fonderie, même un piquet de grève,
inventaire à la Perec mais principalement tout ce qui vit, coule comme le métal en
fusion, l’insaisissable et pourtant l’ossature même de la vie ici : un
paysage.
C’est beau, les photos sont belles, poignantes, des visages, c’est généreux,
on reconnaît des parents, des voisines, des familiers. On y retrouve avec plaisir les
très beaux textes d’Yvon Regin que j’ai eu le bonheur de connaître avant sa
disparition en 2001. Disparition : certaines parties et images n’en sont que
plus précieuses, comme l’usine de couture Devanlay qui a fini par s’arrêter,
on a déjà oublié ses collègues, comment s’était avant.
Un avant qui date d’à peine un an car tout ce travail a été entrepris en 2003 et
2004 par l’équipe de L'Entre-Tenir.
C’est un immense travail auquel il faut rendre hommage. C’est sans doute une des
plus novatrices manières de bâtir un roman dans la frénésie qui anime la vie
économique ou le paysage justement se modèle. Il est impossible de le lire d’un
coup, l’émotion paraît toujours concentrée entre les bribes des
conversations, témoignages, images qui parlent tant.
Alors que reste t’il quand on essaie de tamiser les mots qui nous ont
accompagnés ? C’est une phrase de l’épilogue, clairement indiquée
comme dans tout roman. Il reste de très belles phrases sur le fuyant paysage : il
y a celles (les ouvrières) qui ne se conjugent qu’au passé, par exemple, ou
encore, dans les pores de la peau et on repense aux visages qui accompagnent la
lecture. Enfin, comme dans tout roman (et celui ci, réaliste, n’a rien a envier à
Zola, on a guère avancé depuis…), il faut une chute finale, ce sera pour
l’avenir l’expression terrible : dos au mur.
"Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez : toujours plein du Nombre et
de l'Harmonie, ces poèmes seront fait pour rester"
Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854.
(27/10/2004)
Moisson de livre au profit d’Amnesty, Saint Dizier, Lire en Fête
2004 :
Comme chaque année, Lire en Fête propose, entre autres, une foire aux livres au profit
d’Amnesty dont la régularité des organisateurs force l’admiration. Pour cette
édition 2004, me suis procuré (juste ma part, c’est sans compter les livres du
reste de la famille) : déjà lus en entier mais pas possédés : Miette
de Pierre Bergounioux, Les éparges de Maurice Genevoix ; déjà entendus,
découvert partiellement, où ne me souviens plus : Gens de Dublin de James
Joyce, Salammbô de Flaubert, Un barrage contre le pacifique, de Duras, Lumière
d’Août de Faulkner ; à découvrir : Mes amis de Bove, Les
Tarahumaras d’Antonin Arthaud, Lucienne et le boucher, La tête des
autres de Marcel Aymé, Les diaboliques de Barbey d’Aurevilly, Le
mauvais temps de Paul Guimard, Un autre d’Imre Kertesz et L’Arbre
du prince de Torgny Lindgren.
Mais Lire en fête c’est aussi voir le travail opiniâtre réalisé par
l’association L’entre-tenir, et avoir
acquis le très beau Paysage ouvrier, résultat de l’immense travail réalisé
sur ce thème en 2003, 2004, avoir revu avec plaisir Michel Séonnet et savoir qu’on va
se retrouver bientôt en Franche Comté dans le cadre de l’édition 2004 des
" Petites fugues ". En attendant, les livres sont dans des cartons, le
bureau ressemble à un campement (voir en Webcam)
(20/10/2004)
- "Carte Muette", de Philippe Vasset, Fayard :
Etrange roman que celui de Philippe Vasset, où plutôt au sens d’inattendu, peu commun et pourtant…
Une organisation offre un prix à celui ou ceux qui sauront tracer physiquement la cartographie du réseau d’Internet. Mystère de l’organisation, prix pharaonique offert pour un réseau virtuel, quel sujet !
Et pourtant…
Pourtant le sujet va plus loin et c’est ce qui fait la force de Philippe Vasset. Véritable tentative d’épuisement du lieu d’Internet, ce roman ravira les plus perecquien des lecteurs. D’ailleurs, il y a quelques références à Espèce d’Espace, que Philippe Vasset pour son deuxième roman, en spécialiste de géographie et de philosophie ne pouvait passer sous silence.
Quel sujet et pourtant, quel sujet difficile !
L’écueil était de le contourner, tourner autour, l’aborder avec la prudence d’un navigateur échaudé sur mer calme. Ce qui se serait traduit par une dérive vers la facilité de l’intrigue, les à-côtés, l’attrait de l’histoire à raconter, le risque de l’écueil, l’échouage. Non, Philippe Vasset, en véritable Ulysse, par ailleurs premier héros de la littérature, ne fait rien de tout cela : il empoigne à bras le corps les câbles sous-marins, les faisceaux hertziens, les répéteurs, toute une technologie ardue et inévitable, belle et difficile à décrire mais qui le place au cœur justement de son sujet. Quoi de plus naturel qu’il cite ainsi en épigraphe Julien Gracq, au tempérament tout aussi entier. La navigation sur le web (et jamais un mot n’a si bien été porté) se révèle sous nos yeux, sans fioriture, ni concession, simplement décrite dans sa réalité physique et belle : les câbles coulés au fond des cuves, leur tracés noirs intersectant les courbes reflétées des courbes…/…les serveurs hérissés de connexions comme des impacts rayonnant d’éclats. Cette quête est rédigée dans le style des e-mails, rien ne vous sera épargné, les copier/coller, les messages envoyés, reçus, les réflexions du narrateur (les typographies adoptées pour les différencier par l’éditeur auraient pu être mieux choisies). Mais tout se met finalement en place dans ce bref récit : la cartographie se révèle sous nos yeux pour aboutir à une fin magnifique dans un lyrisme inattendu et splendide : oui que s’écrivent devant nous autant de certificats du décès du superbe anonymat de l’espace, devenu une étendue omnisciente, lieu d’inscription d’une mémoire absolue. - Il y avait une carte d’Internet à inventer, c’est fait et c’est un livre
qui le raconte...
Que Philippe Vasset, en Copernic moderne en soit remercié… et qu’il continue à produire d’aussi étranges et beaux romans…
(13/10/2004)
Lectures comparées :
"Fenêtres sur le monde" de Raymond Bozier, Fayard
"Windows in the world" de Frédéric Beigbeder, Grasset
" Je suis en train de lire un bouquin de F.Beigbeder (auteur que je ne
connaissais pas avant) et je trouve ça complètement à ch… : j'ai l'impression
qu'il se force à être drôle alors qu'il ne l'est pas et qu'il raconte des banalités
comme s'il venait de découvrir le sens de la vie.
Est-ce normal ? Est-ce sain ? (que je trouve ça nul) "
- Nico (Forum de discussion sur le Net)
" L’ancien publicitaire s’est aussi plu à prévenir les étudiants
d’ HEC de la vacuité de la société de consommation. Là réside peut-être
l’intemporelle supériorité du roman qui demeure un espace de gratuité et de
liberté. Le roman ne " sert " rien ni personne ; il est une autre réalité et
possède ce quelque chose de génial et inimitable qu’il faut préserver. Inutile
mais indispensable, il a juste "quelque chose de plus que la vie ". C’est
tout, mais c’est assez. "
(CR d'une intervention de F Beigbeder à HEC)
Ces deux appréciations montrent l’étendue et l’impact de F Beigbeder. Son
dernier roman, couronné du Prix Interallié en 2003, Windows in the world
n’échappe pas à la règle : provoc, psychologie à deux balles, généralités
de café du commerce, autosatisfaction (ou auto flagellation permanente, ce qui revient au
même), égocentrisme, mais formules efficaces, publicitaires, construction du roman en
apparence négligée mais solide. Le bouquin refermé laisse un (petit) temps de
réflexion et d’incertitude : faut-il aimer ou non Windows in the world
et forcément son auteur qui associe son ego à chaque page comme une marque de fabrique
de peur qu’on l’oublie, ou plutôt dans la peur que son image construite
s’éloigne un peu trop du mythe. Rassurons le : c’est du pur Beigbeder et
la question même que nous nous posons, faut-il aimer ou pas montre que l’auteur a
bien fait son travail de marketing destiné à lui rapporter de l’argent.
Maintenant, à la question de savoir si ce livre apporte quelque chose à
l’évènement dont il se fait l’écho, l’attentat du 11 septembre,
c’est oui, si on simplifie, si c’est seulement (et c’est déjà pas mal) le
moyen trouvé de retracer les banalités qu’on a tous éprouvées au plan mondial.
Banalités = habitude de la violence, donc par réaction nous restons vigilants à cette
négation de l’homme et le mérite de tous les livres sur le sujet est de garder
allumée la veilleuse. Mais ce livre a aussi sur cet évènement des effets pervers (voir
plus loin).
A la question de savoir si ce livre apporte quelque chose à la littérature, c’est
assurément non.
Il n’apporte rien, c’est un livre bâclé : il ne suffit pas d’écrire
en tête de chaque chapitre les minutes qui ont précédé l’effondrement des tours,
encore faut-il les remplir avec le sujet choisi : l’alternance entre le calvaire
des new-yorkais qui y furent coincés et les affres d’un auteur parisien autour de
Montparnasse. Les redites sont donc forcement nombreuses de celui qui tourne dans son
petit univers doré en répétant New York Paris, même combat. Donner le Prix Interallié
à un livre aussi plat, c’est continuer pérenniser la décrépitation du système
littéraire franchouillard.
Mais il y a plus dangereux en parlant de pérennisation. Ce livre continue à formater les
esprits de la même manière que ceux qui détiennent les pouvoirs. L’entourage
Beigbeder en fait partie, ce n’est pas un hasard si les personnages sont anodinement
cités " Philippe Souviron, le patron de cette filiale, un copain à mon
père " ou des noms à particule (comme beaucoup dans le gouvernement actuel
ou au medef), vieilles familles éternellement échappées de la révolution " avec
mon camarade de java de l’époque Alban de Clermont Tonnerre ".
Rebelle, pourtant, Beigbeder y prétend : Un Riche Rebelle tel qu’il se
définit. Il a même été communiste le temps d’une campagne publicitaire et
d’élections (avec le succès qu’on sait). Il est celui qui dit dans Windows
in the world " La Chine me plaît car c’est le seul pays à la fois
pleinement communiste et capitaliste ". Il est passé maître de cette
rhétorique de retournement, de contre-pied, tirer sur chaque concept et prétendre le
contraire (exemple parmi tant d’autre " Je ne peux m’empêcher de
considérer tous les hommes qui restent avec la même femme plus de trois ans comme des
lâches ou des menteurs ").
Toutefois, cette rhétorique demeure grossière et ne trompe personne. On tourne en rond
entre l’ombre des tours, Beigbeder n’ouvre aucune perspective. Pour enfoncer
cette arrogance, il y ajoute de la vulgarité, du cynisme, les mêmes défauts qui ont
justifié la croisade du monde exploité à se rebeller et à aboutir aux attentats du
11/09. Quadrature du cercle.
Donc, en conclusion, oui, ce livre apporte quelque chose à l’évènement : un
peu plus de haine… L’écrire était inconscient et idiot ou réfléchi et
prémédité.
Julien Gracq dans La littérature à l’estomac (à ne pas confondre avec la
pâle copie de Pierre Jourde la litterature sans estomac dans lequel par ailleurs
était cité Beigbeder - voir note de lecture du 22/05/2002), Julien Gracq donc, évoquait
déjà en 1950 cette difficulté du jugement : " nous sommes entrés
avec elle (la littérature) dans une ère d’instabilité capricieuse…/…
l’actualité dévore sans pitié ses objets : elle peut nous inviter, c’est
le mieux qu’on puisse souhaiter, sinon à une suspension de jugement qui n'est pas
dans l'ordre des choses, du moins à un mimimum de restriction mentale quand nous
prétendons nous prononcer sur la littérature de ce temps autrement que sous l’angle
du fait-divers. "
Formater les esprits, tel n’est certainement pas l’objet du livre de Raymond
Bozier, Fenêtres sur le monde, bien au contraire. Ce titre identique vient de la
même idée, du même lieu new-yorkais. Ce recueil de textes comporte également un
chapitre consacré au 11 septembre, mais là n’est pas l’important. Raymond
Bozier est resté méfiant depuis un autre évènement antérieur, l’explosion de la
navette spatiale et l’idée qu’on puisse en n’importe quel point du
globe voir les mêmes images, ce qu’il imagine préfigurer un assujettissement
au règne des images présélectionnées, dans le risque d’une inimaginable
dictature. La suite lui donne raison : guerre du golfe, onze septembre, autant
d’images imposées, d’émissions en boucle, notre attention forcée. De tels
évènements viennent s’enchâsser dans notre quotidien, que Raymond Bozier restitue
avec une grande pudeur et discrétion car on connaît notre rôle par cœur et la
place qu’y occupent les désastres. Le quotidien, donc, continue et donne
l’occasion à Raymond Bozier de nous gratifier de très beaux textes, comme Hôtel,
7° étage, Paris, 6 décembre 2000, 23h30 où en dépit de l’heure
tardive et du bruit qui va suivre, le voyageur décide malgré tout de lever le rideau et
de chercher en vain, coté périphérique, la vérité du fleuve, l’amont,
l’aval. Car contrairement à l’auteur précédent Raymond Bozier ne se
contente pas d’une introspection égoïste, mais cherche, à la manière d’un
Perec des Espèces d’espaces, des ouvertures sur le monde. Fenêtres sur le
monde, oui, Pare Brise et déterminer le point de fuite autour duquel
s’organise la représentation du monde. Ou encore porte-fenêtre, un matin
d’été 2001. Et on aimerait rester ainsi, éternellement pris dans le
calcaire du temps. Raymond Bozier, regarde, explore, compare jusqu’aux tableaux
de Hopper dont les fenêtres sont si importantes dans la composition. Il cherche dans son
livre des issues avec simplicité, opiniâtreté, courage, s’interroge : qui
sommes-nous dans cet étrange anonymat des lieux et des vies prêtes à
l’envol ? Anonymat oui, pour ce livre passé inaperçu par rapport à Windows
in the World. Pourtant ce Fenêtres sur le monde aurait bien mérité
d’inverser les rôles par son authenticité et sa véritable générosité.
Ô regards fatigués des dormeurs, sourde et envahissante mélancolie des villes la
nuit…
(22/09/2004)
"La ligne", de Pierre Bergounioux, Verdier :
Le titre est ouvert : est-ce un livre d’espace, de limite ? Le titre fait
rêver : quelle est cette ligne dont parle Pierre Bergounioux ? Quelle
démarcation ? L’encre de chine de Pierre Alechinsky en bandeau ne laisse pourtant
aucun doute : c’est de pêche qu’il s’agit, pourtant le tracé
d’écriture de cette " ligne ", parabole, lettre mystérieuse,
nous ramène aussitôt à l’ouverture, non pas celle de la pêche, mais bien celle
des hommes. Ouvrons le livre donc… Et puis non, je me ravise, je sais trop par
habitude les cadeaux précieux que Pierre Bergounioux offre à ses lecteurs. Pas comme
cela, dans mon coin de vacances, n’importe où : je choisis de l’emmener à la
plage : ce sera un livre d’eau et de sable. Ce n’est pas un hasard que ce lieu
élu : j’ai lu sur ce sujet bien d’autres auteurs, dont deux de mes
favoris, Maurice Genevoix avec La boîte à pêche (ou certaines scènes de ses Bestiaires)
et René Fallet avec La pêche à la ligne. J’avais découvert pour la
première fois Maurice Genevoix sur une plage en Corse et je voulais sans doute retrouver
quelques-unes unes des sensations d’émerveillement que j’avais alors
éprouvées.
La pêche à la ligne inspire donc de nombreux écrivains. Bien entendu, on trouve
facilement des analogies entre ce jeu de patience et l’écriture, l’attente et
la réflexion, enfin le geste décisif qui ferre le poisson ou qui trace les mots, puis
l’attente à nouveau…etc. On peut aussi trouver bien des comparaisons entre
l’apparente inutilité de l’écriture et la pêche, leur importance essentielle
dans la préhistoire de l’homme, l’une qui procède de la magie et du sacré et
l’autre de l’estomac à nourrir. On pourrait trouver comme cela beaucoup de
points communs mais j’étais déjà arrivé à la plage et j’avais ouvert le
livre.
On ne peut pas raconter La ligne, de même que tous les ouvrages qui évoquent le
sujet, de même qu’une partie de pêche ne se raconte pas " dans
l’instant ". Et c’est bien comme cela qu’agit la littérature
quand elle touche et ferre son lecteur (encore un point commun), c’est après le
livre lu que les images et les sentiments viennent. L’image ici est celle de du
geste, de l’écriture, de l’apprentissage, tout le contraire de
l’inactivité que l’on pourrait attendre d’un tel livre. Car il s’agit
d’une pêche difficile, celle de la mouche, du jeté de la soie qui n’est jamais
que l’exagération du poignet formant les lettres. Le livre de Pierre Bergounioux ne
se réduit pas à ces poncifs : c’est un livre profond qui prend racine et
source dans le passé familial de l’auteur dont la réussite est de simplement nous
faire partager cette réflexion commune et profonde, d’universaliser à toute action
et à tout homme ce qui au départ n’est en apparence qu’un simple passe-temps.
A lire absolument.
(01/09/2004)
Lire en vacances, liste de l’été 2004 :
Roland Barthes : Œuvres complètes en 3 tomes, biographie de Roland
Barthes par Louis-Jean Calvet, Le Marin de Gibraltar de Marguerite Duras, Espèces
d’espaces de Georges Perec, La ligne de Pierre Bergounioux, Daewoo
de François Bon, Fenêtres sur le monde de Raymond Bozier, Moustiques de
Faulkner, plus le premier tome de la pléiade du même auteur : à peu près 7500
pages de prévu.
J’ai toujours peur de manquer de lecture dans un pays étranger où je sais que je ne
pourrai pas trouver facilement de livres en français… Le choix est chaque année
cornélien, je passe plus de temps à choisir les livres qu’à entasser shorts et
maillots dans la valise. Mais il a bien fallu se restreindre et enlever à mon grand
regret un ou deux kilos (deux tomes des oeuvres complètes de Barthes) pour arriver à
tout caser dans le coffre. Finalement, c’était prévisible, j’en avais encore
de trop mais je me sentais rassuré. Tout de même lu quasi 3000 pages en 3 semaines.
L’année précédente, en ce même lieu, c’était les 1000 pages de
l’excellente biographie de Beckett par James Knowlson (Notes de lecture du
27/08/2003) qui m’avaient tenu en haleine.
(25/08/2004)
" Especes d’espaces ", De Georges Perec, Editions
Galilée
Au départ, l’espace est la page blanche qui se noircit rapidement au gré
du voyage spatial que s’impose Georges Perec et qui s’étend rapidement au lit,
à la chambre, l’appartement, la rue, le quartier, l’immeuble en ouverture au
monde. Chacun de ces lieux est émaillé de réflexions, lieux communs (et combien cette
expression est appropriée) propres à nous faire entrevoir l’espace autrement,
remarquer ce que l’on ne remarque plus, trop occupés devant la profusion
d’images.
Barthes dans son " plaisir du texte " imagine deux types de lecture,
celle qui fait plaisir - textes longs, classiques, histoires, sorte de déroulement
tranquille du voyage vertical - et celle qui fait jouir, car sa lecture dérange,
transpose, enchante, déplace, ravit (au sens du Ravissement de Lola Stein, cher à
Marguerite Duras). Espèces d’espaces appartient à la deuxième catégorie et la
jouissance se raconte difficilement. C’est donc un livre indispensable. On peut juste
citer entre autres (voir en Notes d’écriture aussi) l’avant dernière phrase
magnifique, ouverte sur deux points comme une invitation : L’espace fond
comme le sable coule entre les doigts. Le temps l’emporte et ne m’en laisse que
des lambeaux informes :
(18/08/2004)
"Moments oulipiens", Oulipo, Castor Astral :
J’ai acheté ce petit livre tout juste paru (en mars dernier) dans ma librairie
langroise préférée (Alinéas), preuve encore, s’il en est à faire, de
l’utilité d’un excellent professionnel dans une petite ville de 10000
habitants, patrie natale des philosophes Diderot et François Dagonet, de l’éditeur
Domininique Guéniot et de moi-même.
Belle couverture noire et titre intrigant : Moments oulipiens, ce recueil (par
ailleurs passé complètement inaperçu, comme c’est dommage) est collectif, issu des
différents membres de l’Oulipo. Point de contraintes mathématiques liées à la
littérature ici, mais chaque personnalité retrace sa vision, ses souvenirs de réunions,
colloques, lectures oulipiennes. L’ensemble forme une vision attachante, avec un
bonheur potache et de véritables émotions pour un phénomène devenu célèbre.
L’Ouvroir de Littérature Potentielle, fondé par Raymond Queneau et François Le
Lionnais, prend ici toute sa dimension, coincée entre son aura intellectuelle, ses
invitations universitaires et le fonctionnement bon enfant d’une assemblée pas
toujours sérieuse, qui ressemble à une association loi de 1901, avec des réunions
régulières chez les uns ou les autres, avec dégustations de mots, mets et vins.
On trouvera avec plaisir les textes étonnants de Jacques Roubaud, Marcel Benabou, Paul
Fournel, Harry Matthews, François Caradec, Jacques Jouet, Hervé le Tellier, Bernard
Cerquiglini, Michelle Grangaud, Olivier Salon et Anne F Garréta. Les autres membres de
l’Oulipo sont excusés aux réunions de l’Ouvroir pour cause de décès comme il
est rappelé sur la quatrième de couverture. Car leurs fantômes bienveillants n’en
finissent pas de hanter les membres actuels, comme le mystérieux CB avec Anne F Garrèta,
la nuit même de son prix Médicis, Jacques Jouet qui désirait avec foi, malice et
opiniâtreté que " les cendres de Perec se retournent dans son urne "
ou Hervé Le Tellier contraint de dédicacer à titre posthume pour Raymond Queneau les Exercices
de style.
(21/07/2004)
- " Les règles de l'art " (Génèse et structure du champ littéraire),
Pierre Bourdieu, Seuil :
J'avais déjà fait une note de lecture très succincte le 22/11/2000, pour marquer l'intérêt que j'avais pris à la lecture de cet ouvrage approfondi de près de 500 pages. J'y reviens quelques années après mais avec un changement notable : la maigre expérience de la publication que j'ai eu depuis me fait reconsidérer d'un œil neuf la définition de l'écrivain dont il évoque les limites dans " le point de vue de l'auteur " (voir en Notes d'écriture, cette semaine), ou encore appuie d'une manière très juste, dans " le marché des biens symboliques ", les difficultés ou les avantages que j'ai à être publié où je suis (en Etonnements).
Je n'en dirai pas plus cette fois ci sur ce livre, donc autant qu'en 2000, sinon que ces " règles de l'art " sont le genre de bouquin que je n'ai pas fini de relire, de reprendre et d'en parler (rien dit pour l'instant entre le rapport entre les exemples de peintre et d'écrivains, en tant qu'artistes, pourtant il y a matière). Entrer dans la sociologie de Bourdieu, c'est forcément sport de combat : il y aura d'autres " rounds ".
(30/06/2004)
"Burroughs", de Gérard Georges Lemaire, Artefact :
Les éditions Artefact publient peu mais se sont spécialisés avec bonheur dans
d’excellentes biographies de grand format, abondamment illustrées. J’ai déjà
eu l’occasion de lire un truculent " Léautaud " et un
" Michel Leiris " d’une grande qualité. J’aimerais par
ailleurs découvrir Cendrars dans la même collection.
La biographie de William Burroughs est présentée de façon alphabétique, par thème ou
mot clé. Cet auteur est, avec Jack Kerouac, l’un des écrivains phares de la
" Beat génération ". Pourtant, rien ne destinait cet homme
élégant, aisé héritier des machines à calculer du même nom, allure de Buster Keaton,
costume, cravate, chapeau, a devenir l’un des symboles de cette contre-culture. Mais
le goût des drogues en tous genres, la nécessité des milieux louches, son
homosexualité lui fait fréquenter ce milieu de bohème. Il tente de le raconter dans ses
livres qui apparaissent à tort comme des ouvrages de SF, alors qu’ils sont la vision
d’une réalité bien américaine, vue à travers le prisme de la drogue et des
expériences hallucinatoires, car s’il est un écrivain qui a tout tenté pour
modifier sa perception dans l’acte d’écriture, c’est bien William
Burroughs. Sa démarche était de se libérer du poids social et millénaire du langage,
associé pour lui à la manipulation des individus, restrictif de liberté plutôt
qu’émancipateur. Dans cet esprit, les cut-up, découpages et assemblages de
plusieurs textes permettaient selon Burroughs de révéler les véritables sens du
discours. Et les drogues étaient là pour s’affranchir des mêmes inhibitions de
langage dans les textes créatifs.
(23/06/2004)
" Absalon ! Absalon ! " de William Faulkner,
Gallimard (L’imaginaire) :
La lecture d’un livre est parfois associée à un lieu : en ce qui concerne Absalon !
Absalon !, il me semble que je ne pourrais plus jamais entendre parler, voir ce
titre sur une couverture sans penser à ce voyage en train qui m’a emmené
jusqu’à Brive, à l’occasion du Salon du livre des jardins de Terrasson, salon
pour lequel j’étais invité avec mes Paysage et portrait en pied-de-poule. Et
aux paysages imaginaires du Comté d’Yoknapatawpha se superposent les vallons
magnifiques et verdoyants aperçus depuis la fenêtre du train, sous le soleil de juin.
Yoknapatawpha, William Faulkner, unique possesseur et propriétaire, comme il est indiqué
sur la carte jointe à la fin du roman, ainsi que différents évènements du type
" domaine Compson dont le pré fut vendu au Club de Golf afin de payer les
études de Quentin à Harvard ". On y trouve aussi une chronologie des
évènements, une généalogie bien utile pour cette saga. Tous ces éléments nous font
entrer dans l’extraordinaire monde intérieur de Faulkner, monde très peu éloigné
de la réalité du Mississippi.
Revenons à Quentin, parti faire ses études, et qui retourne à Yoknapatawpha pour
entendre le récit d’une vieille parente, sa vie, les évènement tragiques qui
l’ont accompagnée. Mais ce qui sert de lien au récit se dissout dés la première
phrase de 15 lignes dans une époustouflante faculté de description, qui rappelle Claude
Simon : nous voici plongé dans le monde sudiste, avec une galerie de portraits,
blancs aristocrates, revanchards de la guerre de Sécession, noirs exploités, libres et
pauvres, le tout dans des étés brûlants, dans une nature qu’il a fallu maîtriser
à coup d’outils et d’armes à feu : violences, destins.
Raconter Absalon ! Absalon ! est illusoire et ne servirait à rien :
il faut s’y plonger, découvrir les moindres recoins de Yoknapatawpha, pénétrer
dans " une pièce obscure, étouffante, sans air, dont les persiennes, depuis
quarante-trois étés, demeuraient toutes hermétiquement closes ", aller plus
profond encore, regarder comme un entomologiste l’abondance de détails comme, au
sujet des mêmes persiennes, " les parcelles de la vieille peinture ternie et
desséchée que le vent détachait sans doute des volets écaillés et projetait à
l’intérieur ". Il faut accepter de suivre Faulkner dans ce dédale pour
que se révèle cette richesse et le souvenir ensuite d’une lecture et d’une
histoire essentielle.
(16/06/2004)
- "La préparation du roman", de Roland Barthes, Seuil/Imec :
- Nathalie Leger a eu une excellente idée de réunir, annoter et présenter en novembre
2003 ces cours de Roland Barthes dispensés en 1978 et 1979 au Collège de France.
La réflexion de Roland Barthes sur le sujet romanesque n’était pas nouvelle. Il avait déjà organisé en 76 et 77 des séminaires sur les relations du roman avec la vie habituelle (Comment vivre ensemble : simulations romanesques de quelques espaces quotidiens). Le travail qui suit prend à bras le corps la gestation d’un roman, du désir d’écriture à sa réalisation, en passant par toutes les indécisions, accidents de parcours et autres évènements qui peuvent influer sur cette préparation. La démarche de Roland Barthes est à la fois universelle et personnelle. Universelle car elle s’appuie sur les expériences connues des romanciers (avec toutefois une prédilection pour Kafka, Flaubert, Balzac) et personnelle car Roland Barthes suit avec attention son propre désir d’écriture et tente de le pister à travers une réelle préparation à un roman qui serait à venir. - La première année à été consacrée au désir d’écrire, cheminement que Barthes nomme très justement " De la vie à l’œuvre ". Vouloir écrire, appelé aussi fantasme d’écriture dont le haïku japonais lui semble être la matérialité la plus entière, comment dire, la plus authentique : fulgurance d’un instant, d’une inspiration (et notons en passant que l’inspiration décroche justement de l’instant, déjà dans l’immatérialité de l'écriture dont le temps est une autre dimension, ce que Barthes nomme l’enchantement). L’ensemble des cours consacrés aux haïkus tourne autour de cette idée : la contingence (matérialité de la vie), liée à la circonstance, ce qui provoque le désir de l’écriture. Le haïku représente pour l’auteur la note, l’idée, la préparation par excellence, c’est à dire le vague besoin, la substance des mots assemblés entre eux, une certaine forme de cohérence mais que tout dans la brièveté éloigne du parcours du roman, une sorte d’informel qui n’existerait que par l’assemblage des mots, l’esthétique et la perspective (quelle meilleure définition pourrait-on donner de la poésie ?), mais sans doute une construction très éloignée de la phrase, phrase que Barthes introduit que beaucoup plus tard, comme forme raisonnée, compromis compréhensif avec lequel le roman pourrait prendre corps et forme : d’ailleurs quelle meilleure conclusion à cette première partie que l’ouverture extraordinaire et proche qui se profile vers le romancier parvenu à cette étape : la viscosité des formes.
- La seconde partie franchit un cap : l’œuvre comme volonté. Intrinsèquement, parfois sans le savoir, allant contre lui, le roman en question s’est imposé au romancier qui ne peut que continuer. Cette partie est très concrète, allant jusqu’à explorer les divers pièges que la vie dresse devant ce qui ne constitue finalement qu’un exercice " out of time ", foncièrement inutile pour la collectivité de prime abord (sauf pour celui qui l’écrit et qui en fait parfois une question de vie ou de mort. – Il semble intéressant de se recueillir d’une minute de silence sur cette chose informe qui apparaît finalement qu’une inutilité apparente parmi tant d’autres, généralement ce qu’on nomme culture, créativité, bien éloignés de l’utile avec le paradoxe cependant qu’aucune civilisation n’ait réussi à survivre sans… Paix à tous les artistes…). Cette seconde partie aborde le travail d’écriture proprement dit, ce que Barthes nomme " praxis d’écriture ", c’est à dire la vie méthodique (vie matérielle, répondrait Duras) avec tous les pièges, les arrêts, les doutes qui y sont inhérents, bref, la vie démystifiée, au jour le jour de l’œuvre (il est par ailleurs intéressant de savoir comment les artistes démystifient leur œuvre, l’exemple de Picasso voulant montrer sa vie quotidienne, contribue paradoxalement à la surélever, la rendre inaccessible, par contre René Fallet raconte que Cézanne était " con comme un balai ", de même que, plus modestement, l’idée saugrenue et vantarde de vouloir s’exposer à travers un site Internet…). Le but étant de relier l’idée à sa composante sociale, compréhensible (donc pour le romancier, poursuivre l’idée de publier, aller vers les autres) : c’est le pire trouble social de ne pas classer, annonce Barthes en préambule à cette partie.
- Dans une des dernières parties, par ordre chronologique, l’auteur parle de la séparation, cette idée que le roman, à cet instant, bien entamé, procède d’un élan qui tend à lui donner une vie propre, coupe son auteur du monde, ce qu’on pourrait appeler le complexe de la mante religieuse, l’objet tant désiré devient celui qui mange et dissout son inventeur. A la lecture de ce titre par ailleurs je pensais que Barthes voulait raconter l’inévitable moment où le texte terminé, l’auteur doit s’en séparer pour le proposer au monde (chose qui pour moi m’étonne de plus en plus, tant cet instant apparaît comme de plus en plus brutal, une amnésie totale de mes textes récents à peine remis à un éditeur…). En fait, Barthes ne va pas plus loin dans ce processus, car l’œuvre n’est pas écrite et en cela il rejoint au bout de deux ans la vie universelle de cette préparation du roman avec sa vie personnelle : en effet quelle serait la conclusion de ce cours ? L’œuvre elle-même. Roman donc qu’il n’aura pas écrit (et pour cause : peut-on parler sur et être dedans ?), conditionnel qui marque bien la différence et l’impossibilité d’aller plus loin, de déborder ce qui ne reste qu’une préparation du roman au même titre que Benjamin Jordane ne peut dépasser son " apprentissage du roman ".
- Je ne sais pas s’il existe une suite à cette série de cours, un thème sur l’après roman, ce qui se passe dans la tête d’un auteur quand un, deux, trois, dix romans sont parus, peut-on y trouver des points de ressemblance, l’amnésie constatée après chaque texte est-elle ressentie par d’autres, par exemple ? En tout cas, cette préparation du roman de Roland Barthes demeure pour moi une sorte de reformulation de ce que j’ai fait jusqu’alors de manière complètement intuitive (vous n’en avez pas besoin m’a dit la libraire chez qui j’avais acheté l’ouvrage), procédant sans doute avec l’écriture de la même naiveté que monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ou du Douanier Rousseau peignant ses toiles en dehors de toute école, avec la chance d’avoir réussi le cycle complet de la création jusqu’à l’édition. Avec cette surprise aussi de découvrir que j’avais eu les mêmes questions que Barthes au sujet des haïkus, alors que j’entamais Central, à travers notamment le rapport au temps et au verbe, parfois absent de tels poèmes tandis que l’alchimie des mots agencés en gardait une temporalité sourde et tellement présente, passée ou à venir.
- (26/05/2004)
" Le Planétarium ", de Nathalie Sarraute, livre de poche :
Le Planétarium, sorti en 1959, m’a toujours semblé attendu dans
l’Œuvre de Nathalie Sarraute. Non pas attendu au sens de ce qui se fait attendre
mais, désiré, le livre à venir, l’incontournable suite du premier livre, de ces Tropismes
qui ont révélé l’écrivain, et qui paraissent juste au début de la deuxième
guerre mondiale. Par ailleurs, dans la belle expo réalisée par la BNF en 1995 (catalogue
en Notes de lecture du 15/06/2001) le mot planétarium figurait déjà lors des premières
ébauches de Portrait d’un inconnu, paru onze ans auparavant et deuxième
livre. En effet, le Planétarium, par sa similitude de ton et d’intention,
prolonge le véritable enjeu des Tropismes : aller vers l’épuisement des
petits mouvements internes, insignifiants et qui régissent nos vies.
A propos du Planétarium, on peut aussi voir dans le catalogue de l’exposition
BNF, un curieux schéma où les évènements de cette histoire semblent rayonner. Ce plan
a servi de fil conducteur à la rédaction du livre. La figure du soleil utilisée autour
d’un évènement (servant de lien à l’intrigue) est intéressante par rapport
à toute autre figure qui aurait pu aussi être utilisée (celle d’un escargot par
exemple) : en effet, intuitivement, Nathalie Sarraute aura su exploiter tous les
rayonnements, degrés et suivis de l’architecture de son roman. En cela, la figure du
rayon est une richesse importante qui se révèle à la lecture (voir la géométrie des
schémas également développé en Notes d’écriture cette semaine).
Justement la lecture : mais de quoi parle ce Planétarium ? D’un
évènement insignifiant, l’achat, ou la volonté d’achat d’un canapé par
un jeune couple désirant s’installer. L’écrivain irradie autour de ce
non-évenement et peint une féroce caricature d‘un monde bourgeois. Le thème du
consumérisme est alors inévitable dans cette période des trente glorieuses : Elsa
Triolet publie Roses à Crédit la même année et Georges Perec Les choses
quelques années plus tard avec en sous titre Histoire des années soixante (notes
de lectures du 19/11/2003).
Comme pour les Tropismes, le remarquable de ce livre tient par la restitution des
suites logiques des nos émotions, et Nathalie Sarraute montre tout ce qui nous fait
passer avec désinvolture de nos générosités à nos mesquineries. En cela, ce Planétarium,
bien que marqué par son époque, n’a rien de démodé. Le prétexte de
l’évenement ténu qui sert de point de départ à ce roman véritablement très
riche et universel justifie l’importance de Nathalie Sarraute dans l’évolution
du roman (ce que l’on a fossilisé sous l’appelation de nouveau roman…).
(19/05/2004)
"Les pas perdus", de René Fallet, Livre de Poche :
Il me manquait ce René Fallet, sans doute l'un des rares que je n'avais pas lu et que
j'ai déniché à une foire au livre d'Amnesty. Lire René Fallet, avant d'aller à
Londres au mois d'avril, c'est se souvenir des amours de l'anglaise et du vendeur rayon
pèche à la Samaritaine de Paris au mois d'août. Les pas perdus
précèdent de dix ans le succès de Paris au mois d'août, prix interallié
1964. L'intrigue est de celles qu'affectionnaient l'auteur, la simple et fraîche histoire
de cœur entre deux personnages généralement pas du même monde. Dans Les pas
perdus, un jeune peintre d'affiches de cinéma sans le sou a remplacé le vendeur et
une bourgeoise mariée, l'anglaise. On y retrouve tous les ingrédients qui avaient fait
le succès des premiers livres de l'auteur sept ans auparavant (Banlieue Sud Est
ou Pigalle), notamment un argot typique des années cinquante. Le livre sera
adapté au cinéma en 1964, soit dix ans après sa parution, sous le même titre
avec Michèle Morgan dans le rôle de la bourgeoise et Jean Louis Trintignant alors tout
jeune acteur. Catherine Rouvel tient le rôle de Mazurka, qui saura consoler le
prétendant le moment venu... A noter qu'un an plus tard, ce sera au tour de Paris au
mois d'août avec Charles Aznavour et Susan Hampshire.
(05/05/2004)
" Oh, les beaux jours " de Samuel Beckett, disques ADES :
Il est parfois bien pratique de se procurer des enregistrements quand on dispose
de temps de trajets en voiture assez long, cela vaut bien une lecture surtout dans le cas
de textes aussi denses que ceux de Beckett, écrits de surcroît pour le théâtre et
l'écoute.
Cet enregistrement de la pièce de Beckett a été réalisé en 1964 au Théâtre de
France. Madeleine Renaud y tient le rôle de Winnie et Jean-Louis Barrault, celui de
Willy, rôle se résumant pour ce dernier à quelques reptations et onomatopées, la
pièce étant dévolue surtout aux longs monologues de Winnie. Autant dire que les
actrices, choisies généralement par un Beckett en metteur en scène intransigeant,
relevaient un extraordinaire défi. Rares sont celles qui satisfaisaient pleinement
Beckett : Madeleine Renaud était considérée comme l'une des meilleures actrices "
intuitives " pour ce rôle. D'autres ont dû se surpasser comme Billie Whitelaw, sous
l'œil pointilleux de Sam.
Certaines critiques considèrent que la pièce Oh, les beaux jours est très
marquée par son époque des années 60. Pourtant la poésie qui se dégage de l'ensemble
est totalement intemporelle, même si les scènes issues du surréalisme dont Beckett
subit l'influence restent évidentes : on ne peut s'empêcher de comparer le
dépouillement extrême du décor à certaines images du Testament d'Orphée de
Cocteau par exemple, ou certaines situations d'André Breton dans Nadja,
peut-être. A chaque fois qu'on entend ou lit un texte de Beckett, il y a une phase
déconcertante où l'on doit renoncer à toute interprétation, juste sentir le texte sans
l'associer à une quelconque rationalité, on peut alors se laisser envahir par
l'émotion. Car émotion, il y a dans Oh, les beaux jours, la question existentielle est
bien entendu au centre de cette pièce étrange et fine : Winnie à moitié enterrée, (à
moitié ?), parfois encore " nette et floue ", " passant et repassant dans
l'œil de quelqu'un ", peut-être déjà à l'état de souvenirs pour son Willy,
dans une sorte d'espace " à perte de vue, de passé et d'avenir ". " Ce
n'est que naturel, faut croire, qu'humain ". Faut-il " la déterrer, comme ça,
elle n'a pas de sens " ? Sens au synonyme de sensation, sensation du soir et Rimbaud,
car " ici tout est étrange et j'en suis reconnaissante, très reconnaissante "
dit Winnie en appuyant sur le " très ", regardant le désert qui avance et
" les derniers humains à s'être fourvoyés jusqu'ici ", aux confins de quoi,
la réponse n'est que trop certaine et pourtant jamais dite (" Tais-toi, ne gaspille
pas les mots de la journée ").
Rien n'est triste cependant, le titre Oh, les beaux jours, décuplé, renforcé
par des exclamations " oh, oui, de grandes bontés ", des tendresses de "
vieux style ". C'est un hommage à la vie que nous a laissé Beckett avec cette
pièce et comme il nous le rappelle bien par l'intermédiare de Winnie : " Que vit-on
jamais qu'on eut déjà vu ? ".
(21/04/2004)
" In the mood for love ", film de Wong Kar Wai :
Comme il y a deux ans avec Sur la route de Madison (en note de lecture
du 20/03/2002), c'est un film que je commente dans cette rubrique dévolue à la lecture,
tant il est vrai que les émotions se rejoignent, provoquées par un processus similaire.
In the mood for love, film récent de 2001, n'échappe pas à la règle descriptive,
narrative. L'ambiance, l'entourage, tout ce qui constitue la trame de fond au cinéma (ce
qui donne le ton et le rythme d'un livre) est ici remarquablement restitué : Hong-Kong
des années 60, averses, rues, escaliers, bureaux, nuits étouffantes, vendeurs de soupe,
pesanteur étrange des villes peuplées, du " tout est possible " dans le
désert des rues et la nudité des murs. Voici pour le descriptif. Le narratif est cette
histoire classique, comme dans Sur la route de Madison, on pourrait dire fleur
bleue, le boy meets girl, seriné invariablement par Hitchcock à chaque fois
qu'on lui demandait quelle était la clef d'une bonne histoire. Le rythme du film est
lent, des ralentis viennent parfois ajouter une mélancolie particulière et Maggie Cheung
est ravissante dans ses robes de formes identiques. L'intrigue, car il faut bien parler de
l'intrigue est simple : un homme et une femme découvrent que leurs conjoints les trompent
ensemble. Attirés l'un vers l'autre, ils tentent de ne pas reproduire cet exemple. En
regardant ce film, je ne pouvais m'empêcher de penser aux enchaînements subtils des
scènes entre elles et quelles leçons sont ainsi données aux écrivains pour enchaîner
paragraphes et chapitres.
(14/04/2004)
" Aujourd'hui, Blaise Cendrars part au Bresil " de Jérôme
Michaud-Larivière, Fayard :
Evidemment, dés que j'ai eu connaissance de ce récit, j'ai réservé sa lecture
pour ce voyage déjà programmé. Ainsi, j'ai eu l'impression de rechercher derrière
l'auteur, les traces du poète parti au Brésil en 1924 pour la première fois et pour 9
mois. Et d'y retrouver bien des points communs inévitables avec l'auteur qui prévient
ses lecteurs que de toute façon, aller à la recherche de Blaise Cendrars au Brésil,
c'est se chercher soi-même.
Autant on pourrait être surpris, voire importuné par l'expérience de l'écrivain actuel
qui tente parfois de superposer ses expériences vécues quatre-vingts ans après Blaise
Cendrars, autant le récit personnel est inévitable et bien compréhensible dans le vaste
territoire libre où chercher la modernité telle qu'elle constituait la quête du grand
poète s'apparente à une initiation. Et d'arriver à la même conclusion que Jérôme
Michaud-Larivière : le Brésil est ensorceleur, moderne au point de donner l'impression
de renouveler sans cesse les écrits de Feuilles de route par exemple (voir en Webcam,
coucher de soleil sur Bahia).
Moderne, oui, triomphe des modernistes qui invitèrent Cendrars et qui triompha dans les
années cinquante, trente ans plus tard, avec Brasilia. Blaise était fatigué au bout de
sa course mais sans doute y pensa t'il fortement dans les inaugurations fastueuses de la
première capitale la plus avant-gardiste du monde. Jérôme Michaud-Larivière n'a pas
semble t'il poursuivi sa quête hors les traces de Cendrars dans le no man's land que
constituait le plateau de la future Brasilia. On lui doit cependant un récit très
captivant (ah, le récit de la balade dans le Minas Gerais ! ), extrêmement bien
préparé et documenté. Mais chercher Cendrars c'était peut-être aller là où il
n'avait jamais mis les pieds, hors de lui et projeté comme ces " îles " et les
" chaussures par-dessus bord car je voudrais aller jusqu'à vous ".
Les livres sont aussi faits pour voyager : j'aime à penser que ce récit au titre si fort
" Aujourd'hui Blaise Cendrars part au Brésil " soit resté pour prendre l'air
du temps à Brasilia la Moderne chez Jean Marc et Sophie, pour leur passion de ce pays,
pour Tarsila et tous ceux qui les ont précédés. (25/03/2004)
" Il y a un ", de Gabriel Bergounioux, Champ Vallon :
Gabriel Bergounioux, oui, c’est le frère : il est déjà apparu dans
l’excellent Pierre Bergounioux, l’héritage, Les Flohic éditeurs -
hélas disparus ! - (note de lecture du 25/06/2003), biographie qui prenait la forme
d’une rencontre familiale.
Gabriel, donc, professeur de linguistique à la Faculté d'Orléans publie ce premier
roman au titre beckettien et modeste. Pourtant, comme pour " Les
candidats ", premier récit de Yun Sun Limet (voir ci-dessous), s’il devait
exister une révélation forte de l’événement marketing que constitue une rentrée
littéraire, assurément, ce " Il y a un " mériterait la plus grande
attention par la portée immense de ce qu’il véhicule.
C’est un récit de guerre. Une guerre étrange qui semble durer déjà depuis
plusieurs générations. Une guerre qui nous prend à la gorge dés les premières
pages : phrases comme des déclarations "La circulation de la presse nationale
est réduite aux titres régionaux ", réactions "ils ont des mots pour en
parler : ils disent brutalement, une surprise, d’un coup, s’attendaient
pas". Car cette guerre est brutale, l’événement est commenté, on l’a
appris chez le pompiste, le coiffeur, " c’est mon beau-frère qui a
appelé "… Cela pour le passé, car le récit se situe dans cette guerre
immense et infinie, répétitive. Répétitive ? Le mot est abominable comme si on
pouvait s’habituer à la guerre, la répétition de tout ce langage guerrier
qu’avec une maîtrise extraordinaire, Gabriel Bergounioux nous restitue au fil des
pages : au hasard, p 65 " ébranlement de véhicules à
chenilles ", " consignes de sécurité ", p 95
" période de déconfinement ", " meurtrières ",
" revue de matériel ", p203 " magasins
militaires " " effets personnels déposés à la consigne ",
tout cela provoque une ambiance incroyablement précise et kaki et que vient renforcer
l’agressivité, la hâblerie de ce monde armé collé aux mots : p 68
" tu te crois à la plage à t’étaler comme cela ? Je vais te coller
un rapport, ça va pas traîner ", p126 " Qu’est-ce
t’as ? Il t’as foutu sa godasse dans la gueule ? t’as qu’a
faire gaffe ". Au fil des pages, dans le mélange du temps infini et suspendu
des belligérants ou de la société civile complètement obnubilée par le conflit, on
finit par ressentir un profond malaise, un dégoût.
Viennent alors les questionnements, les analogies. Ce démarrage brutal de la guerre
rappelle inévitablement le 11 septembre. Cette ambiance de treillis et les mots qui vont
avec " check point… " rappelle les territoires occupés par
Israël. Cette société civile qui se repaît dans l’instinct belliqueux ou qui le
subit rappelle quoi ? Et la réponse s’impose inévitablement : oui ,
cette société civile ressemble tellement à la nôtre, on pense aux discours agressifs
de Sarkosy, à ceux infantilisants de Raffarin, les expressions employées sont les
mêmes, on agglomère le langage parfaitement restitué par l’observation
linguistique de l’auteur, en spécialiste idéal. On réalise qu’on se trouve
devant un roman qui, aussi surprenant qu’il soit, n’est aucunement éloigné de
la réalité. La portée politique, non pas intemporelle, mais au contraire enchâssée
dans le présent apparaît alors crûment et ce récit prend alors toute son
importance : c’est le seul, oui, le premier roman qui ose reconstituer la
violence actuelle de ce que nous vivons, qui l’enchâsse dans une portée littéraire
réfléchie et, par là même, qui nous précipite dans cette réalité que nous ne
voulons ou ne pouvons pas voir.
Au final, apparaissent clairement la signification du titre et de ce personnage aveugle
enrôlé à la guerre, qui se retrouve au milieu de la mer dans une sorte de temps et
d’espace indéfini : nous sommes revenus avant Iliade (jeu de mot avec le
titre), avant l’épopée des hommes, avant Homère, avant la naissance du roman, on
peut ainsi tout recommencer dans l’espoir (combien le titre beckettien rejoint au
même titre l’épigraphe que j’avais choisi pour Paysage et portrait en
pied-de-poule et qui conviendrait ici également parfaitement " encore une
seconde rien qu’une, aspirer ce vide. Connaître le bonheur – mal vu mal dit ").
Le roman " Il y a un " se termine ainsi " les choses
allaient commencer pour de bon, quelque chose à raconter. Je chantonnais
déjà ". A nous de prendre cette phrase et pour la paix. A nous de le lire
ABSOLUMENT et comme un manifeste…
(25/02/2004)
"Les candidats", Yun Sun Limet, La Martinière :
Hormis l’agitation médiatique que provoque le rapprochement du Seuil et de la
Martinière, autant dire que cette dernière maison d’édition réussit le tour de
force de publier des romans dont la qualité visuelle, pourtant limitée à l’écrit,
ne rompt pas avec les beaux livres, généralement photographiques, qui forme la
réputation de ses collections. Joli équilibre donc entre le format, la qualité du
papier, la typographie, l’excellent choix de la photographie de couverture.
Dans son roman " Les candidats ", l’auteur répond à une
question que tous les jeunes couples se sont inévitablement posés : Quelles
dispositions prendre en cas de décès simultanés ? Quelle autre solution que de
d’imposer sa progéniture à ses grands-parents qui vont les élever dans la
douleur et le souvenir? Les candidats sont donc quatre couples pressentis à
l’adoption de deux enfants de leurs amis brutalement décédés et au testament
qu’ils avaient laissé. Chacun évidemment devant répondre à cette lourde
responsabilité bien inattendue. A travers cette histoire peu banale, Yun Sun Limet, dont
c’est le premier roman, nous donne à lire un récit d’une grande maîtrise, à
la fois par le style et par la manière. Bien enchâssé dans notre époque, cette
soudaineté de l'épreuve laisse révéler la rapidité de notre monde, nos incertitudes
devant les décisions et bien entendus les difficultés souvent bien différentes que vont
rencontrer nos candidats. Emotions sans tapage, tristesse sans mièvrerie, circonstances,
malentendus, rarement un récit n’a su restituer une telle ambiance, une telle
vérité des sentiments. La puissance du récit transparaît magistralement dans la
différence entre les histoires singulières de chacun des candidats : jeunes
intellos cadres, milieu de petites villes provinciales où tout se sait, difficultés
matérielles d’amis moins fortunés, les relations de ce couple disparu restituent
admirablement ce que sont les amis de tout un chacun. Il faut entrer dans ces cercles
différents, pénétrer dans ces intimités qui interceptent "l'évènement", on
le fait d’autant plus facilement que la finesse de l’écriture tisse une
ambiance un peu triste, une nostalgie en nuances légères. Bref tout est tellement vrai,
véritable, véridique, une délicatesse de la vie qui reste bien après la fin de la
lecture.
Il est généralement plus difficile de faire paraître un premier roman pour la rentrée
de janvier. S’il en est un à se souvenir dans la grande vague médiatique qui
continuera avec plus d’ardeur en automne, ces " candidats ", et
leur jeune auteure Yun Sun, méritent qu’on les retienne et que l’on rende
hommage à cette discrétion qui est marque d’une authenticité d’écriture.
(11/02/04)
"Picasso et Jacqueline", de David Douglas Duncan, Skira-Flammarion :
"Grand-père", Marina Picasso, Denoël :
Je sais, la semaine dernière, j’avais promis de ne plus parler de Picasso,
qui m’a un peu obsédé ces derniers temps au point de monopoliser pas mal de mises
à jour. Mais que voulez-vous, le personnage et sa dimension ne s’avalent pas si
aisément. Bref, les deux derniers ouvrages lus et présentés apportent une sorte de
conclusion et un éclairage de mon obsession pour le peintre.
Picasso et Jacqueline tout d’abord. Magnifique recueil de photographies prise par un
journaliste américain, David Douglas Duncan qui osa un jour sonner à la porte de La
Californie, résidence cannoise qui abritait Picasso et son dernier amour encore
débutant à l’époque. Voir vivre Picasso, encouragé par la dévotion de
Jacqueline, c’est un peu comme regarder pousser au maximum la créativité de
l’artiste et l’affranchir de toutes les contingences. Oubliée la période
mondaine favorisée par Olga (mais période qui lui ouvrit bien des portes du
succès…). Picasso vieillissant s’engouffre sous la protection de Jacqueline
dans une frénésie de création, que l’album évoque dans le capharnaüm de la
grande villa toute entière dévolue aux œuvres.
Lors d’une interview, j’expliquais à une journaliste que je regardais souvent
à la loupe le fond, les entourages, jardins, maison, murs sur les photos de portraits
d’écrivains tant il me semblait important de mêler paysages et portraits. Ici,
évidemment je suis servi. Regarder tel dessus de cheminée, essayer de le retrouver
photographié à une autre époque, reconnaître les objets tableaux qui sont restés,
deviner le sort de ceux qui ont disparus. Distinguer jusqu’au moindre mégot écrasé
dans une soucoupe me semble important, sans doute par ma façon d’appréhender le
réel par la description minutieuse et précise. David Douglas Duncan a su trouver cet
équilibre subtil entre tout montrer et surprendre dans les visages, le doute, la douleur,
la joie enfantine, la vie quotidienne…
Justement la vie quotidienne… A en croire Marina Picasso dans son livre Grand-père,
elle ne fut guère joyeuse pour elle. Autant les photos nous font vivre la douceur de vie
à La Californie, autant pour l’entourage familial resté à
l’extérieur, la vie pouvait être autrement plus difficile même (et surtout) avec
le nom célèbre à porter. Marina, fille de Paulo, fils de Picasso, dont toute la vie fut
à son service sans véritable existence propre, raconte que la tragédie peut côtoyer le
bonheur de la création. Son frère Pablito se suicida peu après la mort du peintre et
certainement par amertume de n’avoir pas été plus reconnu, sollicité par son
grand-père, inatteignable dans sa tour d’ivoire. Même si le livre est excessif,
voire injurieux à l’égard du peintre, même si l’on devine la justification
des combats d’héritage, l’existence de ce livre, pose le problème de la
création justement et de ses inévitables écueils, abus, par son caractère antisocial.
Picasso, le sage et le fou (titre d’un autre ouvrage dans la collection
découverte-Gallimard), Picasso donc, ou comment l’artiste balance inévitablement
par ses recherches dans l’inconnu, en dehors des normes sociales, (ainsi le fou, le
psychotique se définit-il ainsi en médecine par l’incapacité de vivre dans la
normalité) et dans le génie, le ravissement, la révélation de son œuvre par
rapport à ce même monde. Dualité difficile à atteindre. Picasso avait choisi
d’aller jusqu’au bout. A sa mort, l’œuvre-comète et l’homme,
désormais inséparables, ont consumé les plus proches.
(21/01/2004)
" Conversations avec Picasso ", Brassaï, Gallimard :
Cette lecture termine (pour l’instant) un cycle personnel de découverte de Picasso
avec pas mal d’ouvrages ou d’articles consacrés à l’artiste depuis
plusieurs mois. Sans conteste, ces conversations avec Picasso sont très
précieuses pour qui veut pénétrer dans une intimité, non pas de voyeur, mais, comment
dire, pour y puiser dans les détours de phrases, évènements, attitudes, comment
l’acte de créer se révèle, se démystifie parfois assez prosaïquement. Autant le
livre de Pierre Daix (Picasso créateur) analyse finement les différentes
étapes, formes, influences de la vie incommensurable du peintre, autant le témoignage de
Brassaï apporte l’indispensable vision d’un proche qui passait le voir
plusieurs fois par semaine pour y photographier ses œuvres.
Voir vivre au quotidien Picasso, sans cesse dérangé, épaulé par Sabartés, entouré
d’Olga, de Dora, et plus tard, de Jacqueline dans sa villa " La
Californie ", mais sans que rien ne vienne interrompre son insolente vitalité
et sa créativité au cours des années, est une belle leçon pour tous ceux qui
n’arrivent jamais à produire en prétextant que la vie les mange…
Historiquement, il est très précieux de recadrer les liens entre les différents
témoins d’une même époque : Michaux, Sartre, Leiris, Eluard, Reverdy,
Cocteau, Prévert… Par exemple la libération de Paris évoquée dans le journal de
Leiris (note de lecture du 07/04/2001) vient s’y emboîter parfaitement. On comprend
également mieux, à travers cette vision historique, les enjeux du surréalisme et aussi
le désastre d’avoir dispersé par exemple la collection d’André Breton en
2003…
(07/01/2004)