Petite fabrique de mots
Bon, c’est parti : le moteur s’est mis en marche, la petite fabrique de mots a
commencé sa production. Étrange moment : je devais remettre un texte inédit pour une
revue italienne (pour une fois que je vais être traduit…) et je me demandais bien
comment faire : produire une nouvelle de dix mille signes (la distance qu’on me
proposait) n’est pas chose aisée dans cette période de fin d’année où tout
semble se bousculer. C’était pourtant la meilleure solution. Les départs
précipités, les ébauches incomplètes qui ont jalonné mes derniers mois ne
m’inspiraient guère et les autres textes mieux finis me semblaient assez éloignés
de ce que je cherchais. Et d’ailleurs qu’est-ce que je cherchais au juste ? Je
n’en avais pas la moindre idée, jusqu’à ce que je tombe sur un de ces départs
vite abandonnés, un fichier nommé avec justesse « fragment », enregistré le 17 juin
dernier et qui proposait une paire de pages suffisamment élaborées pour pouvoir les
reprendre, les fouiller et les améliorer. Et puis, ce qui m’apparaissait comme une
nouvelle bien close, s’est imposé avec une évidente clarté comme le début de
quelque chose. Quelle sensation ! Moi qui avançait dans une sorte de brouillard fébrile
côté écriture depuis quelque mois, je sentais bien poindre quelque chose sans arriver
à le concrétiser : pour preuve, pas moins de huit esquisses, inspirations diverses
depuis ce texte du mois de juin, tous abandonnés, petits morceaux épars. Donc, j’ai
continué et en cinq jours c’est à peu près l’équivalent d’une trentaine
de pages qui se sont élaborées, comme quoi l’écriture arrive toujours à
s’immiscer dans le moindre interstice de nos vies quand on en éprouve le besoin.
J’ai eu la chance de bénéficier de quelques longues heures de libres la semaine
dernière dans la paix de mon bureau et, oui, c’est bien de sensations qu’il
s’agit, l’écriture et son saisissement, comment les mots fabriquent un monde,
une cohérence, un sens évident à ce que l’on ressentait d’une manière plus
abstraite. J’ai eu ce sentiment, que j’aime beaucoup, d’aller vers des
images, la perception de quelque chose de figuratif, une représentation que construit
l’agencement des mots. De retrouver une manière, une « patte », quelque chose de
connu. Je prie pour que cette exaltation soit durable et conduise à quelque chose. Et
puis, comme dit une amie « je te connais : deux heures un quart sans écrire et tu
culpabilises. ». Elle a raison : je fonctionne comme cela, peut-être pour la belle
impression que provoque la récompense de l’écriture.
(01/12/2009)
Un choix entre "il" et "on"
Le premier décembre, dans cette même rubrique j’évoquais
la reprise fébrile de la petite fabrique de mots. Je suis un habitué de ces départs
foudroyants. Finalement, au bout de quinze jours, ça a l’air de tenir le coup : à
peu près l’équivalent de quatre-vingts pages de roman (puisque c’en est un).
Ceci dit, l’écriture dans ce laps de temps finalement très court n’avance pas
forcément d’un pas tranquille et régulier. Quelques insomnies récurrentes me font
penser la nuit à ce texte qui s’élabore et je résiste finalement peu à sortir du
lit pour rejoindre mon bureau et tenter de faire avancer l’écriture dans la nuit ou
le petit matin. Je me suis ainsi levé à trois heures il y a peu, et ce week-end
largement avant l’aube. Si je résiste à la tentation de me lever, j’élabore
alors dans la quiétude des draps, mille phrases, ajouts, débuts de chapitres,
réflexions différentes pour ce texte. Ainsi, il y a quelques jours (ou plutôt quelques
nuits), j’ai pesé le pour et le contre entre deux versions différentes de ce roman,
toutes deux déjà élaborées et qui semblait se tenir
pareillement. L’une utilisait un «on » pour représenter le narrateur et
l’autre un « il ». Le «on », pronom caméléon, était bien tentant car il verse
le lecteur de suite dans une identification floue, une empathie avec le narrateur
représenté par ce «on ». C’est par exemple le pronom qui domine dans Composants,
mais si, dans mon deuxième roman, il avait une disposition d’universel, ici, pour le
texte en cours, le « on » porte d’emblée la marque d’un « je », semblable
à la manière dont Leslie Kaplan l’utilise dans L’Excès-l’usine.
Ce qui me plaisait dans ce « on », c’était sa force d’évocation et son
originalité. Mais en même temps, le parti pris de le substituer
aussi manifestement au narrateur restreignait évidemment le point de vue, l’ensemble
de ce qui est raconté ne pouvant être perçu que par ce filtre : ainsi, comme avec le «
je », les points de vue, les descriptions mais aussi la langue étaient forcément ceux
du narrateur que j’avais imaginé. Or, la suite de mon texte propose une extension,
me semble-t-il, et ce procédé du « on » restreint au narrateur serait vite apparu
comme un écueil pour développer d’autres perceptions. Je suis ainsi revenu au « il
», plus classique mais qui, d’emblée est plus compréhensible pour le lecteur et
qui présente l’avantage de le poser en témoin du principal personnage (qui perd son
statut de narrateur). La position du lecteur est ainsi radicalement changée. Autant dans
la version avec le pronom « on », il se faisait complice du narrateur, il épousait
d’une façon plus ardente ses pensées, autant avec celle du « il », devient-il une
sorte d’identité volatile, une sorte d’esprit sain qui vole
au dessus des scènes présentées, qui observe l’ensemble, se penche parfois
par-dessus l’épaule du personnage pour voir ce qu’il fait. Cette position est
moins attachante, plus aérienne et il me faudra sans doute trouver quelques subterfuges
pour que le narrateur représenté par « il » puisse être relié de façon plus ardente
au lecteur. L’utilisation d’autres pronom (le « tu », simulant un dialogue par
exemple, le « on » accédant à l’universel) représentent quelques pistes, de
même que l’insertion des dialogues directement au milieu de phrases descriptives. En
fait, c’est la distance du lecteur avec le personnage qui doit varier : de temps en
temps, il doit pouvoir prendre de la hauteur mais il doit aussi être capable de le
marquer à la culotte. J’ai donc opté pour le « il », plus facile et ce choix
m’a permis d’avancer plus encore dans ce texte. Voici donc à quoi j’occupe
mes insomnies dans le ravissement de la nuit.
(17/12/2009)
Pour bien commencer l’année
Une bonne nouvelle histoire de bien commencer l'année. En réalité, cette affaire a
été rondement menée dans le dernier mois. Mais d'abord, replongeons nous dans le
contexte de l'année précédente. La parution de Bestiaire domestique en mars
avait été rapide : manuscrit terminé le 26 novembre 2008 et les premières épreuves
qui suivent 42 jours après ! Voici ce que je constatais il y a un an (note d'écriture du
09/01/2009).Si j'avais pu mesurer l'enthousiasme et la réactivité de ma maison
d'édition, j'avais quelque appréhensions pour cette année, notamment suite au départ
du PDG, sommité éditoriale s'il en fût, on pouvait craindre quelques restructurations
préoccupantes pour des auteurs qui, comme moi, qui ne pèsent pas lourds dans la balance
économique des comptes de résultats. D'autant plus que le catalogue des parutions s'est
restreint, ce qui en soi me semblait assez logique, voire bénéfique, après des années
d'éditions à tout va et de surpopulation éditoriale. Lors d'un coup de téléphone
amical de ma docte maison, j'avais cependant cru comprendre que j'y étais toujours
attendu et cette nouvelle m'avait quelque peu rassuré et donné du coeur à l'ouvrage.
Encore faut-il écrire et l'inspiration est une chose curieuse qui ne se commande pas.
Pendant des mois j'avais commencé des bouts de textes, juxtaposé des thèmes qui me
semblaient faire unité, mais tout cela restait à la fois fragile tandis que je sentais
confusément quelque chose poindre à travers ces grands élans vite terminés. Et puis,
la proximité éditoriale de Bestiaire domestique ne m'aidait pas outre mesure :
j'avais l'impression que je devais refaire le même coup, petites histoires sereines et
reflet du bonheur, qui n'étaient après tout que ce que je continuais à ressentir, tel
un auteur de haïkus japonais inspiré par son harmonie intérieure. Mais la vie réserve
des surprises et c'est vers un autre texte que je me suis dirigé à la suite d'un
concours de circonstances. Je devais en effet proposer un inédit pour la revue d'un ami
italien (pour une fois que j'allais être traduit !) et en fouillant dans les nombreux
fragments, j'en avais trouvé un, justement intitulé "fragment", et qui s'est
révélé être le point de départ fulgurant d'une histoire évidente, sans doute celle
que je cherchais confusément depuis des semaines. Et voilà :quatre-vingts pages en
quinze jours avais-je écrit dans ma dernière note d'écriture de l'année (17/12/2009),
en fait, publiée le même jour où je devais rencontrer ma maison d'édition. La suite a
dépassé mes espérances : même enthousiasme et même réactivité que pour Bestiaire
domestique. J'ai reçu la semaine suivante en cadeau de Noël un contrat en bonne et
due forme. Parution du roman prévu à la rentrée littéraire de septembre. Seul
inconvénient, mais de taille : il n'est rédigé qu'à moitié à l'heure où j'écris
ces lignes et il me faudra le remettre avant le printemps si je veux respecter les délais
nécessaires. Mais ça avance très vite et cela faisait longtemps que je n'avais pas
retrouvé de telles sensations inhérentes à la rapidité d'écriture : on y pense tout
le temps, le livre ne vous sort jamais de la tête, on se réveille au milieu de la nuit
et on a qu'uine hâte, retrouver sa table de travail. Tout le reste est tributaire de cet
acharnement, tout est polarisé par cela : où ai-je garé la voiture ?
(06/01/2010)
Deux
mètres d’écart entre écriture et réalité
Vieux débats multiples sur l’écriture et la réalité : ça existe depuis la nuit
des temps, mettons depuis l’Iliade et l’Odyssée, l’épopée
antique comme soubassement du roman et déjà se posait la question de l’écart entre
la représentation de la réalité et l’écriture, la narration destinée à passer
à travers le miroir du temps. J’y ajoute cette semaine un autre exemple, une maigre
illustration. Ce week-end, le nez dans le guidon du roman à écrire, j’ai tenté de
ne pas perdre le rythme rapide qui a présidé jusqu’ici à sa rédaction, soit vingt
pages par semaine. Et donc, ce dimanche, alors que je suis en retard, voici un nouveau
chapitre auquel je m’attelle : ça avance plutôt vite, j’écris sept pages
d’un coup, heures qui passent vite dans le silence du bureau, en fin
d’après-midi, et la satisfaction grandissante de cette facilité, de pouvoir
rattraper le retard alors que les occupations de la semaine (voir les maçons en rubrique
étonnement) avaient dévoyé l’inspiration ailleurs et, à chaque fois, c’est
tout un poème pour retrouver la liturgie nécessaire pour s’y remettre. Le roman en
question parle du boulot, je sais, c’est mon obsession, ma marque de fabrique,
appelons cela comme on veut, disons qu’il est sans doute plus proche de Central
écrit dix ans auparavant que tous les autres qui ont suivi. Le chapitre en question
traite de la retraite (drôle que cette redondance laitière des syllabes) : ça
s’écrit vite parce que je dois avoir des comptes à régler et sans doute pas mal
avec moi-même à ce sujet malgré cette perspective lointaine. La nuit dans
l’insomnie récurrente qui suit toute précipitation d’écriture, je repense à
tout cela, bâtit même ce qui pourrait être la dernière phrase du roman (et
j’allume la lumière pour noter la phrase sur un exemplaire de la Quinzaine
littéraire avec Pierre Michon en couverture, ça portera chance peut-être). Le
matin, je ne peux m’empêcher au bureau d’ouvrir à nouveau le fichier du roman
pour noter les quelques trouvailles de la nuit, quelques minutes arrachées à
l’entreprise où j’ai rapidement relu l’écriture de la veille et
c’est à ce moment là qu’il entre. Venu, non pas me voir, mais ma collègue
avec qui je partage le bureau. Elle est absente. Il balaie l’air de la main : pas
important, c’était juste pour régler quelques affaires encore en instance avant son
départ à la retraite prévu le soir même. Alors, c’est là précisément que se
mesure l’écart entre la réalité et l’écriture, à peu près deux mètres
entre lui, resté sur le seuil de la porte, futur retraité qu’on dirait tout droit
sorti du chapitre que j’étais en train de relire sur le micro devant moi. Deux
mètres et une minute, à peine le temps qu’il glisse quelques mots. Je le connais
depuis longtemps, c’est un discret, pas très causant. Il dit juste que « soixante
ans, ça commence à faire ». Il dit encore «qu’il faut savoir lever le pied ». Il
ajoute quelques allusions discrètes et de circonstances sur sa future vie qu’il
saura bien occuper. Il a l’air soulagé, en paix avec lui-même : le grand jour est
arrivé. On se sent lui sourire, lui souhaiter de cette manière bon courage pour la
suite. La porte se referme : deux mètres entre la réalité et l’écriture.
J’intègre immédiatement les remarques qu’il a faites dans le chapitre écrit
la veille.
(27/01/2010)
Le tour du
livre en quatre-vingts jours
Philéas Fogg fait des émules, ce n’est pas nouveau,
mais il y a plusieurs manières de voyager. Écrire un livre en est une et quand on
rédige un premier jet en exactement quatre-vingts jour entre l’incipit et la
dernière phrase, il y a de quoi se sentir l’âme d’un Jules Verne. Pas de quoi
pavoiser cependant, Simenon, paraît-il, écrivait beaucoup plus vite encore et René
Fallet, l’exemple entre tous, rédigea Paris au mois d’août entre mars
et avril 1964 et ce n’est pas là son moindre livre, ni de la littérature au rabais.
Mais revenons aux chiffres et aux symboles : quatre-vingts jours du 22 novembre 2009 au 09
février 2010. Le nouvel an tranche en deux parts égales cette lancée d’écriture.
Le livre, en format classique, devrait approcher les deux cent cinquante pages, ce qui
fait en moyenne trois pages par jour. En réalité, c’est un rythme hebdomadaire de
vingt pages que je m’étais imposé, généralement réparti sur trois jours
d’écriture avec le dimanche en point d’orgue quand je m’apercevais que
j’avais pris pas mal de retard. Ça fait un peu fonctionnaire de l’écriture,
toute cette rigueur mais je m’étais avancé en paroles avec ma maison
d’édition, au point d’avoir reçu un contrat en bonne et due forme pour ce qui
n’était encore commencé que d’un tiers (voire note du 06/01/2010 dans cette
même rubrique). Promesse tenue, donc : c’est terminé. Toutefois, je ne suis pas un
fanatique de l’écriture rapide même si je préfère la vitesse à la patiente
élaboration. CV roman, par exemple, fort de vingt-deux versions aura été
composé en deux ans. La plupart des romans similaires en nombres de pages ont été
rédigé en six à huit mois. La note d’écriture du 23/01/2009 répertorie de façon
précise ces périodes de créativité. En réalité, écrire vite présente
l’avantage de la cohérence temporelle : on est dans un état d’esprit qui ne se
relâche pas et l’ensemble peut paraître plus lié. En revanche, l’angoisse
d’être passé à coté du sujet est plus grande car on manque de recul et de
réflexion. Ce qui s’écrit dans l’urgence des sentiments est forcément plus
fort, plus casse-gueule aussi. Donc, l’attente suit ce premier jet que je me suis
empressé d’envoyer à l’éditeur. Rendez-vous est déjà pris pour la semaine
prochaine mais d’ici là, la peur, l’appréhension, l’inquiétude
d’avoir fourni un machin bancal ne va pas cesser de me tarauder. Ce trac, similaire
à celui du musicien qui va entrer sur scène, est forcément bénéfique. A se demander
si finalement on n’écrit pas en partie pour cette sensation.
(10/02/2010)
Un câble
électrique entre écriture et réalité
J’ai écrit encore une fois un roman sur mon boulot, singularité qui fait souvent se
confronter écriture et réalité. Par exemple, dans cette même rubrique, le 27 janvier
dernier, j’avais mesuré cette distance entre réalité et écriture : exactement
deux mètres pour séparer le livre en train de se faire et ce collègue bien réel,
resté sur le seuil de mon bureau, un écart de deux mètres donc entre lui et ma chaise,
m’annonçant sa future retraite alors que c’était justement le sujet d’un
chapitre que je venais d’écrire.
Maintenant, le livre est fini, je n’écrirai pas d’autres mots hormis quelques
corrections. Curieusement, le lendemain de l’achèvement du manuscrit, c’est un
fantôme qui vient me voir et se coltiner à ma fiction désormais éteinte. Je
l’apprends par une dépêche AFP : un nouveau suicide dans la vaste entreprise.
J’en retiens le lieu : une petite ville de l’Aisne, qu’en plus je connais
bien. J’y suis déjà intervenu comme conseiller mobilité. Il s’agissait
d’inciter les salariés à chercher ailleurs un boulot qui n’existe pas plus
dans ce coin perdu. Dans notre jargon, on dit habilement que « le site n’est pas
pérenne », à savoir que l’endroit où vous côtoyez vos collègues depuis des
années est voué à disparaître à terme (sans qu’on précise quel est ce terme et
c’est cela qui est dur). Bref, pas d’avenir ici, on ne sait faire que « du
moins ». Proximité navrante.
J’en apprends le contexte déprimant que je connais aussi : un ancien technicien
réseau, reconverti en téléopérateur, la cinquantaine difficile. C’est exactement
le personnage principal de mon roman. Coïncidence effrayante.
J’en apprends la date : le 26 janvier, juste au moment où je rédigeais cet autre
texte cité ci-dessus entre réalité et écriture et que je publierais le lendemain.
Simultanéité abominable.
J’en découvre le nom (j’ai forcément gardé des contacts) : son prénom est le
même que le mien et cette réalité d’auteur rentre de plein fouet dans le
personnage de fiction. Transgression effroyable.
Je m’aperçois de l’atroce effacement qui suit sa disparition : déjà viré de
l’annuaire des cent mille salariés de la boîte. Supprimons toute trace : c’est
aussi un des sujets que j’aborde dans mon livre. Cruauté évidente.
Je lis dans la dépêche AFP qu’il « s’est pendu avec un câble électrique
selon une source syndicale ». Câble électrique, on voit ce que c’est et peut-être
moi encore plus que les autres dans cette période de travaux à la maison : du gros 10mm2
sous gaine noire au 2,5mm pour raccorder une machine à laver ou au 1,5mm pour les
lumières et les prises, à cela rajouter du câble multimédia ou téléphonique, au
total un kilomètre et demi et pas moins de sept couleurs différentes, l’ensemble
tiré sous gaine, en goulotte ou dans des cloisons : une réalité tangible et même si la
source syndicale semble fuyante comme de l’eau, et même si ce n’est pas
vérifiable, ça a été dit, rapporté : du câble électrique et c’est devenu
encore plus une matérialité funeste.
J’en conclus qu’il retourne à son premier métier par lequel il avait débuté
par la matière même, l’outil de travail, le câble électrique comme moyen de vivre
et maintenant de se supprimer, tandis que la boîte s’empresse de clamer un peu tôt
qu’il n’y a aucun lien entre son geste désespéré et le travail : des
pressions. Tout mon livre est bâti sur ces liens fragiles et tenus entre le travail, la
matière, les gestes : dépressions.
Et tout cela arrive pour ma fiction tout juste close comme une preuve par neuf (celle que
l’on avait appris pour vérifier les divisions au primaire et que je n’ai jamais
su faire). Preuve par le neuf, la nouveauté. Jamais ce livre ne m’a paru plus
justifié. Que dois-je faire ? Le rouvrir et rajouter un ultime chapitre à la fiction ?
C’est presque déjà fait avec ce texte.
(17/02/2010) |
Une pelle
entre écriture et réalité
C’était ce dimanche avec l’habitude prise d’aller courir et combien
d’ailleurs cette manie est entrée dans le livre tout juste fini. Entré aussi
l’épisode du collègue entrevu l’année précédente, à la même époque
d’ailleurs, il était en vélo et j’avais relaté l’épisode en étonnements le 06/02/2009 avant
de reprendre l’anecdote dans le chapitre 15, d’évoquer aussi dans le chapitre
17, comment je l’avais revu dans une course populaire (il court aussi, en plus du
vélo). Voilà pour le mélange avec la fiction du livre en cours d’achèvement mais
ce n’est pas un livre sur le jogging, loin de là, et c’est juste un aspect du
personnage principal. Dans la réalité bien tangible, mon collègue se tient debout sur
le trottoir avec une pelle à la main. Il a entrepris de boucher les trous que
l’hiver a favorisés avec les passages répétés des voitures devant chez lui. Je
m’arrête pour discuter et, c’est comme l’année passée, ce que j’ai
retranscrit dans le chapitre 15 par « phrases hachées par le souffle encore court ». On
discute donc. J’avais gardé aussi le souvenir d’échanges tels que je les avais
aussi écrits par « A la rituelle question : et toi ça va le boulot ? Il reste laconique
comme il se doit. ». Cette fois-ci, il est plus disert, le collègue, mais plus triste
aussi. Oui, il a eu pas mal de problèmes dans le boulot. Dépression, il en sort à
peine. Alors on parle de tous ces drames forcément qui traversent la boîte. Difficile de
s’en sortir. Quinze jours avant, c’était aussi un autre qui m’avait
évoqué son changement de boulot. Là aussi collusion entre réalité et fiction :
j’ai fait entrer son anecdote dans le chapitre 66, vers la fin du roman. Plus ça va,
plus je suis persuadé que c’est un roman que j’ai écrit, c'est-à-dire quelque
chose qui a de la prise avec le réel, comme l’expression du béton qui prend quand
il durcit. Mon roman prend.
(24/02/2010)
Premières épreuves,
premières impressions |
Premières impressions : c’est le cas de le dire. Le facteur
m’a apporté le paquet de feuilles A4 serrées, imprimées, qui forment les
premières épreuves du livre à paraître en septembre. Avec l’éditeur, nous avons
fait le choix de travailler directement d’après celles-ci sans préparation
préalable ou correction de mon fichier. Autant dire qu’elles sont donc abondamment
illustrées. En rouge par la correctrice, au crayon par mon éditrice. La correctrice,
tout d’abord : plaisir de m’apercevoir que rien n’est laissé au hasard, ni
les coquilles de ma citation de Proust, pourtant vérifiée dans la même édition Quarto,
ni la suggestion d’une convention pour commencer les dialogues intégrés dans le
texte par une majuscule. Vérification faite, la même convention a été adoptée par
Claude Simon, on ne saurait mieux faire. Mais si cette correctrice pointilleuse – et
c’est tant mieux - note en rouge les maladresses, les coquilles et les fautes (pas
tant que ça mais ça suscite à chaque fois un cri d’horreur et la honte au front
lorsqu’on laisse passer un pluriel ou une erreur énorme), mon éditrice suggère au
crayon de papier quelques améliorations, souvent des ambiguïtés à éclaircir, des
lourdeurs à éviter, des répétitions passées inaperçues. J’aime ce travail,
savoir que ces deux bonnes fées se penchent avec intérêt sur le berceau d’un
livre, au risque que la comparaison soit un peu trop simplette.
L’avantage de travailler avec les premières épreuves est que, de suite,
l’aspect du livre lors de sa parution est visible : pagination, police de caractère,
format. Cela facilite l’assimilation du livre en tant qu’objet, le détachement
ou plutôt la transformation de ce qu’on a bâti au fil des phrases dans un tout
cohérent qui se sépare de la pensée par la réalité du papier. Ça fait un peu
charabia mais comment dire : on adopte le recul du lecteur et j’adore cette sensation
quasi-charnelle, excitante, à la limite de la schizophrénie, dédoublement de la
personnalité, quelque chose d’étrange comme une apnée. On retient son souffle.
Cette visualisation des premières épreuves est l’occasion de retrouver le
cheminement et le souvenir du livre. J’ai déjà souligné qu’à chaque fin de
rédaction d’un manuscrit une sorte d’étrange amnésie me prend, parfois au
point d’oublier le titre, le contenu, l’histoire, juste reste l’idée du
livre, quelque chose d’abstrait mais tous les détails semblent disparaître dans un
brouillard opaque. Pour ce roman, ça a été plus brutal encore parce que la rédaction a
été très rapide : deux mois et demi de labeur régulier, quotidien, une pensée
ininterrompue pour rédiger d’un trait les 300 pages que le livre accusera à sa
parution. Si je me réfère à cette même rubrique, à la date du 10/02/2010, je
remarquais avoir mis exactement quatre vingt jours pour le rédiger mais j’imaginais
une pagination finale de 250 pages. D’ailleurs, aller à la dernière feuille des
épreuves et découvrir le nombre total de pages est le premier geste que j’ai
effectué en ouvrant l’enveloppe, comme si j’avais besoin d’estimer
globalement le poids de ce que j’avais produit : l’expression « embrasser le
livre » me semble appropriée.
L’amnésie donc, laisser reposer le livre, comme disent la plupart des éditeurs ou
des auteurs, est une phase variable, certains l’estiment à un an mais je pense que,
plus que l'évaluation de ce temps de repos, c’est l’existence de cet oubli, de
cette amnésie, qui est importante. Oui, j’ai besoin de faire le vide, et
brutalement. Après, il faut refaire le chemin avec patience, s’étonner de sa propre
écriture, redécouvrir le livre dans un contexte nouveau, trouver pourquoi il est
original dans la globalité de ce qui l’anime, de ce qu'on a déjà écrit. Osons
dire : le replacer dans l’œuvre qu’on tente de bâtir.
(13/04/2010)
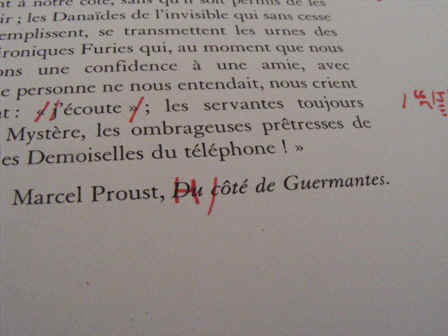
Premières
épreuves, deuxième épisode
La semaine dernière, j’exprimais ma joie de recevoir ces premières épreuves. Le
choix qui a été fait de travailler à partir de cette première mise en page du livre
sous son format le plus abouti m’honore : ça veut dire que le texte se tient bien,
pas besoin de corrections fastidieuses, de reprises complètes de chapitres, de
remaniements lourds. J’ai évoqué aussi cette bizarre amnésie mais qu’à mon
avis bien des auteurs possèdent à la fin d’un texte – la fameuse période de
repos du manuscrit – et la joie de recevoir ces premières épreuves correspond bien
à celle de se réapproprier le texte. C’est donc ce que j’ai fait toute la
semaine dernière : relire page par page les corrections, les suggestions, au besoin
rajouter, supprimer, bref, enfiler la cotte de travail et s’atteler à toutes les
finitions, le petit coup de papier de verre pour éliminer les scories, une retouche de
peinture par là et la fierté puérile d’avoir bâti une suite de mots, de phrases,
un roman qui se tient. Plutôt que de renvoyer le manuscrit annoté, nous avions fait le
choix de traiter par téléphone. Il a donc bien fallu deux séances d’une heure et
demie à deux heures chacune pour reprendre à peu près la moitié des pages que comptera
le bouquin. Ça allait d’une simple ambiguïté à lever, une faute, quelques mots à
retrancher ou à ajouter à des paragraphes refaits plus longuement. Ceci dit, la
tentation est grande de reprendre beaucoup de ce premier jet mais il faut, je crois,
résister le plus possible et aborder avec humilité l’ensemble. J’ai accepté
toutes les suggestions et les corrections déjà proposées et qui zébraient le texte en
rouge et au crayon. Elles sont toujours judicieuses parce que le regard est déjà celui
du lecteur mais avec l’angle de l’éditeur, un regard professionnel donc,
capable mieux que l’auteur d’apporter la distance nécessaire. D’ailleurs
souvent l’auteur n’est pas loin chez l’éditeur, c’est le cas de mon
correspondant téléphonique avec qui j’ai repris le texte, auteur de plusieurs
livres. C’est donc aussi sa créativité que l’on sollicite, une sorte de
non-dit qui s’exprime dans les difficultés du texte, j’avais l’impression
de lui demander parfois comment il aurait fait à ma place, comment il s’en serait
sorti avec une phrase pareille ou une telle idée à exprimer… C’est un travail
d’équipe et cet aspect me plaît énormément.
Chaque texte possède ses tics et ses particularités. Il y a bien entendu les
régionalismes, les expressions d’une langue familiale, sociale qui sont parfois en
dehors du français compréhensible par le plus grand nombre. Mais il y a aussi pour
chaque travail littéraire des particularités. Je me souviens, à la relecture de 1937
Paris-Guernica, avoir été ébahi par le nombre de fois où j’avais utilisé
l’expression « en bras de chemise ». a la réflexion, je pense que c’était un
moyen inconscient de me raccrocher de cette époque où les photographies montraient que
c’était souvent la tenue des ouvriers travaillant en été. Pour le roman qui va
paraître, c’est l’expression « hocher la tête », sorte de ponctuation
peut-être lorsque je sentais que mes personnages avaient épuisés tous leurs arguments,
leurs répliques. Plus important encore a été l’utilisation de « cela » avec sa
déclinaison en « tout cela » également. J’ai aussi une explication à cet usage
immodéré : j’ai tenté tout au long du texte de varier les angles de vue, aller
parfois au précis et au fond des choses et des descriptions, mais aussi m’éloigner
et tenter d’apporter un regard d’ensemble. Et c’est, à mon avis, lorsque
j’essayais de prendre de la hauteur que j’utilisais ces nombreux « cela », «
tout cela ».
La suite viendra avec les secondes épreuves et ce sera l’occasion de vérifier que
les corrections ont bien été prises en compte. Après, le texte voguera de sa vie de
mots.
(23/04/2010)

Deuxièmes
épreuves, premier épisode
Je suis dans l’attente. Je dois recevoir aujourd’hui le paquet des deuxièmes
épreuves. Ce ne sera peut-être pas moins de travail que pour les précédentes, car il
faut vérifier pas à pas que chacune des corrections a été prise en compte. Simplement,
il n’est plus temps de rectifier en profondeur sauf incompréhension manifeste
d’une tournure de phrase ou un de ces passages qui nous heurtent sans qu’on
sache vraiment expliquer pourquoi on achoppe en les lisant. En fait, c’est
s’enfoncer encore plus dans la réalité du livre que de relire ces deuxièmes
épreuves, c’est quitter le manuscrit, glisser vers le produit fini, le livre, celui
dont un exemplaire restera sur le bureau et qu’on regardera avec cet air un peu
distant comme un gamin trop vite grandi et qui vous échappe. Je n’ai pas toujours
participé à cette relecture des deuxièmes épreuves. Pour Bestiaire domestique,
par exemple, les corrections étaient minimes et la relecture moins nécessaire, le « bon
à tirer » qui suit traditionnellement les deux jeux d’épreuves avait été
délégué à l’éditeur presque sans m’en apercevoir. Là, c’est
différent puisque nous avons choisi de travailler directement sur épreuves à partir du
manuscrit de base parce qu’il n’y avait rien à reprendre au point de vue de la
structure. Mais j’avais fourni rapidement le texte et une multitude de coquilles et
de scories subsistaient, rendant les deux jeux d’épreuves indispensables.
J’attends donc le facteur qui doit passer aujourd’hui. Je suis à la maison et
j’aurai un peu de temps. Je me délecte déjà de m’installer sur la table de
jardin dans la chaleur de l’après midi et laisser glisser les heures jusqu’à
ce que les merles donnent le signal du soir par leurs trilles. La tonnelle est installée
depuis quinze jours, il n’y a pas que dans le midi qu’il fait beau et qu’on
peut manger sur la terrasse. Tiens c’est une idée, le plat d’endives au jambon
que je vais concocter pour mon beau-père et mon épouse sera servi dehors à midi. En
réalité, j’ai peu de temps pour relire ces deuxièmes épreuves. La maison
d’édition souhaitait faire le point vendredi mais j’ai une fin de semaine fort
occupée par le travail nourricier, Amiens et Lille sans possibilité de répit et sans
compter les huit heures de trajets aller et retour. Ce sera donc lundi prochain, dernier
délai. Avant si j’arrive à dégager quelques heures de nuit sans doute pour ce
travail. Il est vrai que le livre doit être recomposé dans sa phase finale après le
recollement des dernières corrections, et même si la parution est prévue pour
septembre, c’est largement avant l’été qu’il doit être finalisé. Il
faut aussi le présenter aux représentants commerciaux de la maison et j’espère que
je serai confié à cet exercice qui me ravit à chaque fois. Ainsi s’élabore la
cuisine éditoriale, par étapes successives. Hier j’ai découvert avec enthousiasme
le projet de couverture. Quelques jours auparavant nous avions réfléchi sur le contenu
de la quatrième de couverture, des mentions de biographies. Cette période où le livre
se concrétise est vraiment exaltante. Il est 10h30, que fait le facteur ?
(28/04/2010) |

Deuxièmes
épreuves, deuxième épisode
Deuxième épisode de ces deuxièmes épreuves tant attendues. Le facteur a bien entendu
profité que je descendais le repas à l'extérieur dans la tonnelle pour arriver et je
n'ai pas entendu la sonnette. J'ai foncé en voiture jusqu'au centre de tri où j'ai
réussi à récupérer in extremis le paquet avant la fermeture : avantage de vivre
en province ! Je ne me suis installé au soleil sur la table de jardin qu'en fin de
soirée et je n'ai pu vérifier qu'une centaine de pages sur les 295 que comptera le
livre. Les deux tiers restant ont été passées au crible de mon regard acéré le
lendemain, dans une chambre d'hôtel à Lille à l'occasion d'un déplacement
professionnel. C'est encore un moment magique que ces corrections. Autant il faut
vérifier que toutes celles qui ont été validées lors du premier jeu d'épreuves ont
été prises en compte dans le deuxième jeu. J'ai rajouté quelques rectifications de
dernières minutes, la plupart pour éviter des répétitions. Quelques points de
grammaires aussi que le Grevisse a résolu le lendemain(comme cette phrase avec, de
mémoire "tout un fatras de lignes téléphoniques " suivi d'un verbe qu'on peut
indifféremment conjuguer au singulier ou au pluriel - j'ai préféré le pluriel, plus
logique). Au total, il y a eu seulement vingt-cinq pages à revoir avec la maison
d'édition alors que la première mouture avait concerné une page sur deux. La
difficulté a été de terminer dans la soirée d'hôtel la lecture attentives des 200
pages qui me restaient à voir. J'ai terminé tard mais je tenais à pouvoir proposer le
lendemain les corrections à mon éditeur malgré un emploi du temps serré. J'ai profité
du temps de midi et j'ai même pu avaler en dix minutes un repas avant de reprendre mon
travail nourricier (c'est le cas de le dire). Depuis que j'ai relu ces deux jeux
d'épreuves le livre me paraît déjà moins flou, plus accessible. Étrange impression
car bien entendu, il n'est ni flou, ni inaccessible mais c'est la sensation que laisse
l'amnésie qui m'a séparé de l'instant de sa rédaction jusqu'à aujourd'hui. Amnésie
d'autant plus brutale qu'elle a été courte puis qu'en en réalité, il s'est déroulé
moins de trois mois puisque j'ai mis le point final le 9 février dernier. Affaire
rondement menée comme pour Bestiaire domestique et cet enjeu de rapidité m'apparaît
comme un signe d'efficacité de la part de ma maison d'édition. La suite des évènements
devrait continuer la semaine prochaine avec la réunion des représentants (et combien il
était important d'avoir fini le plus rapidement possible les corrections afin que les
épreuves finales puissent être remises aux représentants). Il me reste à préparer
cette intervention et à peaufiner un argumentaire. Suite du feuilleton éditorial un peu
plus tard...
(04/05/2010)
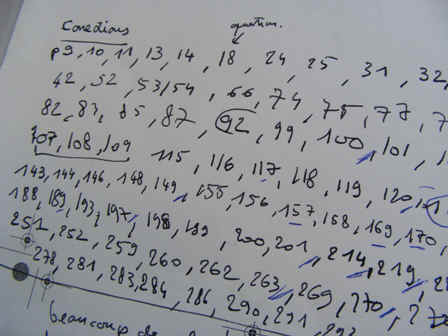
Suite des
aventures éditoriales : la réunion des représentants
Suite de mes aventures éditoriales : voici la réunion des représentants. A chaque fois
j’ai toujours beaucoup tenu à assister à la présentation de mon futur livre. Une
amie, également auteur, que j’ai eue la joie de visiter le même jour, me faisait
part de sa parfaite indifférence à ce qui doit resté selon elle, du domaine exclusif de
l’édition, réduite alors au commerce des livres. J’ai toujours eu du mal à
partager cet avis même si je comprends ses arguments puristes du genre, mettre en regard
la création inestimable de la littérature et sa réduction à des aspects marchands.
D’autant plus que, dans la plupart des cas, l’auteur est généralement le moins
bien loti dans la redistribution des subsides. Éternel combat de celui qui fournit la
matière première – le producteur de tomates, disait-elle pour argumenter son
raisonnement. En face, je lui répondais avoir toujours ressenti depuis la première
parution – il y a dix ans déjà – l’impression d’un travail
d’équipe dans lequel il m’est difficile de bâtir une hiérarchie entre
l’éditeur, l’assistant, l’attaché de presse, le manutentionnaire. Que mes
livres fassent vivre le plus grand nombre de ces métiers, après tout, cela me satisfait
et je réserve le même respect à chacun de ces métiers. L’argent ne
m’intéresse pas : j’exerce un autre métier pour vivre et c’est un choix
qui jusque là m’a permis de mener de front cette activité de la manière la plus
libre qui soit. Je n’attache aucune couronne de lauriers à la pratique de la
littérature et la récente visite de la chambre de Marcel Proust au musée Carnavalet
aurait fini d’ailleurs par achever le mythe, si toutefois il avait existé. A ceux
qui pensent encore que les lettres procèdent d’une substance créatrice divine, je
leur conseille d’imaginer le petit Marcel, bonnet de nuit sur la tête,
recroquevillé dans son lit et écrivant néanmoins quelques milliers des plus belles
pages jamais écrites. La création, malgré sa magie, n’est jamais pour moi
qu’une faculté bien modeste à agencer des mots entre eux – attention, cela
n’exclut aucunement la fierté et la prétention de le faire – simplement
j’ai toujours eu du mal à mesurer la portée, les prolongements que peuvent avoir
une publication. Et les sept livres parus jusqu’ici, leurs ventes modestes, ont
forgé une expérience qui ne remet pas en cause mon raisonnement. Ainsi, parler du livre
que je viens de commettre est une épreuve difficile pour moi, je suis un très mauvais
prescripteur de mes livres. Ils existent, voilà tout. Je les estime sans indifférence et
avec tendresse mais également avec étrangeté. D’où le difficile exercice de la
réunion des représentants. C’est lors de telles assemblées qu’on expose les
futures publications et ici, les livres qui formeront la rentrée littéraire de
septembre. J’avais préparé dans le train quelques notes mais, à peine introduit
dans la salle, alors que l’éditrice me proposait le choix de commencer d’abord,
j’ai eu la présence d’esprit de lui laisser la parole en premier. Et la
manière extrêmement brillante avec laquelle elle a introduit mon roman m’a laissé
pantois. J’ai refermé alors ma feuille et j’ai improvisé, laissant de large
moments d’intervention à l’équipe éditoriale. En réalité, mon argumentaire
s’était bâti sur l’intention et le cheminement qui m’avaient conduits à
écrire ce livre. Or, en entendant évoquer mon roman d’une manière si différente,
beaucoup plus narrative, j’ai réalisé que ce serait ainsi que le lecteur le
percevrait : une histoire, une fiction, un personnage principal et d’autres encore
que le texte fait exister autour d’une ambiance, d’une intrigue. A la limite,
j’aurais également aimé m’installer de manière anonyme dans la salle et
observer justement cette présentation, guetter les réactions…etc. Belle leçon pour
moi et qui me conforte encore dans l’importance de ce partage avec toute une équipe
éditoriale, n’en déplaise aux tenants d’un auteur fort, nimbé d’une aura
créatrice.
(14/05/2010)
Alors
voilà : j’ai couru
« La course est haletante. Il force sur les muscles, il insiste sur le souffle. Les
bras se déplacent comme des leviers de locomotive. Ses poings agrippent l’air,
tentent de le tirer derrière lui et d’avancer plus vite encore. L’eau calme du
canal, paysage habituel des entraînements, est aujourd’hui absente, sa tranquillité
horizontale est remplacée par un mur fuyant, coloré, tapageur. Des spectateurs
indiscrets et frénétiques s’agglutinent par paquets derrière des barrières de
sécurité. Par moment, dans le repos d’une rue déserte, on entend juste le
martèlement des foulées, la respiration de forge du ruban des coureurs. Puis les cris
reprennent. Ici c’est une famille qui encourage un participant, lequel répond avec
force signes. Là c’est un entraîneur, chronomètre à la main, qui hurle des mots
incompréhensibles. Les foulées, jusqu’à présent contrôlées, s’emballent au
rythme d’une cavalcade qui l’enserre de tous côtés et accélère sans cesse. A
sa gauche un grand type le dépasse, suivi de deux autres plus petits dans son sillage. Il
rattrape devant lui un coureur en maillot orange, fait un écart et le double en
accélérant encore. Le sang cogne à ses oreilles. Les cris des spectateurs derrière les
barrières se font plus pressants. On entend des prénoms, des applaudissements.
L’angle de la rue révèle un faux plat qui tire douloureusement les mollets et coupe
la respiration. On le dépasse encore. Il résiste, tente de modifier le rythme de
l’air qui pénètre en lui : expirer profondément, inspirer vite et avec force.
»
Cet extrait raconte exactement la course à laquelle j’ai participé récemment. Il
débute le dernier chapitre du livre à paraître (p. 291-292). Écrit en février de
cette année, il précède la réalité d’un peu plus de trois mois. C’était à
mon sens la première fois où j’écrivais par anticipation un évènement dont je
savais qu’il allait se dérouler et auquel j’espérais participer. En réalité,
toute l’écriture du livre, les réflexions d’avant, les corrections des
épreuves auront été marquées par les séances d’entraînement étroitement
mêlées à mon quotidien. On en retrouve aussi des traces émaillées dans le récit mais
elles auront été écrites d’après des impressions vécues et non par anticipation,
comme c’est le cas pour l’extrait ci-dessus. Par exemple, la sensation des
bruits de la course, devenus familiers : « […] il part courir avec seul les
bruits du dehors qui lui parviennent, une annonce de train sur les quais de la gare, un
peu de circulation au rond-point, enfin le calme du canal, quelques oiseaux et, dans les
trous du silence, les chocs réguliers des chaussures, claquements mats sur le goudron,
crissement du gravier sur les trottoirs, chocs plus mous sur le sentier de halage, la
respiration en métronome. » (p.144)
Courir est finalement une manière de réfléchir à l’écriture et c’est aussi
une allégorie particulièrement juste de la littérature, des phases «d’inspiration
», de restitution, donc d’expiration, tout ce qui rythme le travail au long court
d’un roman. Pour autant, cette facette sportive, les extraits présentés, ne
représentent que très peu de choses dans la vie du personnage principal auquel il
s’adresse et que j’ai inventé. Mais c’est pour lui une manière de se
reconstituer, de se retrouver et de s'agglomérer à nouveau au fil d’une intrigue
qui le bouscule. Au moment où faisait rage le débat sur l’identité nationale, il
me semblait que l’unisson autour de l’invariant d’un corps humain scandé
par le souffle de la course prenait une valeur symbolique nouvelle. C’est pourquoi
ces brèves parenthèses sont des détails indispensables, indissociables dans l'écriture
de mon livre.
(02/06/2010)
L’épaisseur du personnage
J’ai reçu un avis pour Colissimo. Je suis allé à la Poste.
Belle journée, un samedi matin, une place juste à côté et deux personnes attablées à
la terrasse d’un café qui me regardaient effectuer mon créneau avec la petite
voiture, son toit ouvrant ouvert et le soleil entrant à flots dedans. Belle journée.
Alors le colis : une jeune employée souriante remonte la file d’attente pour aider
ses collègues et, devant mon avis d’absence, ça je peux faire ! Donner alors la
pièce d’identité, attendre et recevoir l’enveloppe kraft. On devine que
c’est un livre. De suite on pense à l’envoi d’un auteur qu’on
connaît, un service de presse. Ça arrive rarement mais à chaque fois, grande joie de
savoir que le dit auteur a pensé à moi. Je prends le paquet, sort. Soleil toujours sur
les trottoirs. En face, la petite voiture et derrière toujours les deux consommateurs
attablés dans la farniente du samedi matin. Alors, juste avant de traverser, enfiler la
clé de la voiture dans un coin de l’enveloppe Kraft, déchirer le papier et sortir
le livre. Le mien ! Presque déçu du coup qu’aucun autre auteur n’ait pensé à
m’envoyer un livre. Le mien, je le connais. Occupe toutes mes pensées et mêmes si
les choses se précipitent, déjà un rendez-vous et déjà le service de presse dans deux
jours. Ça aurait pu attendre lundi, j’aurais découvert mon livre, le huitième. La
voiture maintenant, revenir. Décharger les commissions faites auparavant et le fils qui
aide : ah, tu as ton livre ! Et remontant précipitamment l’escalier avec le bouquin
pour le montrer à sa sœur, me laissant avec toutes les commissions à prendre. Oui,
le livre donc. Ils auraient pu attendre lundi mais en même temps, ce plaisir qui
s’installe : le livre, le huitième, objet de toutes les attentions du moment. Ce
sera mon exemplaire. J’ai toujours pris un soin maniaque de choisir mon exemplaire.
Jusqu’à présent, j’ai toujours découvert les autres livres à l’occasion
du service de presse : alors la profusion d’une palette érigée sur la table. En
prendre un exemplaire, le premier, lire son nom, le feuilleter le soupeser, la joie. Et
faire de ce premier exemplaire touché, l’exemplaire à jamais, celui qui rejoint le
coin gauche de mon bureau. Donc, le dernier, posé au-dessus de la pile et la pile
dressée par ordre chronologique, le premier (La Réserve, de mai 2000) directement sur le
bois de merisier du bureau. La pile, exactement seize centimètres de haut. Plus tard dans
la journée je dirais à mon fils : regarde, je ne peux plus les prendre dans une seule
main – en fait si, mais les phalanges tendues au maximum, un équilibre instable, les
saisir mais pas les porter. Et tiens combien ça pèse ? Exactement 2kg 700 grammes, 1914
pages au total comptées à la volée, sorties de mon imagination. Et le dernier, celui à
paraître en septembre, à nul autre pareil jusqu’au prochain qui le remplacera, le
dernier, récupéré à la poste, pris par le fils, montré, posé sur la pile, repris par
moi cette fois pour aller dehors – pas trop le temps mais juste un instant –
s’asseoir sur le fauteuil de jardin, tiré un peu à l’ombre, il fait si chaud
déjà. Et retourner le livre, sa blancheur mate, les pages éblouissantes sous le soleil.
Lire un peu, les premières pages, les mentions, la page de titre, la longue phrase de
Proust en épigraphe, le premier chapitre. Puis revenir à la maison, poser à nouveau le
livre sur le sommet de la pile. Puis le bricolage à faire : deux appliques à fixer dans
le nouveau studio. Elle arrive de son travail quand je finis. Le chou aux saucisses de
Morteau que j’ai mis à mijoter depuis le matin est prêt mais il y a deux ou trois
fruits à aller chercher, donc elle repart avec les deux enfants. Je reste et je reprends
le livre à nouveau dans le bureau, juste quelques pages de plus, calé dans le petit
fauteuil rose de la pièce puis le reposer à nouveau, descendre les assiettes et les
couverts sur la table sur la terrasse en attendant qu’ils reviennent. Remonter pour
remuer une dernière fois le chou, mettre les knacks à chauffer. Le beau-père qui
arrive. Sa lourdeur dans les jambes. Il fait vraiment chaud aujourd’hui. Il reste
dans la fraîcheur de la cuisine à lire le journal. Redescendre et dresser la table sur
la terrasse en attendant qu’ils reviennent. Et revenir dans le bureau, prendre le
livre sur la pile, les lunettes de soleil, cette fois torse nu au soleil, parcourir
jusqu’au chapitre cinq. Le signe par la fenêtre, on est revenu. Le déjeuner, le
café, la chaleur. Puis se changer, troquer short et tee-shirt pour un bermuda long et une
chemisette, aller à la foire commerciale dans le parc ombragé pas très loin. En revenir
avec une nappe et quatre saucissons. Il est tard déjà, pas fait grand chose, tenter
d’avancer un peu sur cette communication universitaire, le fameux doctorat qui avance
si peu. Et penser à tout ce qui m’attend, ce livre nouveau, ce qu’il faut en
dire, en rêver. Laisser courir d’un trait les heures, repas salade vite préparé,
assez tôt parce qu’elle joue dans un concert ce soir. On sait déjà quoi faire pour
la soirée à venir, vite la vaisselle, arroser les plantes et redescendre dans le bureau
saisir à nouveau le livre sur la pile, aller dans le jardin maintenant à l’ombre du
soir, lire, lire, lire à partir du chapitre six et parcourir rapidement moitié
peut-être du roman. Des merles dans le crépuscule et moi, allongé sur le fauteuil de
jardin, lisant mon propre livre, regardant se débattre le personnage principal dans mon
histoire, inventée, sortie de ma tête. M’apparaît alors enfin que lui, ce
personnage principal, tout l’univers qu’il trimbale, palpable, tangible, lui, le
personnage principal me semble pour la première fois doué d’une épaisseur plus
grande à force de mes relectures. Décide donc sur le champ d’écrire cela en note
de lecture. Fait en une demi-heure, ce samedi soir, sans aucune retouche à ce texte.
Voilà, le personnage principal s’est épaissi. Il existe. Entre temps la nuit est
tombée.
(10/06/2010)

exemplaires d'auteurs
|