|
Central
Nouveauté de novembre 2005 : Retour à Central
Central est paru aux Editions Fayard en août 2000.
des critiques : m-à-j 31/01/2001 et les Interventions de la rencontre littéraire à l'université de Toulouse
L'article de Serge Bonnery sur
Chantier.org
Article de Marcel Marty
(La voix du regard, sept 2001)
Ce qu'on en dit sur
Bol.fr et la Fnac : (juillet 2001)
L'interview
de Christian Authier de l'Opinion Indépendante - Toulouse le 12/01/2001
La revue des livres sur le monde Internet, par Ariel dans internetactu
Article
de Christian Authier (L'opinion indépendante - Toulouse - le 22/12/00)
L'article de Tanguy Viel
Dans Inventaire/Invention
Interview dans
Liberation-Maroc par Mohammed Boudaharam
La critique de librairie-on-line
L'article
de Thomas Day (Urbuz) publié dans l'actualité littéraire de Yahoo (novembre 2000)
Le Monde, par Hugo Marsan,
vendredi 17 novembre 2000
L'interview de Gilles
Bertin pour Ecrire Aujourd'hui
Et la critique de
Gilles Bertin pour Ecrire Aujourd'hui...
NOTES Bibliographiques (novembre 2000)
Franck
Mannoni " le Matricule des Anges, n°32 "
Epok, octobre 2000 Merci à Epok pour
m’avoir attribué la note qualitative maximum !
Joël Schmidt,
Réforme du 28 septembre au 4 octobre 2000
PO et HCB, Perso,
vie publique vie privée, septembre 2000
AG - Courrier Cadre du 22 au 28/9
Fabrice Gabriel, les
Inrockuptibles, 29/08/2000
L'est républicain, 3 septembre 2000
Patrice Lemire, L'Echo
de l a Haute-Vienne du 02/09/2000
Les
inrockuptibles, numéro 253, spécial rentrée littéraire
Le Figaro Littéraire, jeudi 31août
2000
Marianne, 11/09/2000
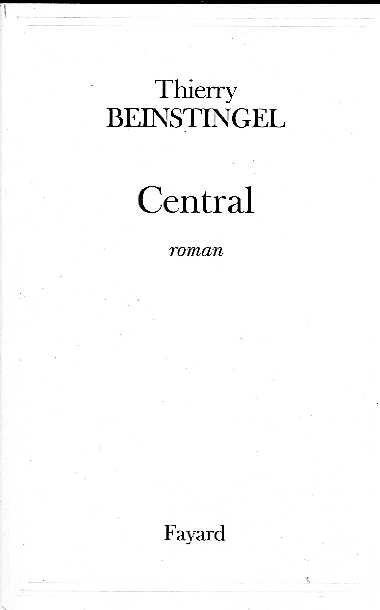
Il a travaillé de longues années au Central des télécommunications, s’est dévoué pour l’Entreprise. Mais il y a vécu également les grandes étapes de la déshumanisation du travail.
Témoin cette " Description d’emploi ", formulaire que chacun se doit un beau jour de remplir en puisant à un " Glossaire des verbes " afin de décrire son activité avec le plus de précision possible. La suite de la carrière en dépend. Ces verbes, on les emploiera de préférence à l’infinitif ou à la troisième personne du singulier sans mentionner le pronom personnel. Des verbes sans sujet, donc.
Sans sujet ? Ce jour-là, le narrateur se jure d’être lui aussi implacable, d’écrire un roman peuplé de verbes sans sujet, de retourner à l’anonyme concepteur de cette insulte à l’humanité la violence de son acte. Il en résulte cet étonnant roman de l’incommunicabilité au cœur de la communication où plus personne, bientôt, ne répondra à personne. retour haut de page
Le tract de la grève, l'avoir gardé. Dans ma manie toute récente de chercher des preuves palpables de cette chose impalpable, le travail. Ne plus pouvoir me contenter des pensées invisibles, aléatoires, cognées contre la boîte crânienne dans le noir des nuits de dimanche à lundi. Vouloir en sortir. Percer l'os. Ne trouver que ce subterfuge dérisoire de pouvoir prendre dans une poche ce tract de couleur mauve, écriture sur une seule face. Le relire, le respirer, le laisser sur un coin de table, le reprendre, le voir, sentir le poids des mots, l'insignifiance du papier, être devant quelque chose, un truc existant.
La grève. A midi, voir le piquet devant la grille en arrivant à la cantine. Feu. Palettes incontournables attendant d'être brûlées. L'impression d'une horizontalité sur la moquette rase des herbes, même le feu n'arrivant pas à grimper, flammes discrètes. Pourtant des hommes debout, moins d'une dizaine, les fanions de deux syndicats flottant au vent glacé. Comment un syndicat pouvant décider la fabrication de tels drapeaux dont l'utilité ne peut être que revendicative, planqués au milieu d'une manifestation ou placés en arrière-plan d'un piquet de grève. La direction — et pas mal de cadres un peu lèche-culs — s'en offusquant, car le fait même de s’assurer de tels drapeaux indiquant le refus de négocier. Eux, les syndicalistes, y voyant au contraire un signe de transparence. Pas d'accord, alors le montrer à tous et en dehors des murs d'un bureau capitonné marqué par les rouages subtils et démultipliés de la négociation.
Tenté un moment de passer par le parking et puis non, ne pas fuir, ne pas chercher l'évitement, ce malentendu alors que me sentant si proche. Et pourquoi ? Préférer les hommes debout, faibles devant les tonnes carrées de brique, l'arrogance du bâtiment et le symbole de la prospérité. La prospérité pour tous sauf pour celui qui, debout dans le froid, mains dans les poches et poussant du bout du pied une planche calcinée pour la remettre dans le feu. M'approcher. Quelques objets à terre invisibles dans des cartons, certainement des pétards, cornes de brume. Une caméra FR3 posée sur le macadam. Chercher le journaliste. Dans ce groupe de trois discutant ? Deux autres se tournant face à moi. Deux pas nonchalants dans ma direction. L'un s’assurant du tract sur papier violet à me remettre. Combien de fois ce couple ayant répété les mêmes gestes depuis ce matin, le jeté tranquille des jambes sous le jean, chaussures basses de cuir marron raclant l'asphalte, prise de la feuille malhabile, avec de gros doigts sur le sommet du paquet ? Bonjour. Bonjour. Et puis rien, eux tournant déjà la tête pour répéter le geste vers d'autres arrivants et moi, baissant la mienne pour lire le papier revendicatif. Communiquer par l'écrit, aucun mot échangé, battus d'avance, eux et moi, comme si personne ne croyant récolter un grain à cette grève.
Pourtant, me souvenir de quelques débrayages plus importants et l'allégresse prenant ceux raflés dans les bureaux et décidant de suivre la cohorte grandissante des mécontents, écumant couloir après couloir, pièce après pièce. Et tout de suite, l'ambiance devenant joyeuse, potache, l'impression de faire un pied-de-nez à son chef en s'excusant aussitôt, sauf votre respect. Le tout durant deux ou trois jours, s'amuser ainsi de voir ceux qui, au pied du mur, n'osant adhérer, les fayots, les timides, ceux se révélant. Me souvenir de cette collègue, belle femme, pas remarquée auparavant et placée en avant de tous, comme celle qui, portant le drapeau, un sein à l'air sur l'arc de triomphe ou les billets de banque. Après la gaieté, souvent la lassitude prenant très vite et les dérangés des bureaux décidant de retourner sur leurs chaises, furieux d'avoir été bousculés, résignés et passant leur mauvaise humeur sur leurs collègues. Mais en ces temps, pourtant, chacun ayant parlé à son voisin et pas seulement par des tracts. Certaines discussions allant loin, des coups de bluff mêlés à la vie. Ne pas se laisser faire. Que faire à manger ce midi ? Lui (et montrer du doigt ou nommer) étant un suppôt du pouvoir. Moi, les tournedos, les préférer bien cuits.
Donc là, pour tout dialogue, courber l'échine et lire le tract (et maintenant pouvoir le relire puisqu’ayant gardé la chose palpable). Titre : la coupe pleine ! La littérature de colère avec des points d'exclamation, des phrases assassines, des expressions coupantes comme des rasoirs, des aigreurs d'estomac, des mots outragés. Chaque paragraphe débutant par une flèche comme un étalage d'arguments pour le lecteur et ainsi voir comment les plaignants étant bernés. Pourtant n'en rien retenir. Ne pas savoir les revendications. Trop de mots insipides empruntés à l'Entreprise et dénués de sens. Les phrases expliquant pourquoi la grève et quel service étant concerné, mais glisser sur les tics de langage que la boîte inocule à ses employés par la méthode Coué. Oublier vite les mots : optimisation, fonctions transverses, adéquation effectif-trafic, déploiement, fusion, challenges, spécificités. Oublier le langage syndical, les expressions toutes faites : le sacrifice sur l'autel de l'économie, les dérives abusives. Ne retenir que les mots de lassitude, les adverbes souvent parlés, rarement écrits, et remercier le rédacteur de les avoir essaimés ici : la conjonction "et" placée devant chaque paragraphe, son bruit de goutte d'eau de plus pour faire déborder la coupe du titre ; les expressions : comme toujours, la moindre des choses, le temps de dire stop, mériter mieux que le mépris. Dans "vers une nouvelle dégradation notable de nos conditions de travail", ne regarder que "notable" comme important, et la chose qui s'imprime jour après jour dans les souvenirs, cette rancœur notable, un jour tout devant ressortir dans le feu des palettes.
Parti après le repas pris à la cantine. N'être pas passé devant eux. Le vent ayant forci et les fanions claquant au vent, les hommes debout devinés derrière la grille.
L'article de Serge Bonnery sur Chantier.org
Un roman étonnant. Un roman détonnant. Enfin,
osera-t-on dire, car peu de livres m'ont autant touché ces dernières années.
Un roman détonnant. Je veux dire un objet comme on n'en a pas tous les jours entre les
mains. Quelque chose qui se détache du fond grisâtre et forcément se remarque, se
distingue de lui-même, mû par la force propre à son contenu et non jeté sur le marché
littéraire comme un paquet de lessive à grands coups de critiques trop positives pour
n'être pas suspectes et de publicités par définition mensongères.
Un roman étonnant qui se tient droit, ne baisse pas la garde, ne cache pas son visage,
fleurit avec bonheur dans votre jardin-bibliothèque, posé là maintenant dans la rangée
réservée à ce que vous avez le plus aimé côtoyer pendant un temps et auquel vous
ferez forcément retour. Un premier roman qui pour un coup d'essai ne prend pas les
allures factices d'un coup de maître. Il suffit de fréquenter régulièrement le site
internet de son auteur pour mesurer la part d'hésitation, de doute, de remise en question
permanente qui l'habite… bref, tout ce qui vous conduit peu à peu penser que vous
vous trouvez, là, devant un authentique écrivain, un de ceux qui ne craignent pas
"d'aller au charbon". De risquer quelque chose. De se risquer.
C'est là la véritable valeur, à mes yeux, de Thierry Beinstingel qui, avec Central, son
premier roman sorti en l'an 2000, a commencé le marquage d'un territoire d'écriture au
rythme de la marche forcée que nous impose l'écriture et face à laquelle, bien souvent,
nos chers auteurs se dérobent petitement.
Il est probable que tout ira bien en 2002 pour Thierry Beinstingel puisqu'on annonce son
second roman, toujours chez Fayard, sous le titre : Composants. Mais nous n'en sommes pas
encore là, même si on peut déjà en découvrir un extrait inédit sur le site
remue.net.
Restons donc encore un peu dans la compagnie de ce Central où, dès les premières pages,
s'impose une écriture. Une écriture contre l'anonymat. Une écriture contre le refus de
nommer qui relègue l'individu à l'arrière-plan du système dont il n'est qu'un…
composant, comme on dirait d'une puce dans nos laboratoires informatiques.
J'ai lu Central comme un formidable contrepoids à tout ce qui courbe notre trajectoire en
la tirant insidieusement vers le bas. J'ai lu Central comme une tentative exaspérée
d'inverser cette tendance par trop généralisée. Et si j'ai tant aimé lire Central de
cette manière, c'est que le texte de Thierry Beinstingel fabrique sa propre
justification, puise dans sa forme même l'énergie du mouvement ascensionnel qui l'habite
en profondeur.
Je ne dirai pas ici l'histoire que l'écrivain raconte. Dans Central, il y a l'Entreprise
avec un grand E, entendez la machine qui facilement vous absorbe, au mieux vous met en
conserve, au pire vous broie sans sourciller. Et dans cette Entreprise, il y a le
narrateur. Son regard, d'une rare lucidité.
En retournant les mots de la tribu contre sa logique même avec l'emploi permanent des
verbes sans sujet qui étaient jusqu'ici l'apanage des formulaires et auquel Thierry
Beinstingel donne, pour la première fois, le statut d'insulte à l'humanité, Central dit
le refus du pire. C'est pourquoi, à mes yeux de lecteur, ce texte est important. Et c'est
pourquoi j'y fais retour, souvent. A vrai dire chaque fois que je me sens rattrapé par la
machine à broyer et que je dois courir plus vite pour lui échapper.
Il est des livres qui fonctionnent comme de véritables accélérateurs. Des livres qui,
à défaut de vous faire gagner du temps, ne vous en font pas perdre. Aux "mots
économisés d'une société économique", Central oppose "le pouvoir des
mots". Les mots comme un contre-pouvoir, comme un contrepoids à la fuite en avant
imposée par nos systèmes. Thierry Beinstingel parvient, avec Central, à sauver les mots
de tous les détournements dont ils sont l'objet. Thierry Beinstingel les rend à leur
toute puissance et avec lui, la littérature compte désormais un écrivain de plus dans
ses rangs !
© Serge Bonnery
Article de Marcel Marty (La voix du regard, sept 2001)
On reconnaît aisément dans Central tout ce qui
constitue l’univers d’une " grande entreprise de communication " : ses
différentes composantes spatiales (le grand Central, les petits centraux de campagnes, la
Direction), son histoire propre qui, du " technique " au " commercial
", a transformé le " Service du personnel " en " Direction des
Ressources Humaines ", histoire elle-même prise dans l’Histoire ; ses hommes
enfin, de la femme de ménage au directeur. L’on reconnaît aussi tout ce qui en
constitue le fonctionnement quotidien : tâches techniques, réunions séminaires, crises,
travail et pauses, action et inaction. L’on reconnaît enfin les différentes étapes
d’une carrière, celle d’un employé comme les autres : neuf ans de "
Central ", passage à la Direction, aujourd’hui promotion de l’Internet .
Mais gardons-nous d’emblée d’une quelconque identification au réel, celle là
même qui tue l’œuvre avant de la laisser exister : Central rappelle
explicitement que le roman ne " (fait) pas du journalisme ", ni ne donne de
" photographie " de la réalité, mais fait advenir une réalité autre.
Roman de l’effarement, de la volonté de " rester éveiller "
(c’est ainsi qu’il faut interpréter le leitmotiv de l’insomnie, ces
obsédantes " nuits de dimanche à lundi ", qui ouvrent presque chacun des 21
chapitres), Central s’attache à montrer la déshumanisation qui est à
l’œuvre dans une entreprise pourtant moderne (si ce n’est " modèle
"). Celle-ci est décrite comme un Moloch dévorant à la " bouche pleine
", et i est manifeste que l’aliénation, comme consubstantielle au travail,
transcende l’Histoire malgré les prétendus progrès : les " esclaves et les
négriers " n’ont pas disparu et il est bien vivant " ce travail à la
chaîne d’un nouveau genre, et guère plus reluisant que les premières lignes
crasseuses ayant produit la Ford T au début du siècle ". Le roman est ainsi
sous-tendu par les réseaux métaphoriques de la dévoration et de la tératologie ("
un monstre (faisant) de nous des monstres " ), de même que par celui de
l’incarcération, aux consonances fortement kafkaïennes, une incarcération à
laquelle le narrateur doit coûte que coûte échapper (" Peut-être n’avoir
vécu toutes ces années au Central pour n’en retenir que ces évasions ").
Labyrinthe, dans les premiers chapitres, l’entreprise est plus loin " geôle
", théâtre d’ombres où l’on meurt à soi-même : " ombre morte,
n’accrochant rien, traînée comme un chiffon, tuée dans l’abandon du lieu
" ; mort à laquelle l’image récurrente de la mutilation n’est pas
étrangère, quelques soient ces formes : " scies circulaires ", "
guillotines ", obsédants " tranchants ". Au-delà de la privation de nom
(symboliquement aucun personnage n’est nommé, ni même les lieux), le motif majeur
de l’aliénation est certainement la " description d’emploi " : grille
d’explicitation, anonyme et jargonnante, lourdes de mensonges, de non-dits et
porteuse d’une langue dérisoirement fictive, elle est un gaufrier monstrueux dans
lequel l’ensemble du personnel doit passer, un texte ici fondateur dont le roman veut
dire et redire, coûte que coûte, la scandaleuse absurdité. Ce texte, que l’acte
romanesque pose comme " pré-texte ", donne toute sa justification à
l’utilisation d’un procédé grammatical, d’une forme-sens
(utilisée, ici, avec une virtuosité réelle mais discrète) : en effet, "
entreprise qui n’eut jamais d’exemple ", le roman met tout en œuvre
pour éliminer autant que faire se peut les marques grammaticales de la personne ("
jurer d’écrire un jour avec la même puissance des verbes sans sujet "), au
bénéfice de l’infinitif, des formes participiales des verbes et des phrases
nominales. On peut voir dans la narration à la deuxième personne, telle qu’elle a
été pratiquée par Butor dans La modification, un jeu sur les relations
narrateur/personnage et, surtout narrateur/narrataire : dans un même mouvement, le
narrataire est placé au centre du récit, mais immédiatement mis à distance, car le
" tu " du personnage ne peut-être le " tu " du lecteur. Ici, la
dépersonnalisation est une forme qui acquiert une toute autre signification : elle
ne porte pas sur l’essence du romanesque et les relations narratives, mais se veut
existentielle.
Si l’entreprise est prison (" neuf ans de Central ", cela sonne
comme " neuf ans de Centrale "), il faut donc " écrire pour (soi)
s’évader ", seul moyen aussi de retrouver les autres, de leur redonner vie,
" faire l’inventaire de la trace des hommes ", " vous, ces humains,
tout simplement mes semblables, et non des choses de l’entreprise ".
Parallèlement, il convient d’aller au-delà des apparences, ( "dépasser le
stade de l’apparence du monde ") , une quête que l’on dirait
consubstantielle au genre romanesque lui-même ; il convient pareillement de questionner
et de mettre inlassablement en doute la tyrannie de ce qui est : ainsi faut-il lire les
nombreuses questions qui scandent le texte (" à quoi bon cette mascarade ? ",
" pourquoi la naissance et pourquoi la vie et pourquoi la mort ? "). On ne
s’étonnera pas que cette quête du sens acquière finalement une dimension
théologique : si celui qui examine l’entreprise est désormais un homme sans
idéologie, c’est aussi un homme sans transcendance, qui ne peut comprendre " ce
qui fait marcher la machine ". L ‘entreprise " mise en forme "
utilise, certes, cette absence pour générer une fausse religion comme l’atteste le
lexique récurent du sacré (" rituels ", pèlerinages ", " reliques
", " apôtres ", " prophètes ") ; cependant, le travail du roman
consiste justement à mettre en lumière cette falsification, cette " superstition
", et à montrer que les questions demeurent nécessairement sans réponse : "
être mangé. Par qui ? Par l’entreprise ? Le capital ? Et derrière les ficelles,
qui ? Mais qui donnant les ordres ? "
Si l’entreprise décrite dans Central est entièrement voué çà la
transmission de mots (ces mots infinis, innombrables, qui transitent par le téléphone ou
l’internet), l’entreprise que reconstruit la fiction est elle-même faite
d’histoires, faites de mots, " monde de paroles ", " texte à lire
". Deux phrases de Central semblent se répondre ici : d’une part,
l’entreprise génère ses " acte(s) littéraires ", sa propre "
littérature, soumise à des règles induites (…) mais littérature quand même
" ; d’autre part, cette question " comment une entreprise inadaptée à la
littérature pouvant fabriquer une telle puissance de mots ? ". Central est
dons aussi une méditation profonde sur le pouvoir et l’utilisation du verbe : avant
tout une réflexion sur le dévoiement des mots, mais aussi de leur pouvoir positif,
pouvoir de revivification, de recréation. Il y a des mots légers " solubles dans
l’air " (écho à Verlaine), comme des mots lourds ; il y a en eux une part
fondamentalement négative et positive que le roman veut dévoiler. Les mots sont partout
dans l’entreprise et celle-ci, à travers ses notes de service, sa phraséologie, ses
jargons " inimitables " ou " psycho-hermétiques ", ses phrases "
insipides " ou " mielleuses " (" le sucre des mots choisis "), se
nourrit de mots. L’internet et la communication ? De " grands mots, lâches et
lâchés ". L’entreprise est donc elle-même mise au service du dévoiement des
mots, symbole à elle seule d’une communauté qui ressasse l’antienne "
société d’information et de communication ", sans mesurer son désarroi
beckettien : " des mots de plus en plus légers circulant par milliers dans
l’air ou les fils de cuivre. Moins de réflexion, parler pour ne rien dire.) De
surcroît, le prétendu contre-pouvoir syndical répond à la phraséologie de
l’entreprise par les même mots dévoyés : le roman se doit donc de chasser et de
dénoncer avec vigueur les truismes (" ne pas se laisser faire, halte à la casse !
"), ces mots vidés de leur sens et de leurs poids, " outragés ", "
tournés et retournés comme des chaussettes ". " Mort aux mots ",
crie-t-on, au centre du roman !
" Oublier les mots " pour les retrouver ! Aux mots vidés, perdus, il
faut opposer les mots " magiques " : " se souvenir des mots magiques :
nourrice pour apporter le gasoil au moteur, cour anglaise, sorte de trappe grillagée
permettant le déménagement du groupe ou des batteries. Nourrice, cour anglaise, Nourrice
anglaise, cour de jeux. Tendre vocabulaire. Rêver dans ce monde de boulot. ". "
Rêver ", " rêve " : voilà deux mots qui avec " imagination "
et " imaginer " scandent le roman. Ainsi, comme du Rien peut naître le Tout
(une autre opposition structurante du roman), la poésie peut naître du quotidien, ce
presque rien, " friselis d’ennui ou de mélancolie, mais tellement vital ".
Lors d’une exposition sur l’histoire du téléphone apparaissent quelques
auteurs, romanciers ou poètes, qui ont évoqué le téléphone et sa magie : tout
particulièrement Proust, Rimbaud, Ponge. Trois noms incongrus ici ? Non : ils sont comme
autant de " clefs " pour lire l’œuvre. Si le roman est, à sa
manière, travaillé par une " recherche du temps perdu " d’un nouveau
genre (la scrutation du temps est omniprésente : " pouvoir regarder la fuite du
temps ", examiner la substance après le goutte à goutte des secondes "), on
mesure aussi combien, dans un superbe paradoxe, la vision d’un " réel trop
réel " est taraudée par la poésie. Ecrire, c’est " [se] rapetisser
" mais aussi " laisser les mots [se] grandir ", les rendre " solubles
dans l’air ", partir avec des " semelles de vent " à la recherche de
" l’illumination " (échos rimbaldiens bien sûr) ; écrire, c’est se
tenir coûte que coûte dans l’étonnement : " étonnement de découvrir cette
sorte d’aliénation de l’esprit, entièrement vouée à la normalité des
choses, au respect des lieux et des virtualités ". L’étonnement est la posture
du philosophe, mais aussi du poète, qui seul peut approcher le Tout, ou unir les
contraires. Dans cette double exploration, des mots et de l’entreprise, on peut donc
ressentir simultanément la " colère et la tendresse ". Colère et tendresse :
sans doute les deux tonalités dominantes du roman, une fois le volume refermé.
Ce qu'on en dit sur Bol.fr
et la Fnac : (juillet 2001)
L'avis de la
FNAC
Une entreprise de télécommunications
demande un jour à ses employés de
remplir un formulaire de description
d'emploi, en utilisant exclusivement les
verbes à l'infinitif qu'ils trouveront dans le
"Glossaire" spécifique. En réponse à
cette inhumanité, le narrateur entreprend
de rédiger un roman à l'infinitif. Paradoxe
suprême que cette entreprise
spécialisée dans la communication
devenue le siège de l'incommunicabilité.
Car le résultat est là, barbare,
angoissant, voire étouffant : un roman
tout entier privé de sujet, qui ressemble
étrangement à certains cauchemars
engendrés par notre société. Écrit par un
cadre des télécommunications (!), un
premier roman qui coupe le souffle et
attaque là où le bât blesse.
La critique dans Bol.fr
"Dans un monde déshumanisé, le sujet disparaît. C'est littéralement ce
qu'opèrel'auteur de ce premier roman, en décrivant l'univers du travail et son
aliénation par desverbes à l'infinitif, au participe passé ou présent, mais toujours
sans sujet. Cetexercice de style n'a pourtant rien d'abscons. On ressort subjugué par
l'efficacité decette écriture à nous entraîner dans le cauchemar qu'elle entend
dénoncer." Eric Lamien
Franck
Mannoni " le Matricule des Anges, n°32 "
Dire l’Entreprise. cadre dans une société de télécommunications, Thierry
Beinstingel a puisé dans un monde qu’il connaît bien pour inspirer l’intrigue
de son premier livre. Décrire Central ? Un récit, une progression en spirale de la
périphérie vers le centre. Partant de quelques événements anodins, progresser vers
l’oeil du cyclone : un endroit calme, la clarté enfin découverte. Au départ
de ce mal être, une injonction administrative venue des hauteurs de la Direction :
effectuer une "description d’emploi " - définir son utilité - et,
pour ce faire, n’employer aucun sujet, que des verbes à l’infinitif, nommer
l’action plutôt que de la vivre, gommer toute personnification, toute référence
humaine au salarié. Dés lors, pour le narrateur, un véritable blocage, une révolte,
une envie d’écrire un plaidoyer contre le procédé, révélateur de toute une
idéologie. Pour être efficace, utiliser les mêmes armes que l’adversaire et
"renvoyer la balle... le rouge du langage guerrier... se venger, oublier écrire...
Echapper aux mots vides à force de rabâchage... Comprendre la marche du monde et du
temps... trouver la clé de mes insomnies de mes nuits de dimanche à
lundi... "Et s’interroger : " comment une entreprise
inadaptée à la littérature pouvant fabriquer une telle puissance de mots.
" Ne pas oublier d’évoquer les évolutions subies : la privatisation,
dire "l’ouverture à l’économie privée ",
l’informatisation, la préretraite : avancées-reculades. Penser à énumérer
les moyens les plus sûrs pour faire vivre "les métiers inutiles : la réunion,
le groupe de travail ou de réflexion. Ecorcher la sacro-sainte et très éloignée
Direction faite de "luttes intestines, fayotages... dans le souci de chacun de
défendre sa part de souveraineté. " Réussir à faire jaillir
l’émotion de phrases tronquées, apparemment privées de toute vie, montrer que le
style naît de la contrainte et que d’un mal, toujours, le bien peut surgir.
Epok,
octobre 2000
Au commencement était le verbe, le sujet n'est venu qu'après. Tant de siècles plus
tard, il a toujours autant de mal à s'implanter face à la marche du monde, cette lourde
machine collective qui sacrifie aveuglément des millions d'humains pour simplement
tourner. Un beau "roman d'entreprise" qui tente de redonner à l'humain une
place centrale dans un monde d'alénés fixés à leur bureau.
Joël Schmidt,
Réforme du 28 septembre au 4 octobre 2000
De la déstructuration.
Central, de Thierry Beinstingel. Un roman qui pourrait réjouir les sectateurs de
l'Oulipo ou les passionnés de Georges Perec et ceux de Nathalie Sarraute. Un roman
construit avec des verbes sans sujet. Des verbes qui, à l'infinitif, introduisent
généralement chaque phrase. Une invention qui aurait enchanté Raymond Queneau et ses Exercices
de style. Mais Thierry Beinstingel n'a pas cherché à nous divertir en se livrant à
cette opération littéraire aussi funambulesque que réussie. Il a tenté de nous
inquiéter, de nous affoler, et il y a réussi. Ses virevoltes autour de la grammaire et
de la langue française, ses danses, sur les verbes sans sujet, il les utilise comme des
instruments diabolique de totrure intellectuelle sur ses lecteurs, afin de nous faire
prendre conscience du désert inhumain à l'intérieur duquel nous vivons sans nous en
apercevoir consciemment, tout en étant totalement tributaires de lui.
Prenant pour exemple un central téléphonique, lieu qu'il connaît bien, ou pour
prétexte, puisque cette entreprise est comme l'épure de notre abstraction existentielle,
Thierry Beinstingel nous entraîne à l'intérieur de fils, de réseaux, de conducteurs,
de Bakélite, et surtout de Services, à la première lettre en majuscule, qui diffusent
tout un totalitarismesans visage de l'Autorité. Dans un labyrinthe de pièces,
d'escaliers, de souterrains, de conseils d'administration d'Internet, comme dans un voyage
au bout des virtualités les plus étouffantes et les plus angoissantes, parce que, sans
fin et sans respiration, Central nous permet d'approcher la bureaucratie visible,
rampante ou cachée, dans toute son horreur. Le narrateur, qui évoque ce lieu où tout
converge et diverge, de passage et de nulle part, insaisissable et pourtant indispensable,
exprime parfois dans ce monde glacé, ses insomnies, ses obsessions, ses cauchemars,
notamment les nuits de dimanche à lundi où il recompose, dans les affres et la sueur
anxieuse Central sans coeur et au coeur de tout.
C'est un roman avec des verbes sans sujet, mais surtout sans sujets lui-même, sans
personne, sans âmes qui vivent, sinon que celles-ci ne sont que les esclaves anonymes des
verbes dirigeants. Sans nom, elles sont présentes, mais dans l'apparence. Ce premier
roman est foudroyant de vérités sur l'intolérable et la dessication de nos vies
professionneles st privées, portées dans Central au plus haut niveau de la
lucidité, au plus exemplaire aussi. Petit chef d'oeuvre.
PO et HCB, Perso,
vie publique vie privée, septembre 2000
Avec des verbes sans sujets : comme Thierry Beinstingel, ce cadre au Central des
télécommunications, qui en a soudain eu assez de remplir des formulaires où la teneur
de son activité professionnelle se résumait à quelques verbes à l'infinitif, voires
àdes phrases nominales. Pour dire merde à cette déshumanisation croissante, il a écrit
Central, un premier roman basé sur l'incommunicabilité ; la forme peut
paraître à priori rébarbative, mais la violence du propos n'est pas contestable. Amer,
Thierry Beinstingel affirme avoir "trop dit. Trop pensé. Trop distendu, distordu
dans ses phrases. Ne plus pouvoir utiliser un seul sujet, et surtout pas le Je. "
Le reste est à l'avenant, entre raz le bol et poésie déglinguée.
AG - Courrier Cadre du 22 au 28/9
Y a t'il encore quelqu'un au bout du Fil ? la haine du formulaire en trois exemplaires
susciterait-elle des vocations d'écrivains ? c'est en tout cas le mobile qui semble avoir
poussé Thierry Beinstingel à publier son premier roman, Central. Un ouvrage qui
restitue, dans un climat kafkaïen, le dialogue de sourds régnant au sein de l'entreprise
moderne.
Fort de son expérience acquise dans une multinationale des télécommunications, l'auteur
décrit par le menu la vie quotidienne des cadres et des ingénieurs du secteur. Il dresse
un constat rageur et sans complaisance de la langue de bois managériale, science
hermétique et pleine de double sens qui fait s'égarer le personnel dans le malaise du
non-dit.
comme cette "Description d'emploi" et son "Glossaire des verbes" que
le narrateur doit remplir pour justifier son poste et qui rend compte de l'absurdité des
procédures en vigueur. Certains se reconnaîtront dans cette entreprise type où, entre
autres exemples, on parle "d'actionnaires privés" pour ne pas évoquer la
"privatisation"... Proche de l'autobiographie, Central sonne comme une
charge particulierement acerbe. Quoi de plus ironique en effet que cette fiction qui, tout
en se situant au coeur des nouvelles technologies de la communication, décrit notre
incapacité croissante à communiquer ?
Témoin privilégié, Thierry Beinstingel nous offre un texte violent à l'écriture
percutante. Souvent à la forme infinitive, les phrases semblent tout droit sorties d'une
chaïne d'usine, les mots devenant comme l'écho sourd et mécanique d'une machine. Le
style, lapidaire, finit pourtant par rendre poétique une description particulierement
opressante
Fabrice Gabriel, les
Inrockuptibles, 29/08/2000
Empruntée à Raymond Carver, l'épigraphe de Central donne le la de ce premier roman au
style étrange et terriblement efficace : "passer en coup de vent, ne pas
s'éterniser, passer sa route " Thierry Beinstingel adopte en effet un principe
d'écriture et de composition particulièrement original pour décrire toute une vie
passée au service d'un central téléphonique : négligeant le plus souvent des formes
verbales conjuguées, il élabore une sorte d'esthétique de l'infinitif, voire une
poétique du participe présent ou passé. D'où le ton et le rythme de ce livre
hypnotique et singulier "Maintenant, ressentir l'abandon d'un monde ancien,
d'avant la Description d'emploi, et subir le regard compassé, faussé, porté sur les
choses disparues et de n'importe quelle nature ; dire : autrefois le bon temps.
Se sentir aussi complètement dans le monde nouveau sans pouvoir exprimer la différence
entre le bon temps d'autrefois et celui de maintenant car enfin, au fond, peu de
divergence dans la vie, à part au boulot..." Tout le livre procède d'un
empilement, souvent ironique, de verbes et de souvenirs : ce que décrit l'auteur, avec la
minutie sans manichéisme d'un poète génialement asyntaxique, c'est aussi l'évolution
de la société du monde et du travail, à travers une entreprise où le mot-clé, bien
avant Internet fut celui de "réseau"... Thierry Beinstingel en tire tout le
profit possible pour sa narration : connectant faits et réflexions, croquis de collègues
et questionnement sur la communication, il recense jusqu'à l'obsession l'absurde d'un
quotidien aliénant. Son roman raconte comment le travail peut devenir Central dans une
vie, semaine après semaine, dimanches compris. Rarement on aura si bien décrit l'agonie
des fins de week-end, le cauchemar itératif du dimanche au lundi... Pour s'éveiller de
cette mauvaise nuit, l'écrivain aura eu au moins ce recours : en faire un très bon
livre.
L'est républicain, 3 septembre 2000
Premier roman, deuxième métier : cadre dans les télécommunications à Saint-Dizier,
Thierry Beinstingel s'est inspiré en creux de son expérience professionnelle pour
évoquer en guise de premier opus le thème de l'incommunicabilité
Patrice Lemire, L'Echo de
l a Haute-Vienne du 02/09/2000
Vous avez dit communication ? Avec ce premier roman, Thierry Beinstingel fait vraiment
preuve d'originalité. en effet, tout ce passe à l'intérieur de France Télécom ; des
coulisses vécues par un salarié. Le lecteur voyage dans les différents services et
bureaux, plonge au coeur des dossiers, apprend les méthodes de la Direction de
l'entreprise, observe les attitudes des employés, les conditions de travail, vit les
mutations technologiques, les mouvements sociaux... S'ajoutent des anecdotes : "Celui
qui, éméché, m'appelant à la rescousse, ne comprenant plus rien au dérangement, le
cerveau dans les vapeurs de l'alcool. Le même quelques années plus tard ayant eu un
accrochage avec une camionnette pleine de cuisines en kit Vosgica, tout ce petit bois en
vrac dans la voiture tamponnée. " Tout cela est exprimé par une suite
ininterrompue de phrases avec des verbes sans sujet... L'auteur s'est inspiré du style
employé pour remplir le formulaire "description d'emploi" utilisé dans
l'entreprise.
Bref, l'humanité et la communicabilité semblent fort défaillante en ce lieu
privilégié de communication.
Les
inrockuptibles, numéro 253, spécial rentrée littéraire
"Drôle de titre, drôle de livre : avec ce premier roman, Thierry Beinstingel
invente une sorte d'écriture à l'infinitif. Le résultat éveille l'interêt : en de
courtes séquences excluant le plus souvent les verbes conjugués, un univers se met en
place sur le modèle d'un central téléphonique. Logique du réseau, prose industrielle,
narration qui se refuse à avancer, paralysée par l'angoisse du lendemain : le livre est
parfois étouffant mais promet de saisir le lecteur dans ses fils, imposant son implacable
et labyrinthique description d'une certaine aliénation contemporaine."
Le Figaro Littéraire, jeudi 31août
2000
"A périls nouveaux, langue nouvelle : dans ce roman qui raconte la déshumanisation
du travail dans l'entreprise moderne - un central des télécommunications -, les verbes
n'ont pas de sujet. La conscience professionnelle est une donnée numérique au pays du
bonheur électronique. Cela pourrait être un simple exercice de style, c'est une
audacieuse tentativede saisir l'arraisonnement de l'homme par la technique, son
engloutissement dans les profondeurs du travail aliéné."
Le Monde, par Hugo
Marsan, vendredi 17 novembre 2000
Caïn et Abel avaient un père de Philippe Delaroche et Central de
Thierry Beinstingel. Philippe Delaroche et Thierry Beinstingel font le procès de notre
époque, avec dérision et démesure.
Contempteurs de notre époque, deux romanciers racontent la
triste épopée d´un homme d´aujourd´hui broyé par les dérives d´une société de
consommation soumise aux aléas de la concurrence. C´est le monde des écrans
surpuissants et de l´information immédiate. Le dieu qui tient nos destinées en mains
est d´autant plus redoutable qu´il est virtuel. Tel est le constat de Central et de
Caïn et Abel avaient un frère, deux romans insolites et satiriques. La dérision y
déjoue les ravages du mot-clé de notre temps : communication.
La quarantaine bien sonnée, célibataire après deux divorces, père d´une adolescente
adorée dont les visites sont trop rares, Charles Blizan est le héros candide du
deuxième roman de Philippe Delaroche : Caïn et Abel avaient un frère,pamphlet
mélancolique de l´enfer professionnel envahi de mots démoniaques : slides, paperboard,
rétroprojo, start-up et autres énigmatiques point com. Ce récit à la première
personne nous place d´emblée aux côtés de l´infortuné Charles, consultant en
communication d´entreprise, armé de son portable, dévasté par le stress, endetté,
harcelé par les huissiers et par une ancienne maîtresse dévorante.
La fiction est d´abord une affaire de regard. Nous partageons, de l´intérieur, la
vision de son héros au bord de la crise de nerfs, acculé à l´asphyxie. Charles est
chargé d´organiser, simultanément, deux séminaires pour deux boîtes de télécoms
concurrentes, avec le même but : décrocher l´exclusivité des installateurs
indépendants. L´intrigue, aussi précise soit-elle, n´est pas l´attrait principal du
roman. Le lecteur est étourdi par le mouvement trépidant du récit qui correspond à la
course-poursuite à laquelle le narrateur épuisé doit se livrer. Avec lui, nous
éprouvons jusqu´à la nausée la veulerie des personnages secondaires et l´absurdité
de la vie. A l´arrière-plan de la comédie loufoque des quiproquos et des parties de
cache-cache, on découvre la tragédie d´un homme seul qui lâche prise, s´enfonce
progressivement dans les ténèbres du gâchis existentiel où s´anéantissent les
espérances et les revanches. Balzac et Kafka ont eu la peau d´Alexandre Dumas.
Sous les buildings de la réussite, c´est le grand cimetière de soi-même. Le narrateur
est interdit de séjour dans « l´eldorado de la nouvelle économie : l´empire des
signes, l´univers de la communication, de la dématérialisation ». Il rêve encore de
lentes lectures, de tendres repos, de voluptés douces. « Je reconnais, dit-il, n´avoir
aucune ambition susceptible de rivaliser avec la leur. Nulle idée fixe ne me guide, pas
même l´envie de réussir dans la carrière… Mon détachement est entier. »
Caïn et Abel avaient un frèreest d´abord un truculent exercice d´exorcisme. Delaroche
va au-delà de la féroce description d´une société sans repères qui s´épuise dans
le commentaire de la vie. Il pose la question du bonheur et, insidieusement, souligne le
hiatus entre la conscience que nous en avons et notre acharnement à en détruire les
possibilités.
VERBES SANS SUJET
« Ainsi, avoir fait fausse route et le monde avec. S´arrêter, attendre, verbes pas
prévus dans le Glossaire, pourtant le faire. Prendre le contre-pied de chacun d´eux.
Attendre d´être beaucoup, milliers, millions. Agir. Imaginer autre chose de plus humain.
» Dans cette prise de conscience finale qui pourrait être celle de Philippe Delaroche,
Thierry Beinstingel utilise des verbes à l´infini. C´est le parti pris de son étrange
roman : Central, où l´individu disparaît derrière le formulaire que chacun de nous
doit remplir (ou inventer) pour faire savoir qu´il est en phase avec l´univers factice,
quasi fictif, où l´action se crée elle-même, engendre ses propres pièges, invente un
mouvement perpétuel artificiel où l´on peut oublier le temps et la mort.
Le narrateur de Thierry Beinstingel travaille depuis de longues années au Central
de télécommunication, témoin de son inexorable déshumanisation. Verbes sans pronom
personnel, verbes sans sujet pour dénoncer l´effacement de l´homme-sujet, assujetti à
l´emprise grandissante de l´entreprise. Central stigmatise l´homme complice de la
création du monstre virtuel qui signera sa perte. Aussi violent que le roman de Delaroche
mais plus noir et privé d´humour véritable, Central est la métaphore d´un passé
sinistre. Les petits chefs de la grande administration sont des dictateurs, ridicules
certes mais aux premières lignes d´atroces allusions et, sous d´autres oripeaux, de
l´éternel recommencement de l´Histoire. « Mesurer enfin l´ampleur du travail
effectué par le petit homme aux favoris noirs, toujours sollicité, parlant d´une voix
rauque, sans éclat, sans passion, avec un air d´ennui gravé dans les rides du front.
Tenant tête à tous, mais se rétractant à la moindre mauvaise surprise, connaissant
chaque tâcheron, l´appelant par son nom, nos techniciens y compris, nous reprochant la
lourdeur de nos interventions mais trouvant d´immédiates solutions à tout. Lui, placé
au centre, donnant un ordre bref, presque doux, aussitôt exécuté et nous, observant ces
hommes clouant, enfonçant des piquets, accomplissant des gestes de force, comme une
armée entière à la botte du petit homme. » Le roman de Thierry Beinstingel est
mémoire et prémonition.
L'interview de Gilles Bertin pour Ecrire Aujourd'hui
«Central», un premier roman sans sujet
Central. Le premier mot du premier roman publié de Thierry Beinstingel. Son dernier
mot aussi. Et son titre. C’est dire si ce mot est central dans ce roman original qui
relate les vingt ans de vie professionnelle d’un employé des télécommunications.
Le travail au jour le jour dans un central téléphonique. Les espoirs. Les mutations de
l’entreprise. L’usage qu’elle fait des mots. Sa manie d’utiliser les
verbes à l’infinitif, sans sujet. Comme pour mieux dépersonnaliser ses employés.
Roman «parfois étouffant» comme l’a qualifié un critique des Inrockuptibles. Il
s’agit avant tout d’un roman original par son style et par son sujet. Son
auteur, employé de France Telecom, vit en Haute-Marne à Saint-Dizier.
Gilles Bertin: Quel effet cela
fait d’être publié?
Thierry Beinstingel: Un drôle d’effet! Quand je suis allé signer mon service
de presse chez mon éditeur (les éditions Fayard), il y avait justement un
manutentionnaire qui déchargeait une palette entière de mon livre. C’était
merveilleux de voir mon bouquin réduit à quelque chose qui se transporte ainsi, cette
palette, tous ces exemplaires de mon livre entassés, entourés d’un plastique
transparent. C’est mon meilleur souvenir. J’ai eu cette chance de vivre ce
moment de cette façon, quand le livre passe de l’état de manuscrit à l’état
d’objets. Ce n’est pas un moment réducteur, bien au contraire. Il commence à
être transporté. Des métiers en vivent. Des imprimeurs. Des manutentionnaires. Des
libraires.
Puis quand j’ai eu le livre en main, j’ai eu du mal à y croire. Je me suis
demandé qui était ce type, ce Thierry Beinstingel dont le nom était imprimé sur la
couverture. Il y a eu un effet de distanciation, comme si c’était quelqu’un
d’autre qui avait écrit.
G.B.: Est-ce que cela a été
facile pour vous de trouver un éditeur?
T.B.: Facile? Je dirai oui. Je me suis même presque payé le luxe de choisir. Je
voulais un éditeur qui ne soit pas trop «marqué» littéraire comme peut l’être
marqué par exemple Les éditions de Minuit. À côté des romans, Fayard publie aussi des
essais et mon livre est justement aussi un essai. Je souhaitais que l’éditeur puisse
avoir un regard par rapport à cela.
C’est un ami qui a déposé mon manuscrit chez Fayard, un ami «introduit». Je ne
sais pas si cela aide. Peut-être que lorsqu’un livre arrive par la Poste il faut
qu’il «accroche» encore davantage dès la première page. Mais je pense
honnêtement que mon roman aurait eu le même sort, qu’il aurait été publié si je
l’avais envoyé par la Poste. Mon éditeur m’a dit après qu’il avait
remarqué dès le début qu’il manquait quelque chose mais il n’a pas vu tout de
suite de quoi il s’agissait. L’explication vient assez longtemps après le
début. C’est la construction de mes phrases sans sujet.
G.B.: Justement! Le style de
votre roman est très original et immédiatement reconnaissable, comme l’est par
exemple celui de Duras. Des verbes à l’infinitif sans sujet. Pourquoi?
T.B.: Je me suis posé depuis longtemps la question de la place du verbe dans la
phrase. Je m’étais intéressé aussi aux haïkus. J’ai donc écrit comme ça en
enlevant le maximum de choses, tout ce qui me paraissait inutile, et le sujet en faisait
partie. J’ai voulu faire très descriptif pour me rapprocher au maximum de la
réalité, au risque d’ennuyer le lecteur. J’avais envie de dire au lecteur que
le travail c’est ça aussi, que le travail c’est ennuyeux, et un moyen de lui
faire ressentir cela était que lui aussi s’ennuie, de l’entraîner dans cet
ennui. Quand je décris minutieusement les trois postes téléphoniques éventrés sur la
moquette, c’est long et ennuyeux.
G.B.: Mais ces descriptions
très bien faites transmettent aussi tout ce qu’il peut y avoir de travail bien fait
de la part de centaines de personnes pour aboutir à ces téléphones.
T.B.: Oui, c’est vrai.
G.B.: Comment vous est venue
l’idée de ce livre?
T.B.: J’avais raconté à quelqu’un une anecdote ayant trait à mon
travail, deux agents travaillant sur un sous-répartiteur. Cette personne m’a dit, Tu
devrais l’écrire. Je l’ai écrit. Puis j’en ai écrit d’autres. Au
bout d’un certain temps cela a constitué un ensemble que j’ai eu envie
d’ordonner. Je l’ai tellement remanié que tout est en désordre par rapport à
l’écriture initiale, l’anecdote initiale n’y figure même plus.
J’aurais pu le mettre dans un autre ordre, cela n’aurait pas changé grand chose
puisqu’il n’y a pas vraiment d’histoire, et c’est volontaire.
C’est une histoire qui refuse d’avancer en fait. Le travail c’est ça: On
reste vingt ans à bosser et on n’a pas avancé d’un iota. C’est ce que
j’ai voulu traduire. Je voulais que cela commence par le mot «Central» et que ça
finisse aussi par ce mot. Comme si on n’avait pas avancé, comme si on avait tourné
en rond.
G.B.: La façon dont vous
parlez du «Glossaire des verbes», cette liste de verbes créée par votre entreprise
pour aider ses employés lorsqu’il est demandé à tous de décrire leur poste de
travail, laisse supposer qu’il s’agit de quelque chose d’essentiel pour
vous.
T.B.: Le bouquin était dans ma tête et je savais que ce «glossaire» en serait
la pièce centrale. À l’époque où je l’avais eu dans les mains pour décrire
mon propre poste de travail, il ne m’avait pas choqué. C’est souvent ainsi, sur
le coup on ne se rend pas compte des choses. Mais ce qui m’avait choqué par contre
était qu’une entreprise puisse affirmer dans une telle liste qu’un mot est
meilleur qu’un autre, par exemple que le verbe «diriger» est mieux que le verbe
«balayer». J’ai trouvé ça anormal. Les mots appartiennent à chacun,
l’entreprise les utilise d’une façon très différente. Cette façon de faire,
d’utiliser les verbes à l’infinitif, sans sujet, déresponsabilise les
employés. On est uniquement dans le collectif. L’individu n’a pas
d’existence propre.
G.B.: Comment s’est
déroulée l’écriture de ce livre?
T.B.: Il m’a fallu à peu près huit à dix mois, chaque soir, après le
travail, en général de neuf heures à onze heures (je ne regarde pas la télé). En
fait, ce n’est pas l’écriture qui prend du temps, c’est d’y
réfléchir, et on y réfléchit toute la journée, à chaque fois que l’on a un
instant. Il est impossible d’être seul pour écrire dans le monde où on vit. Quand
j’ai compris cela, ça a été beaucoup mieux. J’ai un travail, une femme, des
enfants. Quand j’écris, je suis souvent dérangé. L’ordinateur est dans la
chambre mais il y a aussi une télé et du passage. Avant j’avais un problème avec
cela mais maintenant ça ne me gêne plus du tout. J’ai seulement besoin par moments
d’avoir du temps seul pour lire ce que j’ai écrit à haute voix afin de
vérifier certaines choses. Durant l’écriture du livre, il y a aussi des épisodes
que j’ai vécu dans mon travail qui sont ressorti quasiment en direct dans mon livre.
Par exemple, cette immense foire dans laquelle j’étais chargé d’installer le
téléphone. Cela se passait dans un petit village de la Haute-Marne, c’était le
«Mondial du labour».
G.B.: Qu’aviez-vous
écrit avant «Central»? D’autres romans? Des nouvelles? Des poèmes?
T.B.: Central est mon premier roman publié mais juste avant j’ai eu aussi un
récit d’anticipation publié chez un éditeur régional. Il s’agissait
d’imaginer mon département, la Haute-Marne, en 2017. C’est un livre écrit
d’une façon totalement différente. Je l’ai écrit dans le cadre d’une
association dont je fais partie, l’Association des écrivains de Haute-Marne.
J’ai aussi écrit auparavant six autres romans que je n’ai jamais envoyé à des
éditeurs. Je ne les trouvais pas assez bon. J’en ai montré un à un écrivain. Son
avis m’a beaucoup aidé, il a mis le doigt sur des travers des débutants:
concordances de temps, utilisation de clichés, passages larmoyants.
G.B.: Vous préparez un autre
livre?
T.B.: J’ai un autre livre en train que je vais remettre à mon éditeur dans
deux mois.
G.B.: Depuis quand
écrivez-vous?
T.B.: J’ai commencé d’écrire en 1978, j’avais vingt ans. J’ai
toujours voulu être écrivain. Je me suis dit à l’époque, Il faut que je gagne ma
vie, alors j’ai passé un concours de la Poste. Aussitôt après avoir commencé de
travailler, je me suis mis à l’écriture. J’ai écris soixante-dix pages. Puis
j’ai arrêté durant dix ans, pris par la vie, les copains, j’ai rencontré ma
femme. Et dix ans après je m’y suis remis. J’ai repris ces soixante-dix pages
et je les ai finies. Puis j’ai continué.
G.B.: Quel sont vos écrivains
préférés?
T.B.: J’ai trois écrivains fétiches que j’ai découverts quand
j’ai commencé à écrire:René Fallet, Maurice Genevoix et Blaise Cendrars. Après
il y a eu Samuel Beckett, Marguerite Duras avec notamment «Dix heures et demie du soir en
été», Claude Simon et «La route des Flandres».
G.B.: Et vous n’avez pas
proposé votre manuscrit aux Éditions de Minuit?!!!
T.B.: Non. Je les trouve trop marqué littérature.
G.B.: Quels conseils
donneriez-vous aux écrivains qui désirent être des écrivains publiés?
T.B.: D’abord ne pas être tout seul. Trouver une association, un groupe. Se
persuader que l’on n’est pas tout seul, on fait partie d’un tout.
L’écriture ce n’est pas un travail solitaire dont on se débarrasse auprès
d’un éditeur, ce n’est pas complètement individuel.
Ensuite se répéter sans arrêt «je suis écrivain». En effet tant que l’on
n’est pas publié on a du mal à se nommer, on ne sait pas si l’on est écrivain
ou pas. Je me suis répété sans arrêt que «je suis écrivain».
Se dire aussi que l’écriture ce n’est pas quelque chose que l’on prend par
dessus la jambe, c’est quelque chose d’important, il faut s’en persuader!
C’est un travail engagé, comme le concevait Sartre.
Ne pas attaquer l’écriture de front. Je tourne toujours autour du pot. Quand je me
mets à mon ordinateur, je commence par lire mes e-mails, je fais autre chose,
j’attends le déclic.
Savoir s’arrêter aussi. Avec l’ordinateur on peut corriger sans arrêt. Il y a
un moment où il faut s’arrêter, où cela ne sert plus à rien.
Enfin se rendre compte comme l’on passe facilement de l’état «content de ce
que l’on a écrit» à l’abattement. La frontière entre un livre réussi et
raté est très fine.
Et la critique de Gilles
Bertin pour Ecrire Aujourd'hui...
Central est un roman qui pourrait être pris pour autre
chose qu’un roman. Il s’agit bien d’un roman! De l’histoire d’un
homme. Et à travers cette histoire de celle d’une entreprise, de celle du second T
du sigle P.T.T. devenu France Telecom, passé du téléphone en ébonite noir au
téléphone mobile, du central téléphonique électromécanique sur plusieurs centaines
de mètres carrés au central électronique de la taille d’une chambre à coucher, du
fonctionnariat à l’entreprise privée et à Internet. On retrouve dans le roman de
Thierry Beinstingel toutes les ambiguïtés de cette évolution gigantesque.
L’attachement de l’auteur pour de vieux techniciens figés dans leur époque,
dans leurs petits centraux de campagne. Sa participation à la marche du progrès en tant
que cadre. Sa fascination pour les nouvelles technologies auxquelles il se trouve mêlé
(il a d’ailleurs son propre site Internet).
Bâti autour de ce formulaire de «Description d’emploi» rempli par tous les
employés pour préparer le passage du public au privé, «Central» est écrit avec un
style d’une grande originalité, en adéquation complète avec le sujet traité,
puisque la forme des phrases commençant très souvent par un verbe à l’infinitif
sans sujet traduit la dépersonnalisation de toutes les procédures de travail de
l’entreprise. Attachant par son humanisme, par la rencontre avec des hommes et des
femmes conscients de leur métier et de leur utilité, ce livre au titre emblématique
essaie de répondre à cette question à laquelle tout le monde a au moins une fois
essayé de répondre dans la nuit du dimanche au lundi: Pourquoi vais-je travailler? Pour
répondre convenablement à cette question il faudrait user de la définition de
Saint-Exupéry «La grandeur d’un métier tient dans sa capacité à réunir des
hommes.» Si Thierry Beinstingel cherche de ce côté c’est de façon non
délibérée et c’est justement ce qui donne à son roman, l’aventure d’un
homme dont le travail consiste à permettre à des hommes de communiquer avec le
téléphone, son côté si humain à travers tous les gens qu’il a rencontré, avec
qui il a travaillé, avec toutes les questions qu’il s’est posées et qu’il
continue de se poser. Central, le travail est central dans la vie d’un être humain:
il serait inconvenant que la littérature n’en parle pas, c’est ce que Thierry
Beinstingel fait avec talent, en réinjectant au passage la littérature dans
l’entreprise à travers les mots.
NOTES Bibliographiques (novembre 2000)
Retourner en pensée sur les lieux
de son travail, passer en revue les machines qui ont évolué avec le temps, les hommes
qu'il a côtoyés, collaborateurs ou ouvriers, les anecdotes qu'il a vécues, c'est ce que
fait le narrateur dans la nuit du dimanche au lundi. La télécommunication est son
domaine. Que de changements en si peu de temps ! Quel point commun entre le central
téléphonique et le satellite ? L'être humain dans cette entreprise qui en comporte cent
cinquante mille, est-il encore centre du monde de la communication où n'est-il plus
qu'une machine ? Une circulaire de l'Entreprise le spécifie : pour communiquer, les
verbes choisis dans un glossaire seront écrits à l'infinitif, il n'y aura plus de sujet.
Ce premier roman, attendu à la première personne, d'où le "je" a disparu, ne
comporte que des infinitifs, comme le prévoit la circulaire, ce qui lui donne une
sécheresse difficile à surmonter. Mais les études technologique et sociologique sont
originales. C'est un fort plaidoyer pour que batte encore le cœur de l'homm
L'article de Thomas Day (Urbuz) publié dans l'actualité littéraire de Yahoo (novembre 2000)
S'il est un livre qu'il est difficile - voire impossible - de conseiller à ses amis, c'est biencelui-ci. Vous pouvez tout à fait rentrer dans cet exercice littéraire original (le narrateur
ne se présentera jamais, tous les verbes sont à l'infinitif), ou ne pas y rentrer, rester à la
porte de ce Central où il ne se passe rien de passionnant (ni meurtre, ni intrigue à
caractère sexuel, ni secret de famille pesant, ni rapports de pouvoir effrayants).
L'intérêt du livre est ailleurs. Dans la description de la vie de l'entreprise, dans toutes ces
petites phrases qui donnent une idée de ce que peut être le départ du dernier cadre
d'une structure de plusieurs personnes ; et de fait, la centralisation du pouvoir décisionnel
loin des ouvriers, des techniciens. Il y avait un risque dans ce livre, celui du discours
réactionnaire "C'était mieux avant", un risque que Beinstingel évite, contourne avec brio.
On trouvera en ces pages quasiment toute l'histoire du téléphone en France et de ceux
qui ont permis depuis plus d'un siècle qu'hommes et femmes puissent se joindre,
communiquer, malgré la distance, malgré les différences.
Et c'est bien de cela qu'il est question ici, la démocratisation de la communication, la possibilité de se parler que l'on soit ouvrier ou médecin, cadre ou chômeur. Central est un livre exigeant qui demande une grande
concentration au moment de la lecture, mais c'est aussi un ouvrage d'une richesse insoupçonnable. Cote d'amour : 0 et 100%
La critique de librairie-on-line (decembre 2000)
Avec ce premier roman, Thierry Beinstingel nous emmène dans un univers très particulier, où les verbes ne se conjuguent pas. Logique de réseau, prose industrielle, narration qui se refuse à avancer, bloquée par l’angoisse du lundi, du travail. Un labyrinthe qui se tisse, qui nous emprisonne et nous séduit. Construit sur le modèle d’un central téléphonique, cet univers impose son implacable description d’une certaine aliénation contemporaine. Saisissant. Anne-Sophie
Interview dans Liberation-Maroc par Mohammed Boudaharam (08/12/2000) Libé: Comment vous est venue l’idée d’un roman sur l’enfer de l’Entreprise alors qu’il s’agit de votre premier livre?Thierry Beinstingel: Dans mes goûts littéraires, je me suis beaucoup intéressé à la description de la réalité. Comment rendre, comment décrire et sous quels angles. Un des auteurs qui m’a le plus appris à ce sujet est Claude Simon, notamment dans La Route des Flandres. Raymond Carver, que je cite en épigraphe est aussi un narrateur hors pair de la société américaine. De là, observer, rendre ce qui se passe autour de moi est venu naturellement. D’autre part, beaucoup d’écrivains ont un deuxième métier, souvent "alimentaire" et peu en parlent, comme si, la banalité de la vie, le quotidien ne constituait pas un morceau suffisamment noble pour la littérature. J’ai voulu parler de ce quotidien et bien évidemment de mon métier dans les télécommunications qui représente une partie de ma vie non négligeable. Le fait d’être dans une société et dans un domaine en pleine mutation a achevé de me convaincre de l’enjeu d’arrêter le temps, d’observer et de rendre. Mais déjà, avant même la parution de ce premier livre, donc d’accéder au statut d’auteur publié, il m’a fallu anticiper ce rôle, me convaincre en quelque sorte d’être un écrivain, ce qui est en soi étrange et paradoxal. Quel effet cela fait d’écrire tout un livre avec des verbes à l’infinitif et quasiment une totale absence de sujet?
Au début, on a peur, on se relit, on trouve les phrases étranges sans sujet. Et puis on passe le cap, on y prend goût, le texte devient lisible avec une forte densité provoquée par l’absence de sujet. A la fin, on se sait plus écrire autrement, on a du mal à réutiliser les phrases traditionnelles ! Plus sérieusement, la place du verbe dans une phrase m’a toujours fait beaucoup réfléchir : noms, articles, adjectifs contribuent à la description mais pas le verbe. Il représente la force, l’action, le mouvement, l’indescriptible. Il déstabilise la phrase. Ma surprise a été de découvrir chez certains poèmes japonais (des haïkus) qu’on pouvait se passer du sujet, même du verbe, sans que le mouvement, la temporalité de ce que voulait dire l’auteur soit tronquée. L’épisode de la Description d’emploi, proposée par mon entreprise, obligatoirement rédigée avec des verbes à l’infinitif, et guidée par un Glossaire des verbes ne pouvait que m’inviter à continuer une telle contrainte. Que visiez-vous en faisant un tel choix?
Mon but était de faire ressentir au lecteur qu’il y a plusieurs modes d’expression dans une même journée : nous avons tous un langage familial, parfois un langage social et tous aussi un langage propre à notre travail avec une syntaxe particulière. Je voulais faire sentir la façon dont mon entreprise utilise le langage, et même essaie d’en contrôler les usages.
La longueur des descriptions, l’impression de tourner en rond est également un effet voulu : beaucoup éprouvent à leur travail un sentiment de lenteur, rester 20 ans à son poste sans avoir l’impression d’ avancer, par exemple.
Il fallait que cela transparaisse dans mon livre, que le lecteur ressente même parfois un ennui en lisant certains passages de mon récit ! En lisant votre livre, on ne peut que ressentir un étouffement qui n’est pas loin de celui qui marque un "Le Château". Seriez-vous un Kafka des temps modernes, de l’ère High-tech?
Il est vrai que la situation actuelle, la course mondiale et effrénée de la technologie apporte des situations dignes de Kafka. La technique évolue vite, crée de nouveaux besoins, de nouveaux marchés, modifie les lois commerciales mais les lois sociales et la capacité de l’homme à absorber ces évolutions restent limitées. Force est de constater que beaucoup d’ouvrages prônent les progrès techniques, la mondialisation en regard de ceux qui dénoncent cela - et qui ne sont pas forcément passéistes ! Dans "Central", il est très question d’une incommunicabilité dans un secteur de communication justement et c’est l’un des thèmes qui connaissent beaucoup d’intérêt actuellement. Selon vous, est-ce que l’on est en face d’une nouvelle littérature de contestation des modes de travail à l’ère des réseaux et Internet?
Chaque évolution d’envergure - et dans le cas d’Internet, c’est même une révolution - entraîne des réactions : ceux qui sont pour, ceux qui contestent. Nous en sommes là et les arguments développés de part et d’autres tournent vite en rond : pour ou contre Internet, pour ou contre les mondes virtuels.
Pourtant certaines questions sont intéressantes à mener (relèvent-elles de la contestation?) : le devoir de l’information toujours exhaustive, universelle tend à se confondre avec la démocratie qui possède les mêmes caractéristiques, est-ce normal? Pour la rentrée littéraire 2000 en France, on a eu "Central", mais aussi "Le Culte de l’Internet" de Philippe Breton et "99 F" de Beigbeder qui versaient dans une atmosphère similaire. Vous revendiquez-vous de quelque courant de pensée?
On peut citer aussi Philippe Delaroche, avec Caïn et Abel avaient un frère dont l’intrigue se déroule aussi dans les télécommunications. Il est normal que les auteurs parlent d’Internet, le phénomène étant d’une ampleur sans précédent, mais chacun le fait à sa manière, on ne peut pas parler de courant de pensée fédérateur, les buts recherchés ne sont pas les mêmes, par exemple, Beigbeder a surtout fait un coup médiatique. Dans "Central", il est question justement d’une aliénation dans un central téléphonique. Et si l’on vous demandait votre avis sur les travailleurs de l’Internet, cette grande catégorie que les anglo-saxons n’hésitent pas à qualifier aujourd’hui de "Netslaves"?
Internet me fait gagner du temps, m’évite de me déplacer, mais bon, ne résoud pas tous les problèmes du monde! Oui pour travailler avec Internet en tant qu’outil, non pour qu’il devienne une philosophie de vie. "Central" est un livre saisissant de noirceur. Est-ce que vous seriez prêt à refaire la même expérience avec les mêmes constantes et un environnement autrement aliénant?
Je n’ai pas eu l’impression de faire un livre noir. Je travaille toujours dans cette entreprise et je ne déprime pas pour autant, il y a de bons moments ! L’environnement est aliénant pour le lecteur extérieur comme il l’est pour un débutant dans l’entreprise qui se demande si un jour il pourra s’habituer au jargon, au langage et aux us et coutumes. Du coup je ne sais pas si Céline en écrivant Voyage au bout de la nuit , qui est pour moi l’exemple de la noirceur, avait également conscience de celle-ci.
Ecrire dans un autre environnement aliénant, oui, je devrais retrouver les mêmes réactions, donc les mêmes observations plutôt sombres, mais la question ne se pose pas pour l’instant. Par contre, continuer à écrire systématiquement sans sujet, je crois que je me lasserais vite (et le lecteur aussi). La réception de votre livre par la critique a été globalement positive, mais qu’est-ce que cela fait de passer pratiquement de l’anonymat sous les feux de la rampe et chez Fayard?
C’est vrai que la critique est plutôt positive ce qui évidemment me fait plaisir et montre qu’on peut solliciter le lecteur dans un livre assez dense avec des formes grammaticales pas habituelles. Les sollicitations qui ont suivi la sortie de Central, comme par exemple la fête de l’huma ou bientôt une conférence/débat à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse sont nouvelles, enthousiasmantes, enrichissantes, également rassurantes : j’ai le retour sur ce que j’ai voulu dire et si ça correspond, c’est parfait ! Que répondrez-vous si l’on vous proposait un job grassement rémunéré dans quelque autre central ou start-up?
Non sans hésitation, même pour 20 fois mon salaire actuel. Pour deux raisons : la première est qu’une start-up est basée sur le profit, rien que le profit et ça ne correspond pas à ma philosophie économique; la deuxième est qu’avoir du temps pour voir mes enfants grandir en province est un avantage incalculable. Sinon quels sont vos projets pour le futur? Pourrait-on en avoir une idée?
Continuer à écrire : je remets après-demain un manuscrit à mon éditeur, et j’ai d’autres projets plus ou moins démarrés... Je reste volontairement discret par superstition ! Pour l’instant j’essaie d’allier mon travail de cadre dans les télécommunications avec l’écriture, mais je sais que l’écriture prendra une place de plus en plus importante.
L'article de Tanguy Viel Dans Inventaire/Invention (decembre 2000)
S'il y a une chose qui doit être ratée dans le livre de Thierry Beinstingel, peut-être
la seule, c'est la quatrième de couverture. Ratées, les quatrièmes le sont en général
quand elles n'atteignent pas leur but, à savoir donner envie de lire, ce qui n'est pas le
cas. Plus rares sont ces para-textes (et je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot dans ce
cas) qui dévaluent l'entrée dans un livre. Le problème ici est simple : tout y est dit
de ce qu'on préférerait ne pas voir, c'est-à-dire à la fois le procédé formel
utilisé et la morale de l'affaire. Citons : « le narrateur […] se jure d'écrire un
roman peuplé de verbes sans sujet ». Voilà pour la contrainte formelle. Citons encore :
« Il en résulte cet étonnant roman de l'incommunicabilité au cœur de la
communication où plus personne, bientôt, ne répondra à personne ». Voilà pour la
morale. Or si Central doit avoir des raisons d'être lu, comme d'ailleurs la littérature
en général, par pitié que ce ne soit pas en vertu des intentions et des messages. Ce
qu'en outre n'est pas le livre.
Dans Central donc, tous les verbes sont à l'infinitif (présent ou passé) ou au
participe (présent ou passé), il n'y a effectivement pas de « sujet », ni pronom, ni
substantif assumant cette fonction grammaticale. Mais bien que cette quatrième de
couverture nous y pousse fortement, ce serait assez stupide de la part du critique de
brandir à nouveau le bon vieux grief de l'exercice de style. Soit dit en passant, tous
les livres sont des exercices de style, tous les livres s'imposent contrainte, si
invisible puisse-t-elle être à son auteur lui-même. L'endroit d'où on parle, le
nébuleux lecteur qu'on construit dans sa tête, le fil rouge qu'on suit quand on écrit,
le cadrage, le montage, ce ne sont là que les formes discrètes de l'exercice de style.
D'un autre côté, il faut avouer, ici on nous y pousse vraiment. Et par cette affaire de
sujet manquant, il ne resterait plus qu'à broder quelques assertions théoriques autour
d'une littérature sans sujet, de la mort du narrateur, etc. L'article est bouclé.
Pourtant on peut soupçonner que, si tant de précautions n'étaient prises avec nous, les
lecteurs, on n'y verrait que du feu quant à ces fameux verbes sans sujet. Car souvent à
la lecture on parvient à oublier cette rigueur formelle dans l'enveloppé de la phrase,
son invention permanente, ou ses ruses qui rendent invisibles sa rigidité fondatrice. La
contrainte, comme dans tout livre qui se respecte, est une histoire de cuisine interne
dans laquelle le lecteur ne doit pas être pris à parti.
Et si Central est un beau livre, ce n'est sans doute pas d'ailleurs dans ce procédé qui
cherche ainsi à mieux décrire l'homme broyé par la machine (en l'occurrence, la machine
c'est le téléphone, et le sujet broyé, un homme qui travaille au Central des
télécommunications), ni dans son postulat au fer rouge du « plus on communique moins on
communique », mais au contraire dans l'exhaussement d'un narrateur, et pour le dire vite,
dans sa puissance sensible. Nous voudrions nous engager là, à nos risques et périls,
dans une question poétique : ce qui est beau dans Central, ce sont les nuits répétées
d'angoisse, c'est le téléphone 1924 du grand-père, c'est le démontage du stand de
foire, c'est le sentiment de compression qui se dégage. Du vivant, rien que du vivant et
du visible. Ce qui est moins beau peut-être, c'est le désir du texte de s'auto-définir,
et qu'on doit à la quatrième de couverture de mettre encore plus en avant, comme le
soulignant naïvement (ou malhonnêtement, puisqu'il s'agirait de légitimer le texte
avant même qu'on l'ait lu).
Proust a résumé le problème en deux phrases bien distinctes et tranchantes. 1) Au
jugement dernier de l'art, les intentions ne seront pas comptées. 2) Une œuvre où
il y a des théories est comme une chose sur laquelle on aurait laissé l'étiquette du
prix.
Pourtant dans le texte de Central, on n'est pas tant gêné par le besoin du narrateur
(caché) de s'expliquer. Pour ne prendre qu'un exemple, on trouve à la page 144 la phrase
suivante : « Ne plus pouvoir utiliser même un seul sujet, et surtout pas le Je ».
Voilà bien une phrase « explicative » mais au moins elle provient de l'intérieur du
livre, comme un point auquel on aboutit et auquel le narrateur ne pouvait échapper dans
sa logique interne. La part théorique est déjà sertie dans la fiction et, quand bien
même ce n'est pas ce qui fait la force du livre, on la tolère.
Mais il y a peut-être quand même un paradoxe entre l'absence ostentatoire de sujet et
l'omniprésence d'une instance cachée qui juge et considère sans répit le monde dans
lequel il vit et nous explique (nous justifie ?) son projet. Tous les écrivains ont
besoin de protection pour écrire, qu'elle soit en amont du texte, ou qu'elle en fasse
directement partie. Et ce que nous semblons considérer comme des scories dans ce livre,
ce n'est sans doute que la part visible des protections, des garde-fous qui permettent
tout simplement l'écriture. Nous aussi, dans cet article, nous nous protégeons : ce que
nous reprochons au texte est une véritable affaire de choix poétique qui pourrait se
résumer dans la formule : le montré, c'est tellement plus beau que le démontré.
Or Central montre beaucoup plus qu'il ne semble le croire lui-même, comme si l'auteur
peut-être ne faisait pas absolument confiance à son matériau. Il faut lire Central pour
ce qu'il a d'écrit, de rarement écrit, pour sa façon unique de sillonner la matière,
de forer le réel sans relâche, d'assurer le trouble entre le cerveau du narrateur et
l'image nocturne, déformée, du monde obsessif qui le fait. Il faut lire Central pour son
basculement dans le presque fantastique, à force de regarder à la loupe le monde devant
soi. Il faut lire Central pour vivre le cauchemar ruiniste d'une vie d'homme au travail,
pour voir se faire démonter sous nos yeux, nerveusement, fébrilement les téléphones
fantomatiques qui traversent les pages sans qu'on sache plus à force ce qui du rêve ou
de la réalité fait le récit.
Il faut oublier le plus possible la quatrième de couverture et les instants de relâche
du texte. Il faut finir Central, refermer le livre et se dire à propos de l'auteur, non
pas comme souvent: «qu'est-ce qu'il va écrire après ça?» mais plutôt «tout est
possible après ce livre».
La revue des livres sur le monde Internet, par Ariel dans internetactu
Un monde où les actions n'ont plus de
sujet, où les verbes, comme des fonctions impersonnelles, sont à l'infinitif, parce que
le Verbe s'est retiré du monde : tel est le livre que la société de l'information
inspire à Thierry Beinstingel, qui signe ici sa première oeuvre, entre pamphlet et
roman. On se souvient d'un roman d'où la lettre E avait disparu ; celui-ci fait
l'économie de tout verbe conjugué. Exercice de style ? Pas vraiment, d'autant que la
prouesse, en soi, est quelque peu artificielle, puisqu'il est facile de remettre en place
beaucoup de ces phrases infinitives. Mais ce qui importe ici, c'est que la forme du roman
épouse son sujet : au Central des télécommunications, un homme observe avec fatalisme
et désenchantement la dépersonnalisation du monde moderne, où les individus sont
réduits à l'état du "x" d'une fonction mathématique, et ne peuvent plus
qu'observer ou constater avec impuissance la "déshumanisation" irréversible du
travail, et témoigner d'un passé révolu : "L'ère d'avant l'informatique, l'avoir
connue. Etre une sorte de dinosaure. Un héros." L'élimination des verbes conjugués
donne une langue concise, télégraphique, qui semble directement transcrite du latin de
Tacite : "Etrange monde, s'attachant à se donner une image, tantôt bleue et
glaciale, distanciée des hommes et des femmes le composant, tantôt rouge et guerrière
face à la guerre économique devant être livrée…" Au delà de l'étrange et
étouffante mélopée produite par cette succession de phrases sans sujets, il y a d'abord
un roman à thèse : le monde dit des nouvelles technologies de communication renforce
l'incommunicabilité entre les êtres : la personne même disparaît. L'ordinateur a
placé un écran entre chacun de nous : "Chacun le sien. Impossible de concevoir son
travail autrement que devant l'écran."
Dans ce monde dictatorial sans dictateur -- le nôtre --, chacun doit remplir un
formulaire décrivant son travail en puisant dans un glossaire des verbes préétabli par
la direction invisible, bienveillante et tutélaire qui veille à la sécurité et à
l'ordre communs. Toute la violence du pouvoir se réduit au jargon administratif qui
cherche à exclure toute humanité de son vocabulaire -- et donc de la vie. Evidemment, de
ce glossaire obligatoire sont exclus les verbes tels que "aimer, faire confiance,
refuser ou réclamer", et privilégiés ceux qui véhiculent l'aliénation et la
soumission. C'est un peu caricatural ou démonstratif : le romancier nous explique ce
qu'il a voulu dire au lieu de raconter son histoire ; bon, il n'est pas mauvais de
rappeler que la langue, pour reprendre le mot fameux de Roland Barthes, est
"fasciste", et de saluer cet espèce de roman de science-fiction sociale qui
renouvelle de manière originale le thème classique de l'individu se révoltant contre
l'ordre aliénant : cette révolte consistant ici à dresser la liste des mots inventés
pour dissimuler la réalité sociale, et à constituer un lexique poétique de ce
"novlang" que dans ses meilleurs moments, le narrateur, s'il est encore permis
d'employer ce mot, écoute sonner avec l'oreille d'un Francis Ponge : "Délaissé
aussi le 'service du personnel', devenu 'Ressources humaines' et ses éléments, les
'Agents', appellation injurieuse et policière transformée en abréviation encore plus
barbare, les MU (Moyens Utilisés), et là, tous devenus, d'un instant à l'autre, des
choses informes, obscures, incompréhensibles, deux lettres abrégées tout comme ET, de
la chair d'extraterrestre pour nourrir le capital, avec, dans la prononciation, une
résonance de peau de serpent caché sous une pierre : le MU."
Cependant, il ne s'agit plus de prendre le parti des choses, mais de dénoncer le non-sens
d'un langage de bois -- et des emplois fictifs, au sein d'un monde qui a l'air
d'appartenir au futur alors que tous ses traits sont contemporains. "Ainsi,
comprendre tous ces métiers de coupeurs de cheveux en quatre, grands comparateurs
d'organisation, d'agences, d'établissements, devant l'Eternel. Le rôle des directions :
comparer. D'ailleurs, ne plus employer ce mot mais l'auréoler d'un prestige mystérieux
en utilisant celui de 'benchmarking'. L'avoir vu clairement noté sur mon rapport annuel
comme une tâche à remplir et n'avoir pas osé demander le sens du mot… Et tout le
monde au courant de cette immense hypocrisie des métiers ne servant plus à
rien…" Du cœur de cette langue sans corps ni esprit, de ce monde
postérieur à la mort de l'homme, le héros, cet "épuisé", tente de redonner
souffle en faisant chanter à cette langue un chant hiémal : "Espérer vaguement ni
qui ni quoi."
Article de Christian Authier (L'opinion indépendante - Toulouse - le 22/12/00)
Bienvenue dans la vie.com
Comment sommes-nous passés de " l'abandon d'un monde ancien " au basculement dans le " monde nouveau " ? Telle est l'interrogation qui sous-tend Central le roman de Thierry Beinstingel. C'est à travers le prisme d'un Central des télécommunications que l'auteur décrit le changement de civilisation déjà largement accompli mais encore en cours. Quel est-il ? La conversion générale à la marchandise, " l'empire de la terre gouverné par l'objet ", le règne de la machine, " la vie vidée du sens des mots, de la parole, de la conversation et des écrits ". En prenant les télécommunications, vieux service public livré au commerce comme poste d'observation, Beinstingel s'attaque aussi à la religion moderne de la communication et de ses slogans : la liberté par le portable, le monde ouvert à tous grâce à Internet, des tonnes d'information compressées et déversées à toute vitesse… Autant de leurres censés véhiculer le Progrès et qui nous entraîne dans la furie nihiliste du temps présent : " lieux, temps, matière, tout jeter avec frénésie, le bébé avec l'eau du bain, regarder toujours vers l'avant, foncer vers le vide ". Dans ce champ de ruines où les individus sont réduits à des " charges sociales " et à des statistiques sous l'œil vigilant et omniscient de Big Brother, l'écrit traditionnel est remplacé par l'informatisation et ses étranges boîtes dans lesquels on supprime la mémoire, où l'on met les mots usés à la poubelle, mots effacés comme des témoins gênants. Le roman de Thierry Beinstingel dresse un état des lieux. Derrière le chaos du mouvement pour le mouvement se profile la vision d'un monde sans passé, sans mémoire, donc sans histoires, qui fait mine de célébrer l'avenir tout en produisant les conditions de son effacement. L'héritage et la transmission ont été sacrifiés à l'éphémère et à l'autodestruction. A l'image de ce passage hallucinant(inspiré d'un fait réel) où l'on assiste à l'occasion d'une sorte de grand salon commercial à l'édification d'une ville, peuplée d' " exposants ", de " partenaires ", ou de " clients " aussitôt démontée. Comment croire encore à cette réalité mouvante ? Comment la décrire et en traduire le pathétique déclin ? L'écrivain a fait le pari de décrire stylistiquement cette vaste entreprise de déshumanisation en occultant le sujet et en privilégiant les verbes à l'infinitif à la manière de la novlangue technocratique. Loin de nuire au roman, cette forme lui confère une puissance littéraire singulière. Autre pari réussi : quand Beinstingel raconte la disparition des frontières et des Etats en démontant et en décrivant trois téléphones d'époques différentes. Témoigner peut-être une dernière fois, qu'il a existé d'autres façons de vivre, en repérer les traces pour en ressusciter la vérité et la poésie. Ainsi la découverte de courriers administratifs vieux d'un siècle avec leurs civilités fait naître un sentiment poignant face à ce que nous avons perdu en route. Si Central évite le piège de la désincarnation et du roman à thèse, c'est aussi parce que l'écrivain s'attache aux visages et aux lieux. Il les relie au temps et au passé comme pour renouer avec le fil rompu face à la loi du " n'importe où, n'importe quand , n'importe quoi " qui scelle notre ère du " tout doit disparaître ". C'est çà la fois dans la colère et la tendresse que Thierry Beinstingel trempe sa plume. Sans doute le seul moyen de regarder sans baisser la tête ce monde qui vient.
L'interview de Christian Authier de l'Opinion Indépendante - Toulouse le 12/01/2001
Thierry Beinstingel : de l’ancien au nouveau monde C’est dans le cadre des rencontres littéraires de l’Université des Sciences Sociales que Thierry Beinstingel est venu présenter son premier roman, paru en septembre, à Toulouse. Central dresse, à travers l’évocation d’une grande entreprise nationale, un état des lieux et un tableau du monde nouveau qui se dessine sous nos yeux.
Opinion indépendante : L’écriture que
vous avez choisie pour ce roman des phrases sans sujets qui débutent souvent par des
verbes à l’infinitif est importante par rapport au thème…
Thierry Beinstingel : Pour moi, le verbe déstabilise la phrase. C’est comme
s’il apportait du mouvement à une phrase. Puis, je me suis aperçu que, dans le
monde de l’entreprise, le verbe avait une importance particulière. Dans les textes
internes, on peut lire des phrases telles que : "Faire des bénéfices". Comme
si l’infinitif apportait le temps de l’infini. Autre intérêt de
l’infinitif pour une entreprise : il permet d’éluder le sujet. Dans le
formulaire de description d’emploi que je raconte, écrire les verbes à
l’infinitif ou en supprimant le sujet entraîne une dépersonnalisation.
C’était un point important pour moi de montrer comment on parle aux gens dans
l’entreprise. Le vrai sujet du livre, c’est ce que vous appelez le passage
d’un "ancien monde" au "nouveau monde". Oui, il y a une espèce
de nostalgie. Quand on travaille de manière continue pendant vingt ans dans une
entreprise, comme cela est mon cas, on ne s’aperçoit pas des évolutions. On est
dans le feu de l’action puis, par moments, on se retourne un peu et l’on se dit
que ce n’était pas si mal.
À propos de l’informatique, vous
insistez sur le fait qu’elle ne conserve rien, qu’elle supprime la mémoire ou
met les mots à la corbeille…
C’est un problème. Avant, on gardait des liasses de papiers que l’on
stockait dans des caves poussiéreuses. Cela avait un petit côté désuet et l’on se
moquait des gens qui faisaient ce travail-là, mais cela n’a pas été remplacé.
Quand quelqu’un déménage de son
bureau, il ne conserve plus rien. Vous dites que ce travail de l’ombre incarnait
aussi une sorte de noblesse.
Oui, les choses positives du monde de l’entreprise ont disparu. On ne reconnaît
plus l’expérience. L’amour du travail, c’est-à-dire quelque chose qui se
fait dans la durée à travers, par exemple, une équipe qui travaille depuis quelques
années ensemble, s’est perdu. J’ai trois personnes qui travaillent dans mon
bureau depuis un an mais cela peut changer d’un instant à l’autre. On
déménage constamment. Il y a une déliquescence du tissu géographique et temporel parce
que l’on fait fi de l’expérience. L’informatique y a beaucoup contribué.
"Ne plus prétexter un lieu, un temps
pour réfléchir. Dire n’importe où, n’importe quand, n’importe quoi"
écrivez-vous. Cela définit assez bien notre monde…
Oui, c’est symptomatique d’Internet qui a créé une sorte d’espace
virtuel. A-t-on besoin d’autant de virtualité que ça ? Moi, j’aimerais bien
tout arrêter même si c’est difficile car on en retire des choses intéressantes.
Mais on est dans un monde que l’on a fabriqué et qui ne correspond plus à
l’idée que l’on se faisait du monde particulier avec un espace, un lieu
géographique, une histoire… On est à la croisée des chemins dans ce domaine-là.
On n’a plus de références, ni au temps ni à l’espace.
Vous montrez aussi dans votre roman comment
les mots sont aujourd’hui vidés de leur sens. Par exemple, des mots comme
"réforme" ou "progrès" recouvrent en réalité, le plus souvent, de
formidables régressions…
On rencontre cela de plus en plus à travers la publicité. On nous fait avaler un
certain langage qui va être perverti et édulcoré. D’où les verbes créés par la
pub comme "positiver" ou des phrases comme "il faut éliminer". On
détache des mots de leur sens. Plus globalement, le marketing a créé un nouveau langage
à base de slogans qui ramènent tout au produit.
À l’inverse, vous reproduisez des
correspondances administratives d’il y a un siècle et l’on aperçoit là,
derrière les formules de civilité, un certain art de vivre…
Oui, c’était un sens des rapports humains très hiérarchique mais où
l’on reliait une histoire au temps et dans l’espace. Le fait de mettre une
formule de politesse, c’est un acte de civilité mais aussi une façon de placer un
rapport humain dans la durée. C’est ce qui a tendance à disparaître avec Internet.
"Tout jeter avec frénésie. Regarder
toujours vers l’avant. Foncer vers le vide". Ce monde dans lequel on vit tend
vers une sorte de destruction permanente et de nihilisme.
On ne sait pas où l’on va. Les entreprises ne le savent pas non plus. La seule
chose qui compte, c’est l’actionnaire. Si je prends l’exemple de France
Telecom, du fait du cours de l’action, on ne peut plus avoir de politique à long
terme. C’est impossible. Quand je suis entré dans l’entreprise, le long terme
c’était la fin de ma carrière, le moyen terme cinq ans et le court terme un an.
Maintenant, le court terme c’est la semaine, le moyen terme le mois et le long terme
l’année. Il y a eu une accélération du temps formidable.
À un moment, vous égrenez des lieux, des
noms de villages de façon à "faire l’inventaire de la trace des hommes perdus
dans la solitude aimée". C’est un autre aspect du roman : relier
l’héritage aux êtres humains qui l’incarnaient…
Comme le temps va très vite, on essaie de se raccrocher à l’espace. Tout à
l’heure, je me promenais à Toulouse qui est une ville que j’ai connue
autrefois. J’étais presque soulagé de voir que certains lieux n’avaient pas
changé. D’une manière générale, les villes changent très vite. Dans les
campagnes, les lieux ne changent pas et les gens non plus. Des gens n’ont pas
évolué depuis des années et c’est parfois un peu rassurant. On sent qu’il y a
une espèce de résistance au progrès. Je ne sais si c’est bien, mais
l’évolution des gens va beaucoup moins vite que le progrès.
Vous écrivez que l’on ne
s’aperçoit des moments d’apogée et de décadence qu’a posteriori. Vous
êtes-vous demandé à quel moment les choses ont vraiment déraillé ?
Oui, je l’évoque dans le roman à travers l’histoire de cette espèce de
fête de l’agriculture qui a été réelle et à laquelle j’ai participé en
montant le réseau téléphonique dans un espace de 300 ha où il n’y avait que des
champs et où sont venues 300 000 personnes sur quatre jours. On a construit une ville
puis on l’a démontée. C’était tellement caricatural ! On s’empresse de
construire quelque chose sur un espace vide pour y mettre des choses des boutiques
d’artisanat par exemple dans lesquelles on puisse se reconnaître. J’ai voulu
être attentif pour voir à quel moment vient l’apogée et à quel moment cela
décline. J’ai l’impression que l’on est trop dans cette vitesse et
l’on n’a pas le temps de l’assimiler ou de dire : "Attention, on est
en train de perdre quelque chose…" Qui se soucie aujourd’hui de la
disparition des archives ? À quel moment créé-t-on un monde ? À quel moment
disparaît-il ?
Dans ce roman, vous mettez en scène
l’homme face à la machine.
Ce qui est inquiétant, c’est que lorsque l’on faisait des projections sur
l’an 2000, on ne s’est pas trompé sur cette vision de la machine prenant le pas
sur l’homme. On en est là. On pensait avoir mis la machine et l’informatique au
service de l’homme alors que l’on calque de plus en plus nos réflexes sur la
façon dont fonctionnent les ordinateurs. J’ai assisté à une conférence,
organisée, par plusieurs organismes de télécommunication, sur les nouvelles
technologies associées à Internet et au portable. Les gens qui détiennent le pouvoir
dans les télécommunications évoquaient les "implants corporels" ou la
dématérialisation complète. C’est ef-frayant. On est vraiment dans la
science-fiction.
Vous donnez dans ce livre ce qui pourrait
être une définition de la mondialisation : "L’empire de la terre gouvernée
par l’objet", "La régression de l’intelligence humaine dans cette
désorganisation étatique"...
On le voit encore avec Internet qui abolit toutes les frontières. On n’a pas assez
réfléchi sur le rôle de la démocratie et des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. On a tendance à les mêler. On considère que
la démocratie, depuis la chute du Mur de Berlin, est mondiale. De même pour Internet.
Comme Internet s’adresse à tout le monde, on considère qu’il est le reflet de
la démocratie. Mais qu’est-ce qu’une démocratie ? Le poids de l’Europe
vis-à-vis de la France s’inscrit-il dans le cadre démocratique ? Si une démocratie
devient de plus en plus universelle, cette universalité devient le pouvoir et derrière,
cela devient finalement une dictature. Si quelque chose obtient 90 ou 100 % des suffrages,
n’est-ce pas une dictature ? Il faudrait se poser la question en ces termes-là.
Quelle alternative a-t-on à quelque chose qui devient complètement mondial ?
Votre roman est sous le signe de "la
colère et la tendresse".
Oui, car on a tendance à tout déshumaniser. Avec la dématérialisation de la
communication, on va essayer de faire oublier l’objet mais il sera virtuellement
présent et l’humanité aura complètement disparu. Il est bon de rappeler que
derrière tout cela, il y a des hommes et des femmes, des sentiments. La colère, parce
qu’il faut se révolter contre cela, et la tendresse, parce que l’on est très
grégaire. L’un des moteurs que l’on a pour aller vers les autres, c’est la
tendresse. On n’en parle peut-être pas assez dans l’entreprise mais on a de la
tendresse, une complicité, vis-à-vis des gens avec lesquels on travaille depuis
longtemps.
Les critiques moins flatteuses, bien sûr, on les regarde avec plus d'attention !
Marianne, 11/09/2000
"N'importe quoi pour se faire remarquer ! Comment se faire remarquer dans les médias
quand on débarque dans l'univers littéraire sans nom ni piston. Plusieurs auteurs ont
trouvé la parade en ce début de rentrée. Peu importe le fond, pourvu qu'il y ait la
forme. Las de remplir des formulaires, cet ancien cadre des télécommunications a
décidé d'écrire un roman à cette image, désincarné, entre raz le bol, amertume et
poésie déglinguée."
Ce que j'aimerais, un forum...
Oui, un forum sur
l'écriture du travail, le travail de l'écriture en entreprise, rendre le boulot en mots,
prendre les mots du boulot, littérature et entreprise, qui prend le pouvoir des mots ?
Faites-moi part de vos expériences, remarques, lectures sur le sujet : Contact
Parmi les indispensables sur le sujet :
"L'excès/L'usine" Leslie Kaplan, POL
"Sortie d'usine" François Bon, Ed de Minuit
"L'établi" Robert Linhart, Ed de Minuit