|
Notes d'écriture 2011
« On écrit sans doute
parce qu’on a rien d’autre pour tenir droit dans un monde de travers ».
« Ce qui continue de me toucher et de m’intéresser chez Beckett, c’est la
corde de langue : à la fois l’usure et ce qui tient. Et son humour. Et sa
profondeur non-didactique. ».
« Il y a cette pièce, la véranda/salle à manger habituelle : il y a moi qui
tâche de penser, écrire, attend, rêvasse, en tout cas moi ; il y a mon corps qui
entend les bruits de la cuisine (machines) ; il y a S. qui regarde le film Sur la
route de Madison ; il y a le bruit du film dans mon dos et le froid qui vient…
J’en oublie mais tout se percute en un présent parfaitement lisible et simple à
vivre si je restreins l’angle sur le seul « il y a ». Si j’en prends
3-4 ensemble – et c’est bien ce qui est vécu- écrire s’engorge. »
« Ma vie j’ai perdu beaucoup de temps à la gagner. On ne résiste pas au
plaisir d’un bon mot comme seul ressort. C’est un peu comme pour l’image
qui clinque. On finit sans doute pas dans le mauvais, mais sans doute pire, dans le
médiocre. Décidément, écrire n’est pas se faire plaisir, mais se mortifier
n’aboutit pas à grand-chose non plus. Il faudrait récupérer la force de frappe du
« bon mot » mais la mater, la rendre mate. »
« Je crois n’avoir jamais connu que des poètes fêlés. Qu’ils soient
bons ou mauvais est une autre affaire, mais ce lien entre écriture et fêlure, oui. Et
une fêlure d’être, profonde, pas l’égratignure sociale ou l’écorchure
de la vanité. Pas non plus des êtres cassés, sinon l’écriture cesserait. Des
bancals, des boiteux d’être. Et chez les vrais lecteurs, de même, car il faut
pouvoir entendre de son de cloche fêlée ou d’enfant qui pleure presque en
silence. ».
« Les livres finissent toujours en piles. Pour le tablier du pont, c’est le
boulot du lecteur. ».
« Ce n’est pas moi qui ne change pas, c’est vivre qui bouge peu. ».
« Semoule de la fatigue ; empêtrement de tête ; vitesse de traîne.
Dehors-étau. ».
« Je suis intimement persuadé que la vie conditionne l’écriture dans son
ensemble. Donc la critique biographique serait légitime. Mais son erreur tient à ce
qu’elle pose une relation simple de cause à effet alors que la relation
vivre/écrire est infiniment plus compliquée. ».
« La poésie a-t-elle un avenir ? Ah… C’est déjà lui accorder un
présent. Au moins elle n’est pas morte. ».
« Je me méfie toujours de ceux qui affirment avoir « une haute idée
de… » J’aime mieux les idées basses et les mains au charbon. ».
« Il y a une limite dans l’auto-analyse, le doute, l’autocritique…
C’est le « Bon qu’à ça » de Beckett en réponse à
l’enquête : Pourquoi écrivez-vous ? Quand on écrit, on ne répond à
rien : on répond qu’écrire est préférable à rien. Même si on n’écrit
pas grand-chose. ».
« Mesurer
les effets, toujours. Ne pas chercher à en faire trop, à s’épater soi-même :
un poème carré gris sur fond gris. Un mot comme
" évanescent " bousille facilement trois pages : la précédente
qui t’a amené là, la page que le mot tache, et la suivante, le temps d’oublier
le couac. ».
« Les avant-gardes finissent toujours dans le
gros de la troupe… si elles ne meurent pas aux avant-postes. Pour ma part, j’ai
toujours préféré l’ancienneté comme mode d’avancement. Ça donne le temps de
réfléchir. ».
« Un nouveau livre est à la fois une grande peur, une indifférence (c’est un
livre de plus), et une certitude : j’ai besoin de ce livre, maintenant. Je
l’ai travaillé jusqu’à épuisement : à lui, maintenant, de produire
l’énergie. ».
« Selon certains, ma poésie manque autant d’humour que d’amour. Ce
n’est pas faux : je n’ai pas tout en magasin. Et si on entre chez le
boucher pour acheter des légumes… ».
« Rester sur du très simple, parce que c’est le plus compliqué à vivre. Donc
c’est là que les mots me sont nécessaires pour éclairer. Le poème est d’un
usage quotidien : disons que c’est un torchon de cuisine, pas un linge sacré à
usage exceptionnel. »
Citations et aphorismes d’Antoine Emaz, Cambouis
(28/12/2011)
Saint-Brieuc : mon père m’énerve… C’est façon
de dire : lui qui a connu toutes les villes de l’Ouest quand il était chauffeur
routier, me signale que c’est une très belle ville (pas moyen de le prendre en
défaut sur une destination de Bretagne, déjà, l’année passée, lorsque
j’avais été reçu à Lesneven chez Jean-François Delapré, bien sûr il
connaissait). Me voici donc à Saint Brieuc : un peu de retard du TGV, l’accueil
sympathique de Soazic et Laetitia et je suis installé. Juste un peu de temps pour visiter
le centre-ville et avec un parapluie : depuis hier, on ne parle que de l’avis de
tempête qui va toucher la région. Pour l’instant, c’est quelques gros crachins
épars, un peu de vent. J’avais apporté l’appareil photo : ciel sombre, le
crépuscule déjà, j’avais prévu d’étoffer la rubrique Webcam, mais j’ai
finalement trop peu de clichés. L’office du tourisme m’indique un musée
d’histoire tout proche, parfait pour le peu de temps dont je dispose. C’est un
musée désert et c’est toujours pour moi un plaisir de déambuler comme unique
visiteur dans des salles où les pas résonnent. Ici, bien sûr, la mer : objets
retrouvé sur des épaves vers l’île de Bréhat, vie quotidienne de la pêche,
objets usuels, de beaux meubles et l’inévitable lit-armoire qui me fait penser à ce
film (Hôtel de la plage ?) où un jour de pluie, un couple de visiteurs réfugié
pareillement dans un musée désert essaie l’intimité du lieu. Belle exposition sur
la photographie au dernier étage avec une vieille publicité qui vante les films Kodak,
vraisemblablement publiée à l’occasion d’une exposition universelle, ce qui me
rappelle 1937 Paris-Guernica où je décrivais
l’arrivée des véritables pellicules photo couleurs destinée au grand public. Un
dernier tour dans les rues piétonnes avec cette sensation étrange (et regrettable), moi
qui revient de Porto, de retrouver pareillement ces ambiances d’avant-Noël, sapins,
guirlandes, décorations dans des magasins aux marques internationales et qui dépaysent
si peu.
Mais je suis venu ici pour une rencontre à la maison Louis Guilloux, et non pour y faire
du tourisme. C’est pour moi important parce que Louis Guilloux, briochin
jusqu’à ses derniers jours, représente un écrivain authentique et important et
cette reconnaissance envers l’enfant du pays me paraît essentielle, dénuée
d’esprit chauvin. La maison Louis Guilloux, lieu de rencontres et de résidence, a
effectivement appartenu à l’écrivain, c’est là qu’il vivait
lorsqu’il renouait avec sa ville natale. Il y a même son bureau, malheureusement pas
visitable. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un thème Littérature et
travail avec une manifestation par mois. La formule est intéressante, elle permet de
fidéliser un public par ce thème, et la découverte des auteurs est totale. Et
réciproque ! C’est toujours pour moi un très grand plaisir d’échanger
avec ceux qui ne vous connaissent pas ou peu, il me semble que nous avons en commun cette
espèce de boule de littérature, pompon d’un manège suspendu avec joie au dessus de
nous, que nous tentons de saisir eux et moi. Soazic avait préparé la rencontre avec
minutie et efficacité, ce fut donc un plaisir d’avancer et d’expliquer le petit
chemin de mon inspiration à la quinzaine de personnes présentes. Questions, réponses,
véritable échange il me semble, tandis que dehors la pluie forçait encore.
L’échange s’est poursuivi au restaurant et un grand merci à Soazic, Laétitia,
Nathalie (qui a en projet un beau programme sur le même thème en octobre 2012 ) et Jérémie lefebvre, auteur en
résidence chez Louis Guilloux et qui prendra la suite en janvier : le lieu porte
chance, qu’il en profite.
(21/12/2011)
Je relis rarement mes livres parus. Peut-être parce que j'ai un
rythme de publication assez élevé, un livre chassant l'autre. En fait, je ne sais pas
trop, j'ai l'impression que le même oubli adviendrait si j'avais une production moins
suivie (on dirait un industriel qui parle…). C'est peut-être simplement le temps qui
passe et qui fabrique cet oubli. Dernièrement, j'avais relu Paysage et portait en
pied de poule parce qu'un libraire distrait avait commandé une pile de ce roman paru
en 2004 (et passé presque inaperçu) pour un salon auquel je participais. Dans l'attente
du chaland qui s'arrête à ma table, j'avais relu ce livre, et ma foi, en toute modestie,
je l'avais trouvé pas si mal, avec une sorte de lyrisme qui s'attache à la terre et à
ce coin de campagne que je tentais de décrire.
Il y a quelques jours, en me souvenant d'une question posée lors du colloque de Porto
pour savoir à partir de quoi j'avais écrit Composants en 2002, m'est revenue,
non pas l'envie de relire ce livre qui, comme tous les autres est sagement à ma portée
sur mon bureau, mais de feuilleter les catalogues de composants et d'engrenages qui
m'avaient inspirés à l'époque. Là aussi, facile de les retrouver : je les sais
d'instinct regroupés sur une étagère derrière moi. Il y avait un site Internet d'indiqué dessus
que je me suis empressé d'activer. Bien sûr, j'ai retrouvé intact l'étrange émotion
que j'avais retranscrit ainsi :
" Pignon arbré, galet tendeur, circlip externe, écrou six pans, courroie crantée.
Succession des mots, rythme, les bruits qu'ils font : brouhaha d'atelier, vacarme de
machines, chocs des marteaux.
Vis, roue, bague, arbre, cardan, rotule, limiteur, entretoise, crémaillère.
Les formes qu'on imagine prenant vie à la lecture. Les fonctions, rôles, tâches,
besognes qu'on leur colle dessus.
Roue à
rattrapage de jeu, motoréducteur à rapport simple, bloc palier pour vis à bille, amortisseur rotatif bi-directionnel, glissière
linéaire de précision.
L'humain qui se profile derrière, ombres discrètes du travail, ramasseurs d'expérience,
inventeurs de gestes, ce qu'on traduit par cette complexité modeste des mots, tout ce qui
fait que d'une phrase laconique " tête de bielle cassée ", entrevoyant d'un
coup les gestes qu'il faudra accomplir, capots, carter à démonter, vis graisseuses, le
temps passé, l'attente de la réparation, la vie mécanique arrêtée, la vie tout court
en sommeil, la commande de la nouvelle pièce, les délais, la dépense, la réception, le
remontage, le temps qui reprend son cours. Mots puissants comme ceux des poèmes.
Mignonne, allons voir si la rose... Il a deux trous rouges au côté droit... La désuète
promenade et la leçon du temps qui passe ou la guerre et la mort, tout cela aussi contenu
dans " tête de bielle cassée ". "
(Composants, p. 186-187).
Les catalogues qui ont servi à la rédaction de ce roman, dix ans auparavant, sont
toujours en photos sur le site (1
et 2)
(14/12/2011)
Choisir Porto la besogneuse pour évoquer littérature et travail
dans un colloque international était forcément une idée judicieuse. Merci donc à José
Domingues de Almeida et à Maria Joao Reynaud
d’avoir organisé cette rencontre qui se voulait, sinon mondiale, au moins étendue
autour de la langue française. Et c’est presque à la frontière avec
l’Allemagne que j’ai appris son existence, lors d’une rencontre à la
librairie Quai des Brumes à Strasbourg en mai dernier par Corinne Grenouillet,
universitaire dans la même ville. La tentation étant très forte d’y retrouver ceux
que le sujet passionne comme moi, j’ai envoyé dans les dernières limites un projet
de communication qui a été accepté. De
même, la présence de Claudio Panella, avec qui j’échange depuis quelques années,
me paraissait indispensable. Son acceptation a été une grande joie. Ajoutons à cela que
Martine Sonnet, rencontrée à
Le colloque a ainsi débuté sous les meilleurs auspices par une conférence de Paul Aron,
qui a très bien su replacer le contexte historique mêlant littérature et travail en y
ajoutant les enjeux politiques, les réticences littéraires et les caractéristiques de
style qui ont précédé notre époque moderne. Et comme j’avais la chance de
commencer le premier, mon intervention s’est insérée à la suite pour dresser un
panorama de la littérature du travail depuis Mai 68. Isabelle a continué par la
présentation d’un plan dans lequel elle pose la question d’un « nouveau
roman expérimental » qui ferait suite à la notion définie par Zola. Martine a
terminé cette première série en racontant la naissance de son livre Atelier 62.
Si Chantal Michel s’est occupée ensuite de me passer à la radiographie, Corinne
Grenouillet a fait de même avec Martine Sonnet en l’incluant dans les
« récits de filiations » et je suppose que pour elle, comme pour moi,
c’est toujours un moment étrange de devenir ainsi un « objet
d’étude », en quelque sorte, une schizophrénie de plus… Tania Ladaric
Régin a abordé les employés de commerce et notamment les romans des caissières, une
caractéristique étonnante de ces dernières années et que j’avais déjà
remarquée. Isabelle Bernard Rabahi, (de l’université d’Aman en
Jordanie !) a présenté Petites natures mortes
au travail d’Yves Pagès et Marie-Pierre Boucher (de l’université de
Montréal) a apporté un éclairage sur la persistance du travail chez Les Baldwin de l’écrivain québéquois
Serge Lamothe. Parmi les universitaires portugais Maria Hermina Amado Laurel a évoqué un
parallèle original entre l’image des femmes au travail dans Daewoo de François Bon
et les romans plus anciens d’Alice Rivaz. Corina Da Rocha Souarez a comparé Stupeurs et tremblements de Nothomb avec Extension du domaine de la lutte de Houellbecq,
Isabel Veronica Ferraz de Sousa a creusé le thème du travail chez Jean-Luc Outers et
Agripina Carriço Viera a proposé l’œuvre de Antonio Lobo Antunès (seule
intervention en portugais). N’oublions pas Maria Joao Reynaud qui a donné une
intéressante allocution sur travail, oisiveté et poésie. En dernier – et combien
j’attendais ce moment - Claudio Panella nous a retracé un bref historique du roman
d’entreprise en Italie et les tendances étonnantes du moment concernant les récits
de télévendeurs (Retour au mots sauvages
n’a rien inventé) ou ceux des « coupeurs de têtes », autant
témoignages que romans satyriques au ton sarcastique pour dénoncer la précarité.
En tout, ce colloque aura donc réuni quinze
interventions, sans compter la conférence de clôture de Daniel Leuwers sur le
travail décrypté (ou plutôt emmêlé…) par Houellebecq. Martine Sonnet en fait
également une restitution
ainsi que Maryse Vuillermet. La suite ? Il est évident que le sujet du
travail dans la littérature ne peut rester uniquement francophone dans les profondes
modifications qu’apporte la mondialisation. Et déjà rien qu’au niveau
européen il reste beaucoup de points de vue à croiser. Le monde avance vite ! La
suite, donc, on attend, on reste en contact, on est près à réserver des dates mais en
attendant, ce colloque m’a donné du courage pour enfin attaquer la rédaction de ma
thèse. Et merci à tous pour ces moments d’amitiés et de partage.
(07/12/2011)
Il y a quinze jours, dans cette même rubrique, j’annonçais la
remise d’un texte au nom de code ID et je
terminais par l’inévitable peur qui vous taraude une fois le manuscrit remis. La
peur ? Elle existe pour tous, je crois en de pareilles occasions, qui plus est pour
qui, comme moi, manque de recul pour apprécier un texte : je ne fais jamais lire à
quiconque, je ne fournis pas d’extraits, je balance à la fin la totalité de mon
écriture au dessus de la piste aux étoiles sans le moindre filet. Ceci dit, mon numéro
de trapéziste a duré quatre mois, c’est finalement pas grand-chose comme durée
d’écriture. C’est sans compter l’inévitable gestation impalpable des mois
précédents, les atermoiements, les fausses routes, les répétitions, la part de
travail. Comme pour l’artiste de cirque qui doit inlassablement répéter son numéro
pour rester dans cette comparaison de chapiteaux, il ne faut pas minimiser cette part
d’ombre besogneuse. Pour autant, quatre mois d’écriture, c’est très
rapide et ramassé : on demeure dans l’ignorance et dans l’incapacité de
savoir « ce que ça vaut », est-ce que c’est publiable, de deviner le
sort final du manuscrit : restera-t-il dans les tiroirs, se matérialisera-t-il en un
nouveau livre ? La peur à la remise du texte se construit à travers cette
ambiguïté, cette perplexité. Cette peur aura été de très courte durée. Nous avions
convenu d’un rendez-vous à la fin de la semaine suivante. Et j’avais abordé
sans trop vouloir y penser la petite dizaine de jours qui me séparait du rendez-vous
éditorial et de la sentence finale. Heureusement, un week-end entre amis prévu depuis de
longue date devait me distraire de cette attente. Le samedi donc, un peu avant midi alors
que j’appréciais une promenade radieuse le long des canaux de Briare (temps et
paysages magnifiques, joie de se retrouver tous), j’ai reçu sur mon portable le
signal d’un SMS : le message provenait de qui devait lire ce fameux texte et les
termes étaient suffisamment rassurants pour provoquer en moi une joie incommensurable au
milieu de cette promenade. Le même message me fixait, sans attendre la fin de la semaine,
un rendez-vous téléphonique pour le lundi suivant. Inutile de dire que la peur
s’est instantanément évanouie. Mais paradoxalement, pas l’inconstance qui
présidait à celle-ci : je demeurais incapable (je le suis encore) d’évaluer
ce que j’avais fourni. Ainsi, le lundi, lors de la conversation qui prolongea de vive
voix le SMS, je suis demeuré embarrassé par les quelques compliments qu’avait
suscité le texte remis, je suis resté confus, désorienté, empoté et emprunté
(c’est le mot, on m’avait emprunté comme une sorte d’objet qui ne
m‘appartenait pas). En même temps je m’en voulais de ma gaucherie, j’avais
l’impression de donner une piètre image de moi en tant qu’auteur à qui on
attribuait quelque intérêt. Il n’y a aucune fausse modestie dans cette attitude, je
crois qu’elle s’explique simplement par l’absence de toute réflexion entre
le texte à peine terminé et sa remise. Le manque de recul, l’élaboration des
phrases à peine terminées et qui dansaient encore en moi empêchaient encore tout
discernement, toute compréhension. J’ai toujours constaté à chaque fois que
j’ai terminé d’écrire un texte, une étrange amnésie, souvent brutale, un
incontrôlable oubli envers le texte à peine terminé, comme si, en relâchant la
pression d’écriture, j’abandonnais jusqu’au souvenir même du texte et de
son intrigue. Je crois que celui-ci n’échappe pas à la même attitude et je sais
que je retrouverai avec un plaisir immense la réalité du texte lorsqu’il
s’agira de travailler les mots au corps à corps pour parfaire la publication. ID est prévu pour septembre 2012, le titre
demeure incertain.
(23/11/2011)
A peine le manuscrit remis à mon éditeur, il est temps de revenir
à un autre de mes passe-temps favoris, la littérature et le travail et la thèse de
doctorat que j’aimerais bien achever. Pour autant, malgré l’écriture du
nouveau livre en préparation, je ne serai pas resté bien longtemps sans y penser,
puisque je suis intervenu fin septembre dans un séminaire de l’INRS (Institut
National de Recherche, Santé et Sécurité au travail) à Pont-à-Mousson pour y
présenter un panorama sur la littérature du travail depuis Mai 68. Le public était
constitué de sociologues, préventeurs et autres spécialistes de la prévention. Cette
présentation m’a été utile, car j’ai pu dégager un certains nombres de
thèmes que je pourrai reprendre et approfondir dans la rédaction de ma thèse. Dans
quinze jours, je participerai également à un colloque international sur ce thème à
Porto et me reviendra l’insigne honneur de débuter par ma contribution les deux
jours d’échanges prévus. A noter que Martine Sonnet sera également présente,
ainsi que Claudio Panella, universitaire de Turin, avec qui j’ai déjà maintes fois
échangé et qui est même à l’origine de Retour
aux mots sauvages puisque c’est en répondant à une de ses demandes pour une
nouvelle destinée à une revue qu’il anime que j’avais eu l’idée de
reprendre ce début de manuscrit resté quelques mois inoccupé. Il y aura également
d’autres universitaires qui me sont chers et je figure aussi en tant qu’objet
d’étude ce qui est toujours un peu déroutant (une schizophrénie de plus…). Et
m’est venu une idée, alors que je me demandais si je devais préparer une
présentation Powerpoint pour ce colloque (renseignements pris, ce n’est pas dans les
us et coutumes de ce genre de manifestation) : je lirai le texte de ma présentation
sur Ipad, ça sera hyper chébran !
(16/11/2011)
Terminer un livre est toujours un moment magique. Pour le texte en
cours, je m’étais fixé une date depuis deux mois, disons plutôt une intention de
fin aux alentours du 11 novembre. A force d’écriture, on sait comment le texte en
cours avance, on en connaît les enjeux, les rythmes, on y ajoute les propres cadencements
de la vie autour, boulot, famille et autres occupations. Sans compter qu’une
écriture est toujours chancelante et mystérieuse : comment savoir dés les
premières pages qu’on ira jusqu’au bout ? Et combien de pages ça va
prendre ? Donc, dans cette même rubrique, il y a deux mois exactement, c’est 15
pages par semaine que j’avais imaginé pour terminer le machin au nom de code ID. Et ça a tenu ! J’ai même terminé
avec un peu d’avance, ce samedi matin, avec la veille une longue séance
d’écriture, comme on dit la dernière ligne droite - et c’est peut-être aussi
pourquoi je m’étais suis fixé un objectif de courses à pied en parallèle.
J’aurais ainsi mis exactement quatre mois moins deux jours pour écrire ID. Commencé le 7 juillet je l’aurai débuté
chez moi avant de le solidifier pendant mes vacances en Sicile et c’est au retour que
j’ai comptabilisé chaque vendredi l’avancement : si au 2 septembre,
j’en étais à peu près à la moitié (120 pages, format roman), j’étais
plutôt sur un rythme de 12 pages par semaine et je constatais ici même le 18 octobre un
retard d’environ une semaine. Pas très grave, mais c’était sans compter
l’aiguillon que provoque un tel constat. Bref, les deux semaines suivantes ont
compté 40 pages et le machin s’est terminé ce samedi sur une longueur qui devrait
avoisiner les 250 pages (à noter que pendant les quatre mêmes mois d’écriture,
j’aurai couru exactement
(08/11/2011)
Autour de Franck,
c’est cette lecture mise sur pied avec Anne Savelli parce que
son livre (Franck) m’avait inspiré un
texte (Avant Franck) : voir dans cette
même rubrique le 28/09/2011. Pour une parution prochaine de nos textes via Publie.Net (ne pas oublier dedans
l’inédit de Anne Douze façons de plus de
parler de toi), nous avons réitéré la lecture que nous avions faite à la
médiathèque de Montreuil et nous l’avons enregistrée. En effet, l’édition
numérique permet cette avancée : pouvoir lire le texte sur Ipad ou toute autre liseuse avec le même confort
qu’un livre papier mais aussi pouvoir en plus en écouter la lecture. Bref,
c’est uniquement pour ce « plus », tout de même très important, que je
suis revenu à Montreuil où Anne est assignée à résidence (voir en note
d’étonnements…). Sa cellule est monacale, au sous-sol. C’est un choix
délibéré. Il faut arpenter les espaces immenses de cette médiathèque pour finalement
s’apercevoir que la vie qui se cache dans une bibliothèque ne se réduit pas aux
travées réservées au public. De la même manière qu’un un livre ne se réduit pas
à sa seule consommation, il faut en imaginer les entassements, les rebuts, les
purgatoires, les dons, les exemplaires défraîchis, les passés de mode, les jamais
réclamés, tout un empilement de papier qui se cache derrière les portes marquées
généralement « Privé » ou « Réservé au personnel ». A
Montreuil, c’est dans le dédale des garages à moitié enterrés que
l’entassement a lieu : une biographie de Pierre Mondy voisine avec la
correspondance de Proust, le vélo d’un bibliothécaire avec un vieux fauteuil, la
littérature s’évase ici au sens large et il a fallu tout l’art de Anne Savelli
pour sentir que l’écriture ne pourra se déployer que dans cette pièce presque
borgne (seul un soupirail à moitié caché par des étagères apporte indirectement la
lumière du jour). En habituée des oloé dont elle a créé le
mot (note de lecture du 27/07/2011), elle a réussi à glisser une table contre un pilier
avec une cafetière, une lampe et un radio-CD dessus, un fauteuil devant, un radiateur à
côté, l’ensemble ramassé, objets se touchant, livres empilés comme si
l’espace immense de ce sous-sol devait se rassembler au pied de ce pilier comme dans
une aimantation magique. J’aurais voulu d’ailleurs photographier l’endroit
dans ses détails : l’affiche sur le pilier, l’inox de la lampe, le paquet
de café entamé. Ceci dit, cet endroit n’est qu’un refuge, la plupart du temps,
on le sait, Anne se balade en robe rouge parmi le public, chante à tue-tête les tubes de radio Nostalgie en couvrant des livres avec
application. Le refuge aurait dû se révéler bien pratique pour l’enregistrement de
notre lecture, ainsi loin du passage des divers utilisateurs mais c’était sans
compter les portes qui claquent et les talons qui martèlent les planchers au-dessus.
Ainsi, dans la version « live », en écoutant bien, l’auditeur attentif
saura distinguer entre deux phrases le grincement d’une porte de garage ou une
talonnade précipitée : seuls ces bruits parasites en garantissent
l’authenticité et toute autre version lisse et sans cliquetis ne sera qu’une
pâle copie, une vulgaire imitation, un succédané de littérature. Vous êtes prévenus.
(01/11/2011)
Bien sûr, le livre de Lydie Salvayre consacré à Jimi Hendrix a
réveillé en moi pas mal de souvenirs, plutôt proches d’ailleurs. Ainsi ce texte
écrit en 2007, un roman qui pesait bien 350 pages et dont le souvenir de Hendrix hantait
les protagonistes. Refusé, qualifié sans doute avec raison de « trop pieds
nickelés » par mon éditrice, il est resté dans un tiroir. C’est le moment
d’en extirper un extrait :
« Avec Hendrix, c’était déjà une
histoire ancienne. Si le Hot Club de France avait provoqué les premiers émois musicaux
du Vieux, l’après-guerre qui traînait en longueur n’avait pas su continuer à
le faire vibrer. La môme Piaf avait pris le relais des ondes et les rythmes de jazz
s’étaient assagis dans des ritournelles où la langue française semblait aussi à
son aise qu’un camembert dans une boite de Coca Cola. Il fallait chercher autre chose
en tournant le gros bouton noir des postes de Bakélite et regarder l’aiguille
s’acheminer dans des grésillements inaudibles sur des destinations qui faisait
pourtant rêver : Londres, Rome, Moscou et d’autres encore plus exotiques comme
Oslo et Droitwitch. C’est drôle, quand on y pense, comme ce matin donc, ce souvenir
est immanquablement associé à Madame, alors enceinte du premier enfant, et qui venait
interrompre la recherche poétique des géographies de la TSF en réclamant son feuilleton
radiophonique. De même que la môme Piaf par ailleurs demeure étrangement associée aux
coquillettes et à la lessive du lundi, suspendue au-dessus de la cuisinière à
l’aide du séchoir parapluie fixé autour du tuyau et qu’il fallait tout le
temps resserrer pour éviter que le linge ne s’effondre sur la plaque en fonte
brûlante. Après il y a un vide. Ou plutôt un trop plein : deux puis trois enfants,
cette folie d’acquérir un magasin d’électroménager parce que la télévision
c’était l’avenir. Madame l’y avait poussé. Grandin, la Voix de son
maître et Radiola, le Vieux était devenu incollable sur ces appareils. Et, en bon
commerçant qu’il avait appris à être, le défilé était permanent pour voir
comment fonctionnait l’ORTF dans l’appartement devenu trop petit. Pendant ce
temps, Hendrix devait encore user ses dernières culottes courtes et n’avait sans
doute pas encore touché de vraies guitares. La folie anglo-saxonne avait pourtant
commencé, après les Beatles, les Stones inauguraient un style plus décoiffé encore
mais qui plaisait bien. Il découvrit par la même occasion le rythm n’blues,
simplifié plus tard en blues. Cependant, les producteurs de Piaf et autres chansonnettes
commençaient à lorgner sur ce potentiel musical. Donc le yé-yé était venu et il
s’était trouvait décalé, obsolète, chamboulé, de là date sans doute ses
premières velléités à se baptiser le Vieux. Il attendit patiemment le retour de cette
forme de jazz qu’on baptisait déjà Rock’n Roll au lieu de ces mièvreries
édulcorées. L’adoption par sa progéniture des us et coutumes délivrés avec la
mode des vestes en peaux de mouton et des pattes d’éléphant acheva de reléguer pour plus tard cette musique qui décidément
n’était pas pour lui. L’heure était au collectif, aux manifs, l’individu
n’existait plus, on parlait groupe. Deep Purple, Led Zepellin, les Who se
multipliaient en Téléphone, Martin Circus, Ange et autres légumes dignes d'un pot au
feu bien français. Le Vieux ne s’y retrouvait pas et moi non plus d'ailleurs.
Hendrix était déjà mort quand il découvrit que Johnny Halliday n’était pas
l’inventeur de Hey Joe. Ni même Jimi
mais sa version à lui par rapport à celle du chanteur nationalisé revenait à comparer
Cassius Clay, alias Mohammed Ali, avec Monsieur Muscle à la Foire du Trône. »
(26/10/2011)
Trois-quarts de bouquin, c’est à peu près la distance déjà
effectuée pour le nouveau livre en cours. Nouveau livre d’ailleurs,
l’appellation est prématurée. Je ne l’ai même pas encore présenté à mon
éditrice, je n’ai aucune idée de ce que ça « vaut » (traduire :
est-ce publiable ou non ?). En attendant le secret espoir de pouvoir envisager une
parution pour l’année prochaine, je continue, à peu près dans les objectifs que je
m’étais fixés : pouvoir terminer vers mi novembre. Trois-quarts de bouquin,
donc, une distance que j’avais envisagée de faire avancer en même temps que ce qui
me tient d’aplomb, quinze pages et quinze kilomètres par semaine avais-je annoncé
dans cette même rubrique comme bonne résolution de rentrée. Force est de constater que
les quinze pages sont parfois difficiles à tenir, j’accuse un déficit d’une
dizaine de pages sur le programme prévu, ce qui n’est pas énorme, ceci dit. En
revanche, côté course à pied, j’ai accompli quatre-vingts kilomètres de plus que
prévu et l’entrainement pour le semi-marathon (voir en étonnements) y est pour
quelque chose, forcément. Même si cet équilibre est un peu différent, je demeure
persuadé que ces activités sont intimement liées pour moi et pour l’instant, elles
doivent avancer de concert.
(18/10/2011)
A l’invitation de la médiathèque de Chevilly-Larue, j’ai
été convié avec Gérard Mordillat pour une rencontre sur le thème générique des
« résistances ». J’attendais avec grand plaisir cet évènement
notamment parce que Gérard Mordillat me semble emblématique d’une vision importante
de la littérature du travail sur le monde ouvrier. Pour faire court (cours ?), le
monde ouvrier a représenté jusqu’au début des années 80 une part importante,
sinon exclusive de la vision littéraire du travail, placée dans l’héritage de Zola
dans l’esprit du public, et dont la littérature prolétarienne, initiée par Henry
Poulaille dans les années 30, constitue l’âge d’or. Or, au début des années
80, si quelques livres semblent encore aborder le thème de l’ouvrier et du travail
d’usine, comme Sortie d’usine de
François Bon ou L’Excès l’usine de
Leslie Kaplan, la question devient rapidement différente, notamment suite à la
désindustrialisation brutale qui touche
Gérard Mordillat, avec son dernier roman Rouge dans
la brume, termine ainsi un tryptique dédié au monde ouvrier, à la manière dont Dos
Passos avait donné avec USA une image de
l’Amérique des années 20 et 30. Autres éléments d’échanges très
intéressants récoltés à Chevilly Larue, c’est son rapport très étroit au peuple
et sa manière de se dégager de l’héritage imposé de Zola (les Goncourt et Zola
avaient peur du peuple, dit-il). Il replace également le contexte littéraire dans le
travail : dans Les Vivants et les morts,
lorsque le chef d’équipe, contre toute attente est également licencié, c’est
une scène de Shakespeare qu’il entrevoit (Je ne suis plus roi - Richard II ?).
La littérature du travail, dit-il en substance, possède en elle-même une part
suffisante de romanesque et il n’est pas besoin de considérer comme obligatoire un
regard sociologique basé sur des témoignages, ce que la plupart croient. C’est
également cet écueil qui prédomine dans la littérature actuelle du travail, sans doute
une conséquence des Sciences humaines qui semblent avoir pris le pouvoir ces dernières
décennies sur les questions de société à la place du romanesque ( les fameuses
« filles matricides » de la littérature, selon Michel Rio).
Bref, ce fut un bon moment. Mes remerciements vont également à Marie-France Daniel qui a
organisé cette rencontre et à Elsa Fayner qui l’a animé avec brio, et dont je
recommande le blog très bien informé, chroniques de l'humain en entreprise Voilà le travail.
(12/10/2011)
Autour de Franck, tout autour, rien autour, pas loin, plutôt près, Anne, robe rouge
devant le micro et le cube blanc qui lui sert de pupitre, les feuilles en suspension dans
sa main, le regard glissé (prêt ?) et ça commence. Pour qui n’a jamais
entendu une lecture d’Anne Savelli, la voix surprend, équilibre, hauteur, timbre,
les mots tombent pile, tout autour, rien autour, pas loin, plutôt près, juste placés,
s’assemblent, font sens, décrochent dans nos têtes les premières images. Seulement
ensuite la phrase s’allonge, une nage dans une eau claire et froide, un souffle
d’habituée, chaque mot qui se détache, brasse parfaite, crawl idéal, et nous, tout
autour, rien autour, pas loin, plutôt près, on la suit, l’œil au raz de
l’onde, délié de toute pesanteur, en suspension.
Vient mon tour de me jeter à l’eau : retenir son souffle, le saut dans le vide,
le contact avec la surface des mots, plutôt rugueux les mots, ça fait un drôle
d’effet, les dire, les voir comme un tas de cailloux en vrac. Très vite pourtant, on
en perçoit l’alignement, ce qui se construit à les prononcer à voix haute (faire
attention à ne pas laisser tomber les feuilles, à ne pas s’éloigner, ni coller le
micro). Alors, entasser, charrier, transporter, bientôt rouler des brouettes de syllabes,
bâtir des murs, fondations, le texte est long à dire, six ou sept minutes
d’affilée pour commencer (je construis une gare), je ne vois personne, je suis
seul : chantier interdit au public.
Mais le public et Anne à nouveau (je pose la brouette), à nouveau la nage, l’eau
claire, le texte qui parle de Franck, ballotté de vagues (avis de grand frais sur la mer
du Nord), Franck, Franck, Franck encore et toujours, avant, après, tout autour, rien
autour, pas loin, plutôt près.
Puis moi, puis elle, et ainsi de suite.
La lecture croisée de nos deux textes durera quarante cinq minutes. Pour Anne, extraits de Franck et un inédit (Douze façons de plus de parler de toi), pour moi
aussi un inédit (Avant Franck) écrit tout
exprès pour l’occasion. A la fin, on se regarde un peu étonné (mes brouettes
poussées en chemisette noire, sa nage en robe rouge). Quelques applaudissements suivent.
Ça s’appelle Autour de Franck (tout
autour, rien autour, pas loin, plutôt près), ça va sortir aussi chez Publie.net, textes et fichier son
inclus.
(28/09/2011)
Quinze pages par semaine, quinze kilomètres de course, ai-je écrit
il y a trois semaines. Ça tient à peu près, mieux pour la course que pour
l’écriture, mais je me heurte à cette sensation, souvent maintes fois ressenties du
trop plein de la vie qui fait que vous vous retrouvez dans ce retour rapide à la table
d’écriture avec la page précédente juste terminée, sans avoir eu le temps de
penser à une suite. S’ensuit parfois une sensation de décousu, de chapitres qui se
suivent avec des choix définitifs, choses racontées auxquelles je ne saurais renoncer,
simplement parce que c’est écrit et que je me fie à cet instinct qui
m’empêche de tout reconsidérer. Et d’ailleurs pour quels bénéfices ?
Qu’est-ce que la réécriture apporte ? C’est sans doute exagéré.
J’ai borné de jalons cette écriture au long court et j’ai mûrement réfléchi
aux options narratives, de style qui s’offraient à moi. Reste aussi au long des
insomnies, ce texte qui travaille. Je dors très bien mais chaque réveil sera
automatiquement occupé par le livre en préparation, c’est peut-être ma manière de
ne pas l’oublier et de mettre à profit le moindre interstice de ma vie au service de
ce qui est en cours. N’empêche que je retrouve au lendemain la page, non pas
blanche, souvent précédée de ce qui a été écrit avant et que cela provoque, non pas
un vertige, mais une attente que les mots qui vont suivre puissent s’insérer dans
une vision globale qui se construit, un sens qui se révèle au fur et à mesure. Bien
sûr, il y a des relectures, ce qui précède, des ajouts, des aboutissements déjà
devinés, des enchaînements, des engrenages, tout une mécanique de plume Alors quinze
pages par semaine, c’est vraiment être dans la hâte que ce qui s’écrive soit
terminé, non pas pour se débarrasser d’une tâche fastidieuse mais au contraire
pouvoir se glisser dans une vraie réflexion, comment ça s’intègre aux autres
textes, à ce qui est déjà paru, bref, savoir un peu plus où j’en suis.
(21/09/2011)
"Je ne connais pour ma part d'autres sentiers de la
création que ceux ouverts pas à pas, c'est-à-dire mot après mot, par le cheminement
même de l'écriture.
Avant que je me mette à tracer des signes sur le papier il n'y a rien, sauf un magma
informe de sensations plus ou moins confuses, de souvenirs plus ou moins accumulés, et un
vague -très vague- projet.
C'est seulement en écrivant que quelque chose se produit, dans tous les sens du terme. Ce
qu'il y a pour moi de fascinant, c'est que ce quelque chose est toujours infiniment plus
riche que ce que je me proposais de faire.
Il semble donc que la feuille blanche et l'écriture jouent un rôle au moins aussi
important que mes intentions, comme si la lenteur de l'acte matériel d'écrire était
nécessaire pour que les images aient le temps de venir s'amasser (cependant, parfois,
celles-ci arrivent plus vite, et je suis obligé de m'interrompre pour les noter
rapidement en marge). Ou peut-être ai-je besoin de voir les mots, comme épinglés,
présents, et dans l'impossibilité de m'échapper ?…
Pourtant ce ne sont pas des matériaux existant en soi comme les pierres d'un mur, une
tache de couleur -qui ne renvoie qu'à elle-même-, ou du bronze -que l'on peut toucher.
Eux, d'une manière ou d'une autre, ils renvoient toujours à des choses. Mais peut-être
le rôle créateur qu'ils jouent tient-il justement à ce pluriel.
Si aucune goutte de sang n'est jamais tombée de la déchirure d'une page où est décrit
le corps d'un personnage, si celle où est raconté un incendie n'a jamais brûlé
personne, si le mot sang n'est pas du sang si le mot feu n'est pas le feu, si la
description est impuissante à reproduire les choses et dit toujours d'autres objets que
les objets que nous percevons autour de nous, les mots possèdent par contre ce prodigieux
pouvoir de rapprocher et de confronter ce qui, sans eux, resterait épars.
Parce que ce qui est souvent sans rapports immédiats dans le temps des horloges ou
l'espace mesurable peut se trouver rassemblé et ordonné au sein du langage dans une
étroite contiguïté. Une épingle, un cortège, une ligne de bus, un complot, un clown,
un État, un chapitre n'ont que (c'est à dire ont) ceci de commun : une tête. L'un
après l'autre les mots éclatent comme autant de chandelles romaines, déployant leurs
gerbes dans toutes les directions. Ils sont autant de carrefours où plusieurs routent
s'entrecroisent. Et si plutôt que de vouloir contenir, domestiquer chacune de ces
explosions, ou traverser rapidement ces carrefours en ayant déjà décidé du chemin à
suivre, on s'arrête et on examine ce qui apparaît à leur lueur dans les perspectives
ouvertes, des ensembles insoupçonnés de résonance d'échos révèlent.
Chaque mot en suscite (ou en commande) plusieurs autres, non seulement par la force des
images qu'il attire à lui comme un aimant, mais parfois aussi par sa seule morphologie,
de simples assonances qui, de même que les nécessités formelles de la syntaxe, du
rythme et de la composition, se révèlent souvent aussi fécondes que ses multiples
significations.
C'est ainsi qu'ont été écrits La route des Flandres, Le Palace, plus encore Histoire et
plus encore (il faut du temps pour se débarrasser peu à peu des mauvaises habitudes
inculquées) les pages que voici, nées du seul désir de « bricoler » quelque chose à
partir de certaines peintures que j'aime. Textes qui, tous, se sont faits d'une façon
absolument imprévue de moi au départ, les quelques images initiales s'étant en cours de
route, précisées et augmentés de toutes celles que l'écriture et les nécessités de
la construction leur ont adjointes.
Et voici que ce sentier ouvert par Orion aveugle me semble maintenant devoir se continuer
quelque part. Parce qu'il est bien différent du chemin que suit habituellement le
romancier et qui, partant d'un « commencement » aboutit à une « fin ». Le mien il
tourne et retourne sur lui-même, comme peut le faire un voyageur égaré dans une forêt,
revenant sur ses pas, repartant, trompé (ou guidé ?) Par la ressemblance de certains
lieux pourtant différent et qu'il croit reconnaître, ou, au contraire, les différents
aspects du même lieu, son trajet se recoupant fréquemment, repassant par des places
déjà traversées, comme ceci
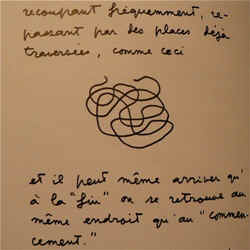
et il peut même arriver qu'à la « fin » on se retrouve au
même endroit qu'au « commencement. »
Aussi ne peut-il avoir d'autres termes que l'épuisement du voyageur explorant ce paysage
inépuisable. À ce moment se sera peut-être fait ce que j'appelle un roman (puisque,
comme tous les romans, c'est une fiction mettant en scène des personnages entraînés
dans une action), roman qui cependant ne racontera pas l'histoire exemplaire de quelque
héros ou héroïne, mais cette tout autre histoire qu'est l'aventure singulière du
narrateur qui ne cesse de chercher, découvrant à tâtons le monde dans et par
l'écriture. "
(Préface à « Orion aveugle » de Claude Simon (1970). Repris dans
l’édition Pléiade, pages 1181 à 1183)
(14/09/2011)
Quinze par semaine, ce n’est pas une performance culinaire ou
fantasmagorique, juste une résolution de rentrée : pour terminer le texte en cours,
au nom de code ID, il faudrait que je puisse
écrire l’équivalent-roman de quinze pages par semaine. L’équivalent-roman est
une mesure qui me permet d’imaginer ce que représentent les caractères numériques
et fuyants que j’aligne sur mon ordinateur en pages de vrai roman papier (compter en
moyenne à peu près 1000 caractères (espaces compris) pour 1 page
d’équivalent-roman). Donc, pour bien faire, c’est quinze mille signes que je
dois aligner par semaine, soit trois mille par jour d’écriture, ça semble faisable,
ça correspond généralement une séance d’écriture de une à deux heures.
Au-delà, on devient improductif et en-deçà, la page d’écriture s’apparente
à un simple paragraphe au goût de trop peu. Bref, au-delà, c’est être trop
gourmand et digérer lourdement, en-deçà, c’est rester sur sa faim au risque de
grignoter quelques phrases boulimiques et désordonnées. Ce programme de quinze pages par
semaine devrait me permettre de boucler le premier jet (comme on dit) vers la mi-novembre.
Allez ! Je me fixe la gageure de terminer pour le 11 novembre, on verra bien…
Quinze par semaine, c’est aussi la régularité que j’essaie d’avoir à la
course à pied, deux séances par semaines et quinze kilomètres, pour l’instant,
déjà presque six cents kilomètres depuis le début de l’année : ça tient.
Ces deux objectifs de quinze par semaine, pages ou kilomètres, ont bien des points commun
d’ailleurs. Le souffle bien-sûr et bien des auteurs ont déjà fait le
rapprochement, d’Haruki Murakami à Jean Echenoz (voir en Notes
de lecture, il y a juste un an), mais aussi cette imprévisibilité, ne jamais savoir
comment ça va se passer, est-ce qu’on va traîner les pieds, courir comme un elfe,
tapoter d’un doigt léger sur le clavier ou plus lourdement, façon rapport de police
sur une antique machine à écrire. Écrire, comme la course à pied, c’est ne jamais
savoir ce qu’il y a devant, ce que cache le virage, c’est y aller au jugé, un
peu au pif, mais en revanche, si on s’arrête pour marcher un peu, pour reprendre son
souffle, on refait rarement le chemin en arrière, c’est du passé déjà, du
définitif, tout comme les choix et les options de l’écriture. Ce qui ne veut pas
dire qu’on n’hésite pas, qu’on ne cherche pas à parfaire le chemin ou la
course. Le plus plaisant, c’est de trouver après coup des explications à ce que
l’on sentait confusément en soi, non pas une justification, non pas une glose, une
paraphrase de la pensée, s’enferrer dans le piège de l’intention (qui bien
souvent est un postulat a priori) mais trouver
un éclaircissement, quelque chose qui fait avancer – allez, osons le mot !
– l’œuvre. C’est un état presque physique, d’ailleurs carrément
corporel, organique et c’est sans doute cette sensation de réflexe qui m’attire
à la fois dans la course et l’écriture. Quinze par jour : tenir bon !
(07/09/2011)
Il y a un an tout juste, c’était la parution de Retour aux mots sauvages. J’ignorais en ce
tout début de rentrée les sélections à venir du Goncourt, toute cette agitation qui
remplirait mes week-ends, temps libres et autres rendez-vous, agitation qui, finalement,
perdure encore et combien cela me paraît un peu surfait aujourd’hui. Bref,
j’aimerais passer à autre chose. En même temps, j’accepte volontiers et avec
plaisir tout ce qui dépasse la simple histoire de Retour
aux mots sauvages, ce qui la relie au monde et l’agenda de rentrée 2011 se
remplit déjà.
Mais il y a un an tout juste et l’un des meilleurs souvenirs demeure cette première
intervention radiophonique, c’était le 27 août à France Inter, un vendredi, et
Bruno Durvic, me semble-t-il, terminait l’animation d’été de ces matinales, le
lundi serait la vraie rentrée parisienne pour beaucoup. Ce vendredi donc gardait un air
de vacances. Il faisait très beau, j’étais revenu de Sicile une semaine auparavant
(comme en ce moment), un taxi m’avait déposé vers la maison de la radio et, le peu
de circulation aidant, je m’étais retrouvé avec plus d’une heure
d’avance, de quoi tourner plusieurs fois autour du grand bâtiment circulaire, de
repérer dans une rue voisine celui de France Inter, d’aller à
Finalement, je ne sais pas pourquoi ce souvenir est l’un des plus beaux de cette
rentrée littéraire de RMS. Il y avait cette
fraîcheur de retour de vacances, cette nouveauté du livre, quelque chose à la fois
d’excitant et de revigorant. Et un an après ? Bien sûr, chaque année est
différente, il y a la vie qui se charge de proposer des imprévus et Dieu sait si cette
année 2011 aura été bousculée. Reste qu’en ce moment j’écris, ce n’est
jamais facile, toujours chancelant, et que seul cet objectif doit compter pour cet
automne. Histoire peut-être de recommencer bientôt une rentrée, sait-on jamais ?
(31/08/2011)
Il y a, dans la superbe édition Pléiade de Milan Kundera que
j’ai reçue pour mon anniversaire, une interview recensée sous le titre
« L’Art du roman », où Milan Kundera explique ce que pour lui est le
roman, de façon curieuse d’abord parce qu’il s’en explique par la
négation : « en tous cas, ce ne sont pas des romans psychologique »
dit-il en substance. Soit. En réalité, que l’on puisse se prévaloir d’une
théorie sur le roman m’a toujours paru suspect (peut-être cela participe de la
même suspicion qu’éprouvait Nathalie Sarraute dans L’Ère du soupçon). Le choix d’écrire
un roman est déjà une imposture en soi, faite à la réalité. Donc décider que ce
qu’est ou ce que n’est pas le roman se réduit à la propre perception de ce qui
est admissible pour soi dans le roman. Pour Milan Kundera, il n’est pas admissible
(pour sa propre perception s’entend) que le roman soit psychologique. Mais c’est
un détail qui varie selon la propre sensibilité d’écrivain. Si je recense ce qui
est ou non admissible pour moi dans le roman, je me heurte à une question presque sans
fond. Le choix du roman d’abord, car j’ai tendance à m’en méfier et il me
faut un maquillage subtil pour me permettre d’endosser le rôle du romancier. Par
exemple, si RMS est bien un roman, une
invention, je me sers toutefois d’une réalité que j’estime être un des rares
écrivains à bien connaître (le monde des téléopérateurs) pour légitimer un récit
et me sentir dans une posture de romancier « acceptable ». Pourtant, je sais
bien que le roman m’attire pour les raisons classiques (devenues inavouables depuis
le nouveau roman ?) : l’invention du monde, le pouvoir de choisir une
réalité, la création lâchée de toute bride. C’est un moteur extrêmement
puissant et jouissif, et je pense que tous ceux qui écrivent connaissent cette tentation.
Choisir, créer, inventer donc. On croirait presque un slogan politique, une trilogie
quasi-libérale et c’est peut-être pour rendre acceptable ce qui n’est jamais
qu’un vil esprit de pouvoir sur une réalité, donc sur les autres, que nous avons
besoin de nous défendre face aux élans encore si vivaces du roman colonisateur. Pour ma
part, cette résistance s’exprime à travers ma réticence à nommer les personnages
(en quelque sorte, j’ai toujours trouvé stupide pour le romancier le choix
d’appeler untel de ces personnages, Gérard ou Hélène). Or, quelle ne fut pas
ma surprise en relisant ID, manuscrit en cours,
d’y trouver un prénom qu’un personnage, certes secondaire, laisse échapper
lors d’une répartie, et ceci sans qu’il m’est semblé que ce prénom ait
fait l’objet de tractation dans mon inconscient, il est simplement apparu dans une
réplique, et ceci, d’une manière définitive. Et c’est peut-être cette
irrévocabilité qui me fascine dans le roman. Que j’ai ainsi choisi ce prénom, ou
choisi, également dans ID, de faire habiter un
des personnages principaux dans une ville de Bourgogne, me paraît un choix péremptoire,
définitif qu’on ne pourrait remettre en question et même pas moi. C’est
écrit, ça s’est fait, ça a été décidé ainsi par une force occulte, ça ne peut
être remis en question. Et savoir que celui qui l’a décidé est doué de ce pouvoir
– un dieu puissant qui me ressemblerait, logé dans ma tête mais qui ne serait pas
moi – me fascine au plus haut point. C’est sans doute à travers ces choix
définitifs que je ressens le plus le pouvoir d’invention, le pouvoir du romancier,
l’extrapolation de ses propres rêves au-delà du cerveau.
(24/08/2011)
« Étonnant
que je puisse oublier, que j'oublie si facilement et à chaque fois pour longtemps, le
principe à partir duquel seulement on peut écrire des œuvres intéressantes et les
écrire bien. Sans doute, c'est que je n'ai jamais su me le définir clairement, enfin
d'une manière représentative ou mémorable.
De temps à autre il se produit dans mon esprit, non pas il est vrai comme un axiome ou
une maxime : c'est comme un jour ensoleillé après mille jours sombres, ou plutôt (car
il tient moins de la nature que de l'artifice, et plus exactement encore d'un progrès de
l'artifice) comme la lumière d'une ampoule électrique tout à coup dans une maison
jusqu'alors éclairée au pétrole... Mais le lendemain on aurait oublié que
l'électricité vient d'être installée, et l'on recommencerait à grand-peine à garnir
des lampes, à changer des mèches, à se brûler les doigts aux verres, et à être mal
éclairé...
"Il faut d'abord se décider en faveur de son propre esprit et de son propre
goût. Il faut ensuite prendre le temps, et le courage, d'exprimer toute sa pensée à
propos du sujet choisi (et non pas seulement retenir les expressions qui vous
paraissent brillantes ou caractéristiques). Il faut enfin tout dire simplement, en
se fixant pour but non les charmes, mais la conviction." »
Francis Ponge, Mémorandum, Proêmes.
(27/07/2011)
Bon
qu’à ça, avait maugréé le génial Beckett lorsqu’on lui avait demandé
pourquoi il écrivait. Et c’est vrai que c’est un grand mystère que ces élans
de plume ou de clavier, les raccourcis d’une pensée vers les doigts, l’abrégé
d’un neurone dévolu à cette mécanique. Inspiration,
expiration. Expiation, pénitence et rédemption. Finalement c’est très
compliqué cet aboutissement d’écriture, on comprend qu’il n’y ait pas
d’explication rationnelle et quand bien même on la percevrait, ce serait comme un
mirage, un soudain éclaircissement vite obscurci, une exhibition honteuse vite cachée.
Dans la litanie des pourquoi et des comment, il y a le surgissement soudain, comme ce
vendredi faste par exemple qui m’étonnait la semaine dernière dans cette même
rubrique. Et comme ces textes lancés aux noms de code N et ID,
et comment tout ça tient. Pas grand-chose finalement : une vingtaine pages format
roman pour ID, moins de dix pour N, mais ce qui m’étonne bien plus, c’est
comment ils se bâtissent l’un l’autre en parallèle. Que je sois capable
d’aligner un paragraphe dans un des textes et l’instant d’après de
continuer avec le même enthousiasme l’autre. Étrange dédoublement, drôle de
schizophrénie (mais je n’en suis pas à une près…) et puis plus rien d’un
seul coup pendant quelques jours ni sur un texte, ni sur l’autre, juste la sensation
souterraine qu’ils continuent leur lent travail de stalactites à l’intérieur
du crâne et l’espoir que la lumière du jour puisse encore se faire de temps à
autre jusqu’à devenir plus régulière et pouvoir sentir le fourmillement du texte
qui avance, puis dépasse la moitié et s’achemine vers la fin.
(20/07/2011)
C’est
juste une journée, mais une vraie journée sans rien, qui commence un matin et qui se
termine le soir, avec, entre les deux, de longues heures d’écriture, comme une
libération, un apaisement, la délivrance de ce qui c’était accumulé dans les
espaces impossibles du travail, sur les trajets d’autoroutes, dans les occupations
familiales et domestiques (voir en étonnements), toute cette bousculade finalement
solitaire où l’esprit échafaude de vagues pensées, des intentions
d’écritures, des projets incertains remis à plus tard, tout un côté qui paraît
alors tellement inopportun, inconcevable dans cette vie faite de mille contraintes
professionnelles, personnelles à un tel point que m’apparaît parfois comme une
fable irréelle, une sorte de rêve que j’aurais eue, toute cette agitation de
l’automne dernier lorsque RMS s’était
retrouvé par hasard sur les listes du Goncourt. Bien sûr, il y a ces parenthèses,
rencontres, salons, librairies médiathèques, invitations diverses où cette autre
existence revient. Et même ces Feuilles de route, tenues le plus régulièrement possible
afin de ne jamais oublier ce qui constitue finalement cette vraie raison d’être et
qui disparaît parfois sous l’écume. Il y a eu aussi cette journée passée à Paris
en juin, tellement tendue, un jour de congé posé exprès pour, et comment j’avais
couru pour rencontrer tous ceux que je devais voir pour divers projets ou même sans
motif, comme faire un signe à mon éditrice, simplement pour marquer ce temps sans
écriture, discuter, discuter toujours, sentir le fourmillement, tout ce qui remue encore.
Et vient cette journée, un vendredi d’apaisement et ses longues heures à aligner
des mots. Reste à ce que tout cela prenne corps. Des idées oui, justement choisissons
des noms de codes : ID pour ce texte qui me taraude depuis quelques mois et
que j’ai démarré (est-ce que ça tiendra ?). Et N, apparu
soudainement dans ce jour faste, seul point vraiment réel et fini puisqu’il a donné
quelques jours plus tard une nouvelle que j’avais promis à une revue et dont je
voyais l’échéance se profiler sans rien. Et JDV qu’il faudra
peut-être finir aussi par la même occasion, ce serait le moment. Est-ce que tout cela
pourra résister au-delà de l’engloutissement ? Car déjà la vie à repris ses
vagues et ses marées, il faudra bien tenir la barre derrière le simple apaisement
d’un jour.
(13/07/2011)
« Cherchez en
vous-mêmes. Explorez la raison qui vous commande d'écrire; examinez si elle plonge ses
racines au plus profond de votre cœur; faites-vous cet aveu : devriez-vous mourir
s'il vous était interdit d'écrire. Ceci surtout : demandez-vous à l'heure la plus
silencieuse de votre nuit; me faut-il écrire ? Creusez en vous-mêmes à la recherche
d'une réponse profonde. Et si celle-ci devait être affirmative, s'il vous était donné
d'aller à la rencontre de cette grave question avec un fort et simple "il le
faut", alors bâtissez votre vie selon cette nécessité; votre vie, jusqu'en son
heure la plus indifférente et la plus infime, doit être le signe et le témoignage de
cette impulsion. Puis vous vous approcherez de la nature. Puis vous essayerez, comme un
premier homme, de dire ce que vous voyez et vivez, aimez et perdez. N'écrivez pas de
poèmes d'amour; évitez d'abord les formes qui sont trop courantes et trop habituelles :
ce sont les plus difficiles, car il faut la force de la maturité pour donner, là où de
bonnes et parfois brillantes traditions se présentent en foule, ce qui vous est propre.
Laissez-donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien; décrivez
vos tristesses et vos désirs, les pensées fugaces et la foi en quelque beauté.
Décrivez tout cela avec une sincérité profonde, paisible et humble, et utilisez, pour
vous exprimer, les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de
votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas; accusez-vous
vous-même, dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour appeler à vous ses
richesses; car pour celui qui crée il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et
indifférent. Et fussiez-vous même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir
à vos sens aucune des rumeurs du monde, n'auriez-vous pas alors toujours votre enfance,
cette délicieuse et royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez vers elle votre
attention. Cherchez à faire resurgir les sensations englouties de ce vaste passé; votre
personnalité s'affirmera, votre solitude s'étendra pour devenir une demeure de douce
lumière, loin de laquelle passera le bruit des autres. »
Rainer Maria RILKE Lettres à un jeune poète (traduction Marc de Launay)
(07/07/2011)
J’étais invité à la Médiathèque de Saint-Etienne la semaine
dernière, dans le cadre d’un cycle sur l’écriture et l’entreprise. A
Saint-Etienne, berceau de Manufrance, le thème est forcément important, tant cette ville
reste marquée par une culture ouvrière, de même que sa voisine de région, Clermont
Ferrand, l’est également avec Michelin. Or, Saint-Etienne, me semble-t-il souffre de
sa trop grande proximité avec Lyon. Autant, Lyon conserve sa suprématie bourgeoise en
héritage des soyeux, autant les stéphanois sont relégués au delà de la vallée du
Rhône dans une infériorité populaire. Sans doute doit-il rester de la part des lyonnais
envers les stéphanois l’idée d’une suprématie : c’est Lyon qui
décide et fournit le travail. Les habitants de Saint-Etienne prennent leur revanche
ailleurs, au foot par exemple comme dans bien des configurations de territoires (et pas
seulement françaises, Liverpool et Manchester participent du même mouvement). La ville
de Saint-Etienne semble ainsi marquée du sortilège du commun : de belles
réalisations architecturales voisinent avec des immeubles à l’abandon, les
quartiers populaires enserrent des hôtels particuliers, des rues étroites tissent un
réseau de promiscuité sans chichis. Ainsi la Médiathèque, dans laquelle je me rends,
vaste immeuble moderne au milieu d’un espace subitement ouvert alors que le trajet
pour y venir m’a fait passer dans un dédale de sens interdit et de feux tricolores
mal coordonnés. Merci à Daniela Diblasi pour son accueil chaleureux et à Yann Nicol
pour avoir animé cette rencontre avec un très grand professionalisme.
Bibliothèques toujours, mais cette fois-ci, ce sont celles de Seine-Saint-Denis et le but
est d’organiser la saison 2012 du festival Hors limite. J’interviens avec
Jean-Pierre Ostende qui partage avec moi le thème du roman et de l’entreprise (voir
en note de lecture Et voraces ils couraient dans la
nuit). La médiathèque de Noisy-le-Sec qui nous reçoit n’échappe pas au même
air de famille que celle de Saint-Etienne : ensemble moderne et spacieux, règne du
béton et toit tout en courbe pour celle de Noisy-le-Sec. Drôle d’imaginer comment
on pourrait se représenter autrement un esprit populaire qu’à travers ces
réalisations que n’aurait pas désavouées Oscar Niemeyer, créateur de Brasilia et
de l’immeuble du Parti Communiste à Paris, 103 printemps paraît-il cette année,
Oscar, pas le Parti.
Deux rencontres donc dans des médiathèques, aussi ressemblantes mais également aussi
différentes l’une de l’autre dans leurs fonctionnements. A Saint-Etienne, la
politique culturelle semble beaucoup plus évasive, plus au coup par coup qu’en
Seine-Saint-Denis, mais ce n’est pas du tout la même taille de bassin de population.
Le réseau des bibliothèques du 93 est ainsi autrement structuré. Ceci dit, je m’y
suis senti moins à l’aise, non pas par esprit de province, mais simplement décalé
parce que j’exerce un métier à côté et j’avais ainsi l’impression
d’entrer dans un lieu où beaucoup se connaissent à force d’activités
culturelles, tutoiements, évocations de projets communs, tout ce qui foisonne, animations
et autres rencontres et qui me semble être le gros du travail de qui choisit de se vouer
entièrement au métier d’écrivain, ce qui finalement est assez paradoxal avec le
retrait et la réflexion qu’impose l’écriture. Mais l'inspiration ne se
nourrit-elle pas de tels échanges ?
(24/06/2011)
Ce serait si
peu à faire : juste aboutir quelque chose, écrire une histoire. RMS,
c’était il y a seize mois et depuis pas grand chose, rien de fini, un nombre
incalculable de débuts, des bouts, des impasses, des chapitres vite écrits, vite
abandonnés, avec cette lassitude à ne rien considérer. Hier encore (lundi de Pentecôte
et le chiffre treize pour porter bonheur à l'écriture), cet élan qui dure plusieurs
heures et que la nuit remet en question. Et le matin, d’autres débuts,
commencements, départs, essors, sujets, idées, motifs qui reviennent, inapaisables, que
choisir ? J’écris cela (si peu) pour me souvenir de cette semaine où tout se
mélange, la vie, l’écriture, les sentiments et, au-dessus, cette inaltérable
impression d’exister.
(15/06/2011)
« Le
piano commença à jouer. La lumière s’éteignit. Suzanne se sentit désormais
invisible, invincible et se mit à pleurer de bonheur. C’était l’oasis, la
salle noire de l’après-midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et
démocratique, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus consolante que toutes les
vraies nuits, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, plus généreuse, plus
dispensatrice de bienfaits que toutes les institutions de charité et toutes les églises,
la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs, et
où se lave toute la jeunesse de l’affreuse crasse d’adolescence. » (Un barrage contre le pacifique, de Marguerite Duras - p. 162, éd France Loisirs)
C’est exactement cela, ces sensations de spectateur émerveillé, que
j’aimerais rechercher, éprouver en écrivant, en lisant : l’oasis, la salle
noire, la nuit des solitaires, artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire
du cinéma (ou des livres) plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit choisie,
offerte à tous plus généreuse : se le fixer en ligne de conduite, point
d’horizon, recherche de bonheur.
(08/06/2011)
J'ai eu
quelques jours de congés pour finir le mois. je pensais avec naïveté écrire tous les
jours, m'atteler à ma thèse, démarrer un nouveau roman, enfin, tout ce qu'on se dit
lorsqu'on dispose d'une plage de jours de la sorte. En réalité, je n'aurais pas fait
grand chose qui puisse me relier à l'écriture dans son geste. J'ai en ce moment peu de
courage et d'inspiration. J'exagère sans doute car la rencontre à Strasbourg à la
Librairie Quai des brumes relevait justement entre autres de cette thèse sur la
littérature du travail. En effet, Sébastien, le libraire est à l'origine de l'excellent
dossier des librairies Initiales sur Écrire
le travail et auquel j'ai participé avec un grand intérêt. J'ai écrit un
article sur RMS qui, à l'époque du bouclage de ce dossier, il y a presque un an,
n'était toujours pas sorti. J'ai aussi eu la joie de mener un entretien avec Élisabeth
Filhol, l'auteur de La Centrale (note
de lecture du 28/05/2010). Ce n'est pas rien. Des contacts se nouent et merci à
Corinne et Roselyne, universitaires passionnées, pour les échanges si sympathiques de
mercredi dernier. Mais en attendant, je n'écris pas ou si peu, ou de façon si
désordonnée, désorientée. J'ai repris le manuscrit de JdV (note d'écriture du 06/02/2009) : ça a duré deux jours. En
réalité, je ne sais pas sur quoi écrire et cela tétanise toutes mes velléités de
narration, hormis ces rubriques de Feuilles de route. Et c'est sans doute ces
écritures minimes qui me permettent de garder l'entraînement comme un sportif, de ne pas
perdre complètement le souffle. Ah si, j'oubliais une rédaction importante qui m'a tenu
toute une soirée : la déclaration d'impôts.
(01/06/2011)
Paris,
capitale des arts, des lettres, la ville qui bouge sans cesse : j’ai toujours en
moi cette image, cliché de provincial qu’on pourrait croire trop attiré par les
lumières, mais demeure intacte
l’impression d’aventure que j’ai eue adolescent en débarquant à la gare
de l’Est. Aussi le plaisir que j’ai à renouveler de temps en temps ces voyages
m’est très cher. S’y est ajouté depuis quelques temps la joie de partager ces
débarquements impromptus. Par exemple, je donne rendez-vous au Virgin de la gare, on
enchaîne vers une terrasse « mi-ombre
mi-soleil » comme dit Pierre
à Anne qui arrivera
en retard. Lieux mythiques, lieux de passage, Paris la ville où l’on court tout le
temps, et moi qui débarque, la tête encore dans la quiétude des villages Il faut cent
ans à la rue principale de Saint-Broingt-le-Bois (voir en étonnements) pour regarder
passer la foule d’une seule journée de la gare de l’Est. Horloge de clocher
contre l’horloge des pas-perdus, est-ce que le décor influence la vie ? Est-ce
le contraire ? Comment sommes-nous enchâssés dedans ? L’expression foncer
dans le décor est ici appropriée. Mais plus le temps de penser à ces questions qui nous
taraudent (et qui sont de véritables préoccupations d’écriture), je cours pour
attraper le train pour Chelles où je participe à un débat littéraire. J’ai vécu
un peu plus au Nord, il y a trente ans et je passais en voiture par Chelles pour rejoindre
cette banlieue Est. A peine débarqué de la gare, il me semble me souvenir d’une
sorte d’identité confuse. La manière de marcher sans regarder l’autre, la
manière d’être ici habitué, l’impression de passants qui savent toujours où
ils vont. La bibliothèque est au fond d’une grande avenue. Elle est au centre de
petits immeubles et j’aime cette proximité. Je retrouve Jean-Pierre Levaray, auteur
de livres aux tires décapants, Putain d’usine et Tue ton patron et
Sophie Stern, qui vient de publier un recueil de nouvelles intimistes concernant des
cadres d’entreprise Femmes tortues, hommes crocodiles (voir en Notes de
lecture). Le débat s’inscrit dans un cycle « autour du travail »
avec spectacle, rencontres philo…etc. Animée avec intelligence et passion par
Hélène Sagnet, les échanges croisés sont nombreux entre nous tous et sans aucun temps
mort pendant deux heures. Évidemment, j’en retire matière pour ma thèse en cours
sur la littérature du travail. Je suis par exemple conforté sur la différence de
perception qui existe entre l’auteur et le lecteur, ce dernier à l’impression
d’un univers beaucoup plus noir que la conscience qu’en possède l’auteur.
Ce qui montre bien que le travail apporte par définition, essence, habitude, un filtre
négatif au départ de toute représentation. Le statut des auteurs « issus de la
société civile » et non dévolus à un monde proche du livre est également une
constante dans le domaine de la littérature du travail.
Retour vers Paris, je suis reparti via la gare du Nord, autre lieu de passage, de souvenirs. Légère fatigue d’un soir d’été presque,
silencieux et heureux, pas pressé, ça me rappelait la fin d’une soirée remue.net, il y a
quelques années, c’était la fête de la musique, j’avais déambulé dans cet
incognito des villes et c’est peut-être juste cette liberté de capitale qui
s’inscrit dans nos lettres minuscules.
(25/05/2011)
J’ai
relu récemment Paysage et portrait en pied de poule, paru en 2004, à la faveur de
quelques exemplaires fournis dans un salon du livre. C’est étrange de relire son
propre livre. Plus drôle encore de le redécouvrir et finalement de le trouver pas si
mal. Ne voyez aucune fatuité dans ces propos. C’est l’un de ceux où je pense
avoir été le plus lyrique, le plus inventif quant au style. Paru deux ans après Composants,
on y retrouve sans doute encore l’influence de Claude Simon qui expliquait que «Le concret, c'est ce qui est intéressant, la
description d'objets, de paysages, de personnages ou d'actions ; en dehors, c'est du
n'importe quoi.». Pour Paysage et portrait en pied de poule, j’avais pris ces
recommandations au pied de la lettre mais allez décrire des champs dans la précision de
chacune des mottes de terre sans lasser le lecteur ! A bien y réfléchir, d'ailleurs, on
pourrait croire que cette obsession scripturale est à l'origine de l’insuccès de ce
livre. L'accélération du monde moderne permet des visions fugaces et précises, qu'une
lecture rapide doit retracer avec vivacité. Décrire, c'est alors marcher à contre
courant, s'enfoncer dans du mou. Pourtant, je suis persuadé que la description est
inévitable et doit être saisie dans toute sa complexité parce que justement c'est elle
qui explique le monde. En latin, le verbe describere possède quatre
sens : celui de transcrire (par exemple copier un livre), celui de tracer, de
dessiner, celui de raconter, d’exposer (de poser en dehors) et celui de délimiter ou
de déterminer. L’idée que je me fais de la description est également exhaustive,
elle inclut tous les angles de vue, le décor mais aussi les attitudes les dialogues. J'ai
toujours eu une réticence à séparer les dialogues du texte comme les conventions le
prévoient. Le retour à la ligne, le tiret me semble placer le dialogue en dehors du
contexte, alors qu'il y est étroitement relié. « Décrire » pourrait ainsi
avoir le sens de son anagramme « décrier » dans un sens trivial, celui de
« rabaisser dans sa réputation », c'est-à-dire de coller personnages et
décor sur un même plan.
(18/05/2011)
Le hasard du
calendrier (ou le printemps qui exacerbe les manifestations culturelles) a rempli mes
week-ends comme une baudruche. A peine le temps de revenir du Cap Vert et c’est Arras
le premier mai, son dixième salon du livre, brocante associée, très belle exposition
sur Frédéric H. Fajardie, temps magnifique dehors et nous, pauvres auteurs enfermés
dans l’ombre. Nous, c’est aussi Philippe Annocque, compagnon de résidence sur
Melico, grand plaisir de le rencontrer, on se donne rendez-vous à la fête des humains à
l’huma en septembre prochain. Après Arras, il faut repartir pour une semaine de
labeur : Châlons, Reims, Lille ou Amiens (voir en étonnements) avant
d’embrayer sur le week-end suivant qui commence dés vendredi 6 mai, 19h, pour une
lecture croisée avec Nathalie Kuperman. Nous nous croisons régulièrement avec Nathalie
depuis septembre dernier, parce que nos deux livres évoquent les difficultés du travail
(le sien : Nous étions des êtres vivants – note de lecture du 19/11/2010). Pour cette
lecture dans le cadre de Paris en toutes lettres, nous avions poussé
l’échange jusqu’à choisir et lire des extraits de nos livres, mais moi le sien
et elle le mien. Nous attendions ce moment avec impatience mais Nathalie a déclaré
forfait pour la bonne cause : lauréate du prix du printemps du roman, elle devait
recevoir cette récompense le même jour. C’est donc avec la comédienne Noémie
Landreau que j’ai effectué cette lecture sous une forme plus classique, j’ai lu
des extraits de RMS et Noémie a réalisé l’exploit de choisir et de lire avec
talent cinq extraits de Nous étions des êtres vivants. Cette première lecture au
104 m’a conforté dans cette direction que j’aimerais approfondir et
d’autres projets sont en cours. Le lendemain, départ matinal pour Arcachon et La
plage aux écrivains où j’étais impatient de retrouver Victor Cohen Hadria (Les
trois saisons de la rage, note de lecture de la semaine précédente). La plage aux
écrivains n’a d’intérêt que s’il fait beau et si la pluie nous a
accueilli le samedi, le dimanche en revanche n’avait pas caché le soleil dans sa
manche (c’est pour la rime). Je m’étais habillé comme un plagiste pour saluer
les parasols, les chaises longues et le beau temps avec bermuda et sandalettes, chemise
orange à motifs de zazou, vague ressemblance avec Magnum (sans la moustache et
(11/05/2011)
Aventures au Cap-Vert : c’était en 1996.
Cinq ans auparavant j’avais terminé ce premier manuscrit, Martin Martin, entamé à Toulouse à tout juste
vingt ans en 1978 sans trop savoir pourquoi. Je me souviens en revanche très bien de
l’état d’esprit qui avait présidé à l’achat d’un cahier pour
écrire : je venais d’entrer dans la vie active, j’avais raclé mes
économies de la Caisse d’épargne pour tenir le premier mois et, en attendant ma
première paie, l’idée de devenir écrivain m’avait semblé un débouché
naturel, un plus à l’indépendance
financière qui venait de s’installer. Aucune logique, aucun calcul, j’avais
écrit sans plan, juste lancé mes phrases, soixante-dix pages tout de même qui
s’étaient refermées très vite après ces quelques mois à Toulouse, on a beaucoup
de choses à construire à vingt ans à commencer par son propre roman de vie. Dix ans
plus tard, à la faveur d’un ordinateur tout neuf, l’idée saugrenue de recopier
le contenu de ce carnet au traitement de texte m’avait donné envie de continuer
l’histoire. Ça m’avait pris plus de deux ans et au total, treize ans pour un
premier bouquin, ma carrière d’écrivain s’annonçait difficile. Et c’est
dans l’idée de savoir si j’étais capable d’écrire vite que j’avais
commencé Aventures au Cap-Vert quelques années
plus tard, peut-être obsédé par ma lenteur et par le temps qui filait si vite. Pari
tenu, le livre s’est écrit en deux mois. Aventures
au Cap-Vert est une sorte de roman policier mais le héros n’est pas un flic à
gros muscles et regard d’acier, juste un informaticien dont la spécialité était de
recouper des données internationales sur différents trafics douteux. Le hasard avait
propulsé en voyage cet employé banal afin qu’il obtienne des renseignements sur un
voilier bourré de drogue qui devait faire escale dans une île du Cap-Vert. Aventures
donc ! J’ai relu cette histoire juste avant de partir (enfin) pour le Cap Vert.
Si certaines situations sont peu crédibles, cela fait partie du genre. En revanche, les
éléments géographiques que j’avais imaginés avec l’aide d’un guide
touristique sont assez cohérents. La ville de Praia et le port qui accueille une partie
de l’intrigue sont réalistes. Relire cette histoire est étrange, d’autant plus
que j’avais relégué ce manuscrit depuis des années. J’avais l’impression
d’avoir écrit un machin bancal, mais ça se tient plutôt bien, le rythme est
dynamique et mon informaticien en goguette est éminemment sympathique. J’avais
oublié combien j’avais réussi à créer un personnage heureux et, comme chacun sait
que depuis Flaubert « Madame Bovary, c’est moi », on comprendra que cette
relecture bien en accord avec ma vie de bonheur m’ait fait plaisir. Pour autant, Aventures au Cap-Vert a rejoint l’ombre
d’un tiroir qu’il occupe depuis quinze ans, époque située maintenant presque
à égale distance entre aujourd’hui et les premières pages de Martin Martin que je commençais à rédiger sur un
cahier en 1978. Qu’ils restent dans les tiroirs, c’est leur vocation.
(04/05/2011)
Retour tardif
sur le Goncourt des lycéens : j’ai été invité dernièrement à Chamalières
par un lycée qui avait participé à cette belle aventure. J’y ai rencontré deux
classes de seconde et retrouvé avec plaisir Cécile Beauvoir qui anime des ateliers
d’écriture dans cet établissement et qui vient de publier un de ses petits livres
de textes courts et émouvants dont elle a le secret (Ce vieil air de blues, voir en Note de lecture). Aller à la rencontre des
élèves est donc un exercice que j’aime beaucoup mais qui n’est pas toujours
facile à expliquer aux lycéens : dire qu’on vient les voir parce qu’on
aime leur vision franche et directe et leur appétit de jeunesse, c’est au pire
passer pour démagogue, au mieux se heurter à cette incompréhension naturelle que
l’on a à quinze ans pour quelque adulte qui manifeste un intérêt à vous
considérer en dehors du cercle familial ou institutionnel. L’institution, car tout
part quand même de là, joue un rôle ambigu : elle est à l’origine de telles
interventions extérieures destinées sortir du cadre habituel et à la faire oublier par
un point de vue différent. Et dans ce lycée de Chamalières, toute une équipe dynamique
joue le jeu : formidables les professeurs de français et de CDI, il eût été
tellement plus facile de profiter de la réforme du temps scolaire pour continuer à
bachoter en interne avec des heures de soutien Au lieu de cela, inviter un écrivain ou
organiser des ateliers d’écriture, en dehors de toute évaluation, permettent
souvent de révéler les personnalités des élèves à travers l’écriture
d’invention, d’induire une affirmation de soi, de sortir d’une méthode
parfois trop sclérosante. Et combien j’ai trouvé épanouis ceux qui y
participaient. D’une façon générale la venue d’un auteur en chair et en os
permet aux collégiens ou aux lycéens de s’apercevoir qu’ils ne sont pas tous
morts dans les manuels scolaires, qu’ils n’existent pas tous qu’à travers
la double fiction du roman et de la représentation médiatique qu’on s’en fait
à travers la télé. Après les questions viennent naturellement par la simple présence
du type qui se dandine devant en bafouillant. Pour lui, la partie est gagnée si quelques
uns, au-delà de la stupeur adolescente, des ricanements de circonstance ou des sourires
lumineux des appareils dentaires, pensent ainsi qu’un écrivain, ce pourrait être le
vague prolongement d’une image qui a dû leur ressembler à leur époque, le devenir
d’un adulte malaisé, semblable à un parent, en tous points identiques à un tonton
ou une tata excentrique, et que l’écriture a fini par rentrer dans ce tas de chairs
alors pourquoi je ne deviendrais pas moi aussi plus tard écrivain ? L’écrivain
lui, n’a pas cet avantage, il ne peut pas revenir en arrière et reprendre le cours
d’une jeunesse définitivement perdue : "en ce temps-là j’étais en
mon adolescence", écrivait Blaise Cendrars dans
(13/04/2011)
« Par la suite, j’ai commencé un roman dont il
était le personnage principal. Sensation de dégoût au milieu du récit. Depuis peu, je
sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d’une vie soumise à la
nécessité, je n’ai pas le droit de prendre d’abord le parti de l’art, ni
de chercher à faire quelque chose de « passionnant » ou
d’« émouvant ». Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de
mon pères, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d’une existence
que j’ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante.
L’écriture plate me vient naturellement, celle là même que j’utilisais en
écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. ».
Cet extrait (une note d’intention presque) placé dans les premières pages de
En revanche, plus intéressant, et à creuser peut-être, il y a dans la longue
explication d’Annie Ernaux, une volonté essentielle, celle de rassembler « les
signes objectifs ». Je ne peux m’empêcher de penser au dialogue que j’ai
eu avec Élisabeth Filhol (
(30/03/2011)
Recette pour un atelier d'écriture :
Ingrédients :
- une demi douzaine de jeunes filles
- une demi douzaine de bonhommes
- une centaine de feuilles
- une poignée de stylos
- de la matière bien grise
Dans un grand grenier, Placer la demi douzaine de jeunes filles, ajoutez-y les
bonhommes, mélangez le tout. Réclamez le silence. Dans le petit tas de gens, prenez
l'écrivain (vous le reconnaîtrez : il a des lunettes). Retirez-lui ses lunettes. A sa
place, distribuez les feuilles et jetez la poignée de stylos au milieu. Réclamez une
deuxième fois le silence ! Laissez l'écrivain tourner le nez en l'air à chercher
ses lunettes. Pendant ce temps-là, donnez une consigne pour écrire, n'importe quoi :
racontez vos vacances, la dernière fois que vous êtes allé au bal, ce que vous feriez
si vous gagniez au Loto... Laisser mariner. Laisser bouillir les cerveaux. A l'aide d'une
écumoire, filtrer la matière grise. Aie ! Ne faites pas attention, ce n'est rien,
c'est encore l'écrivain qui s'est cogné dans le mur. Ah, lui, sans ses lunettes !
Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour faire l'intéressant. Bon, où en étions-nous ? Ah,
oui, la matière grise ! Versez-là dans une petite éprouvette. Répartissez-là sur
les feuilles. Remuez le tout avec la poignée de stylos. Faites chauffer. Et que
constatez-vous, hein ? ça fait des lettres ! ça construit des mots ! ça fait
des phrases, des paragraphes ! ça fait des chapitres, des textes, un livre !
Faites lire le tout par la demi douzaine de jeunes filles et la demi douzaine de
bonhommes. Et que chacun s'amuse !
A la fin, rendez les lunettes à l'écrivain.
(écrit le 16 novembre 2006, dernière séance de l’atelier d’écriture de
Dole)
(23/03/2011)
Sur les
photographies, on dirait deux frères tant leur ressemblance est étonnante, même regard,
mêmes attitudes. Deux frères, vraiment, et qui auraient connu un destin semblable. Le
plus jeune, Salvatore Quasimodo a obtenu le prix Nobel de littérature en 1959. L'aîné,
Saint John Perse, presque quatorze ans d'écart tout de même, un peu fâché de s'être
fait passé devant, aurait obtenu réparation l'année suivante devant l'académie
suédoise. Belle revanche toutefois pour le droit d'aînesse : en France nous n'avons
retenu que Saint John Perse, son petit frère italien est vite passé aux oubliettes dans
nos manières si peu délicates à considérer l'étranger, fût-il un proche voisin. Et
c'est d'ailleurs pour combattre cet esprit de clocher que je passe la quasi-totalité de
mes vacances dans d'autres pays. Et si je n'avais pas traîné mes guêtres en Sicile au
mois d'août dernier, je n'aurais jamais entendu parler de Salvatore Quasimodo, le navrant
chauvinisme que nous subissons malgré nous m'en avait caché l'existence jusqu'alors.
C'est en visitant par hasard Modica, en me promenant en pleine torpeur de midi dans les
ruelles de la ville haute, comme seuls les français savent le faire, que je suis tombé
par chance sur la plaque qui orne sa maison natale. Evidemment, un tel nom, tout droit
sorti de Notre Dame de Paris et de l'imagination de Victor Hugo, ça ne s'oublie pas et
quand la plaque, même rédigée en italien apprend qu'il a obtenu le " premio Nobel
per la letteratura ", ça intrigue également. De retour, j'ai cherché des
informations bien-sûr. Enfin, quand j'ai eu fini de régler le problème de l'inondation
de mon bureau. Parce que c'est un peu compliqué mais c'est lié : c'est aussi à Modica,
ce même jour que j'ai appris cette inondation. Est-ce confus ? Dans ce cas, lisez le
premier épisode de Romans de bureau sur Melico, vous y verrez plus clair. Toujours est-il
que la similitude de parcours entre les prix Nobel des années 1959 et 1960 est étonnante
et ne s'arrête pas seulement qu'à des ressemblances photographiques. Les deux écrivains
ont déjà choisi comme mode d'expression commun la poésie. Et ils sont nés tous deux
dans une île. La Guadeloupe d'Alexis léger, alias Saint John Perse, répond à la Sicile
de Quasimodo. En regardant de plus près leurs poèmes, on est sidéré par la proximité
de leurs manières.
Dans Chevaux de la lune et des volcans, Salvatore Quasimodo écrit :
" Îles que j'ai habitées / vertes sur des mers immobiles. / D'algues sèches et
de fossiles marins / les plages où galopent fous d'amour / les chevaux de la lune et des
volcans. / Au moment des secousses, / les feuilles, les grues assaillent l'air : / dans la
lumière des alluvions / brillent des ciels chargés ouverts aux astres ; / les colombes
s'envolent / des épaules nues des enfants. / Ici finit la terre : /avec de la sueur et du
sang / je me construis une prison. / Pour toi je devrais me jeter / aux pieds des
puissants, / adoucir mon cœur de brigand. / Mais traqué par les hommes / je suis
encore en plein dans l'éclair, / enfant aux mains ouvertes, / aux rives des arbres et des
fleuves : / ici la latomie féconde / l'oranger grec pour les noces des dieux. "
Et Saint John Perse répond dans Eloges :
" La mer, entre les îles, est rose de luxure ; son plaisir est matière à
débattre, on l'a eu pour un lot de bracelets de cuivre !
Des enfants courent aux rivages ! des chevaux courent aux rivages ! … un million
d'enfants portant leurs cils comme des ombelles… et le nageur a une jambe en eau
tiède lais l'autre pèse dans un courant frais ; et les gomphrènes, les ramies,
l'acalyphe à fleurs vertes et ces piléas cespiteuses qui sont la barbe des vieux murs
s'affolent sur les toits, au rebord des gouttières,
car un vent, le plus frais de l'année, se lève, aux bassins d'îles qui bleuissent,
et déferlant jusqu'à ces cayes plates, nos maisons, coule au sein du vieillard
par le havre de toile jusqu'au lieu plein de crin entre les deux mamelles.
Et la journée est entamée, le mode
n'est si vieux que soudain il n'ait ri… "
Deux mêmes célébrations des îles et de l'enfance et un lyrisme identique comme
héritage de l'antiquité. Que dire également de la tristesse évoquée par Quasimodo
dans Aux branches des saules…
" Et comment pouvions-nous chanter
Le pied de l'étranger sur le cœur,
Parmi les morts abandonnés sur les places,
Sur l'herbe durcie par le gel, aux plaintes
D'agneau des enfants, au hurlement noir
De la mère avançant vers son fils
Crucifié sur un poteau télégraphique ?
Aux branches des saules, par vœu,
Nos cithares aussi étaient pendues,
Légères oscillaient au triste vent. "
… lorsqu'elle répond à la mélancolie de Saint-John Perse dans Amers :
" Et comme nous courions à la promesse de nos songes, sur un très haut versant
de terre rouge chargée d'offrandes et d'aumaille, et comme nous foulions la terre rouge
du sacrifice, parée de pampres et d'épices, tel un front de bélier sous les crépines
d'or et sous les ganses, nous avons vu monter au loin cette autre face de nos songes : la
chose sainte à son étiage, la Mer, étrange, là, et qui veillait sa veille d'Etrangère
- inconciliable, et singulière, et à jamais inappariée - la Mer errante prise au piège
de son aberration. "
Place aux poètes donc : 1959 et 1960 furent deux belles années de reconnaissance pour
eux. Je ne résiste pas au plaisir d'un petit dernier pour La route d'Agrigente
de Salvatore Quasimodo…
" Là dure un vent, je m'en souviens, allumé
dans les crinières des chevaux obliques
allant au galop le long des plaines,
un vent qui tache et ronge le grès
et le coeur des télamons lugubres
renversés sur les herbes.
Âme antique, grise de rancoeurs,
tu reviens à ce vent, tu flaires
la mousse délicate qui recouvre
les géants poussés bas par le ciel.
Quelle solitude que la tienne
devant l'espace qui te reste !
Et tu souffres davantage si tu entends
encore l'ample son s'éloigner vers la mer
où l'étoile du matin commence à se glisser :
la guimbarde vibre triste
dans la gorge du charretier qui remonte
lentement le coteau que découpe la lune,
au milieu d'un bruissement d'oliviers sarrasins. "
… et d'une dernière Chanson de Saint John Perse :
" Mon cheval arrêté sous l'arbre plein de tourterelles, je siffle un sifflement
si pur, qu'il n'est promesses à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. Feuilles
vivantes au matin sont à l'image de la gloire)...
Et ce n'est point qu'un homme ne soit triste, mais se levant avant le jour et se tenant
avec prudence dans le commerce d'un vieil arbre,
appuyé du menton à la dernière étoile,
il voit au fond du ciel de grandes choses pures qui tournent au plaisir.
Mon cheval arrêté sous l'arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur...
Et paix à ceux qui vont mourir, qui n'ont point vu ce jour.
Mais de mon frère le poète, on a eu des nouvelles. Il a écrit encore une chose très
douce. Et quelques-uns en eurent connaissance. "
(16/03/2011)
J’ai
rencontré Charles Juliet deux fois ces derniers mois. La première fois, c’était à
Manosque, en septembre dernier. Je suis venu lui parler à la fin de son intervention où
il était venu présenter le sixième opus de son journal, Lumières d’automne. Je l’ai revu le
lendemain en compagnie de son épouse dans le hall de l’hôtel que nous partagions
pour quelques banalités en attendant les navettes qui allaient nous ramener à la gare.
La deuxième fois, je me suis contenté de l’écouter ainsi que Pierre Bergounioux
pour une rencontre organisé par la MEL au
Petit Palais en janvier dernier. Autant dire qu’il ne souvient pas de moi. Surtout
que lorsque je lui ai parlé à Manosque, je me souviens avoir marmonné des choses sans
intérêt, par timidité. J’aurais pourtant aimé lui dire ce que représente pour
moi Lambeaux, par exemple, et combien je l’ai évoqué avec passion à
mon fils qui avait ce livre au programme de son bac de français. Il y a L’Année de l’éveil, bien sûr, et le
livre d’entretiens menés par Rodolphe Barry et édité par Catherine Flohic, Charles Juliet en son parcours, et celui qui se trouve derrière-moi dans la
bibliothèque à l’instant où j’écris, Charles
Juliet, trouver la source, aux éditions Paroles d’Aube, avec cette étonnante
photographie où il a un sourire lumineux. Je l’ai placé juste à côté d’un
livre sur Samuel Beckett, publié chez Anatolia où le grand Sam, photographié par John
Minihan, aborde un visage des plus austères. J’aime ce contraste et, bien entendu,
juste à côté, pour relier les deux écrivains, il y a le livre de Charles Juliet, Rencontres avec Samuel Beckett, publié chez POL,
et qui raconte les quatre visites qu’il a eues avec le prix Nobel entre 1968 et 1977.
On peut mesurer combien il a fallu d’obstination, de sureté, de courage aussi pour
oser aborder Samuel Beckett alors que l’écriture de Charles Juliet étaient encore
dans les limbes. D’ailleurs il le reconnaît à sa première visite :
« curieuse idée d’interroger celui qui n’est
qu’interrogation ». Pourtant, les deux hommes se reconnaissent dans cette même
quête d’absolu, ponctuée d’interminables silences où chacun va chercher aux
tréfonds de son âme. Ce qui les réunit, c’est « cette flamme qui consume
cette saloperie de logique » comme le dit Samuel Beckett et c’est la dernière
phrase que rapporte Charles Juliet. Et c’est ainsi, qu’à mon tour, je me suis
trouvé aussi démuni en face de Charles Juliet que lui l’était en face du grand
Sam. Que dire alors que des paroles aussi définitives ont été déjà prononcées ?
Nous basons toute notre conversation dans les apparats, mais ici, rien de tout cela, je me
sens nu comme un ver, exsangue, ma propre écriture me revient en pleine poire. Une
photographie atteste de ce moment, elle a été prise par Patrick Box. On me voit en
premier plan, courbant l’échine, mâchoire tombante, le regard cherchant un vague
point au-delà des lunettes. Charles Juliet me fixe. Il a le même visage en forme
d’aigle que celui de Beckett. Il tient ses lunettes dans une main, un stylo dans
l’autre, comme abandonnés car toute son attention est tournée vers moi, les
sourcils, les yeux sombres. Il attend. Je devrais parler, et sans doute que je parle, mais
pour quoi dire. Il y a une chaise orange derrière nous, comme un siège d’enfant.
C’est sans doute la photographie qui illustre le mieux ce que représente pour moi
l’écriture, ou ce que j’essaie de retracer à travers ce site Feuilles de route
et les trois rubriques principales, étonnements, notes d’écriture et de lecture.
Notes d’écriture pour l’ahuri du premier plan, lectures et figures tutélaires
comme Charles Juliet et le décor étonnant qui pénètre à chaque instant dans nos vies
comme ce fauteuil incongru couleur de mandarine.
(09/03/2011)
Après
Bordeaux, voici Bruxelles, visite ô combien différente et pourtant toutes deux liées à
des activités littéraires. Si j’étais l’invité du lycée Montaigne de
Bordeaux, me voici maintenant à la foire aux livres de Bruxelles. J’y retrouve avec
plaisir Nathalie Kuperman (notes de lecture des 19/11 et
29/12/2010) pour un débat animé par Hubert Artus. Cette fois-ci, j’ai du temps pour
visiter la capitale de la Belgique que je ne connais pas. Elle m’apparaît
cosmopolite, mélange de décontraction et de rigueur flamande, en réalité, assez proche
de Lille et moins bourgeoise qu’Amiens qui constitue pour moi les avant-postes
d’une culture picarde ou nordiste. Finalement, nous bougeons très peu et beaucoup de
mes collègues de ces régions possèdent des patronymes typiques, de même que ceux de
Lorraine et d’Alsace ont des noms à consonance germanique. Bruxelles, donc,
j’en retiens un crachin persistant pendant deux jours, des pavés mouillés de pluie
mais cela n’entache nullement la visite, au contraire. Il y a des villes que
l’on prend plaisir à visiter sous quelques bruines, comme une poésie
supplémentaire qui s’attache aux paysages. La grand place bien sûr, ses ors, les
façades orgueilleuses, mais la ville se laisse découvrir de part et d’autre de ce
centre historique, inévitable Manneken Pis mais aussi petites places, cafés, magasins
modestes, quartiers du port fluvial, tout est accessible et populaire, nullement empesé
et pas encore détruit par la vogue des grandes marques de fringues ou autres déserts
stériles du marketing. « Calmes maisons, anciennes passions », disait Rimbaud
à propos de Bruxelles. Ici, l’architecture la plus moderne croise de vieux
bâtiments, parfois avec quelques contrastes hardis, quelques fouillis et quelques erreurs
comme ces bennes à verre posées sur le parvis de l’église Saint Jean Baptiste du
Béguinage dont Baudelaire trouvait qu’elle avait « la beauté neigeuse
d’une jeune communiante ». Pas loin, dans un quartier considéré comme
fondateur de la capitale, l’ancienne halle de la place Saint-Gery, transformée en
café et en hall d’exposition, est un lieu très agréable pour flâner le dimanche
matin. Mais au final, je n’aurais pas vu grand-chose, même pas l’Atomium, ni
les grands symboles de l’Europe. En revanche, j’aurais eu le plaisir d’y
venir en voiture par les petites routes qu’a employées Rimbaud en venant des
Ardennes. Rimbaud d’ailleurs a laissé de nombreuses traces à Bruxelles. D’abord en juillet 1873 où il
rejoint Verlaine qui était descendu au Grand Hôtel Liégeois, rue du progrès, et
c’est le fameux épisode où Verlaine tire sur Rimbaud, dans l’hôtel A la ville de Courtrai au 1 rue des Brasseurs
(aujourd’hui un magasin de dentelles), avec un révolver acheté chez l’armurier
Christophe dans les passages couverts que constituent les galeries royales. Rimbaud,
blessé, une fois sorti de l'hôpital, restera quelques jours chez Mme Pincemaille,
marchande de tabac, rue des Bouchers, où le peintre Jeff Rosman fait le célèbre
portrait où on le voit alité. Écroué d’abord à Bruxelles, c’est sans doute
avant son transfert à Mons que Verlaine écrira le fameux poème Le ciel est
par-dessus le toit (si bleu si calme). Rimbaud, quant à lui, retrouvera Bruxelles en
octobre de la même année pour prendre livraison d’Une Saison en enfer,
édité à l’Alliance typographique de Poot et compagnie, au 37 rue aux choux. Il
corrigera quelques épreuves au-dessus d’un magasin de tabac de la petite rue des
bouchers. Il ne récupérera que quelques
plaquettes, faute d’argent sans doute pour payer l’imprimeur. Quelques centaines
d’exemplaires seront retrouvés en 1901 par un bibliophile belge Léon Losseau que
l’on voit parfois resurgir dans des ventes prestigieuses à plusieurs dizaines de
milliers d’euros, loin du prix initial imprimé sur la couverture et fixé à un
franc. Mais ceci est une autre histoire, bien loin des pavés bruxellois. Et tous ces
lieux, ces anecdotes, je ne me les suis remémoré qu’après, ignorant que les
parages de la grand place que j’avais parcourus étaient les lieux mêmes du culte
rimbaldien. Au retour, en ayant toujours traversé les Ardennes, je suis passé par
Attigny, pays d’où on arrive jamais, cher à André Dhôtel, j’ai frôlé Roche
comme il se doit, pour respirer l’air où fût écrit Une Saison en enfer et
j’ai négocié le virage un peu raide qui borde le monument dédié à l’attaque
de la Ferme Navarrin où Blaise Cendrars perdit un bras en 1915. La littérature est
partout présente.
(28/02/2011)
Je
n’aurai rien vu de Bordeaux, ou à peine. L’aller et le retour en train, les
grues du port et la zone industrielle (au moment où je commençais Terminal Frigo
de Jean Rolin, voir en Notes de lecture), des trajets aperçus par la vitre d’un
taxi, des rives belles et rénovées au centre-ville, de grandes places bordées
d’immeubles cossus, la rue Saint Catherine, toujours animée, le lycée Montaigne et
le vaste parking à étage juste en face d’où dépasse cette Jaguar comme si elle
avait crevé la façade. Je me serai à peine promené :des trottoirs, une place dans
la douceur d’un matin. Je n’ai pas cherché à en savoir plus. Ma chambre –
belle et confortable – donnait sur les toits, je voyais des cheminées de toutes
formes, des pentes de tuiles roses, des fenêtres comme celles de Dita Kepler. Des
voitures passaient quelques étages plus bas, j’entendais les premiers oiseaux du
printemps et la respiration de la ville. J’aurais voulu rester ici indéfiniment, à
côté de cette fenêtre bleue donnant sur une cour tranquille, à regarder cette
échappée de toits entre deux phrases écrites. Car j’ai écrit et c’est pour
cela que je n’ai guère eu le temps de me promener dans la ville. Pas une écriture
d’invention, pas encore de nouveau projet à long terme mais juste cette fameuse et
fichue thèse qu’il faudra bien que j’arrive à terminer tant elle
m’obsède, d’abord parce qu’après le doctorat il n’y a plus rien,
plus d’échelon à gravir, bac + 8 pour rien, je n’en ai pas besoin, à part
sans doute la vague idée d’une revanche sur laquelle je m’arqueboute, tendu et
inquiet, vague sensation de rattraper des études que je n’ai pas eu le loisir de
faire avant, d’effacer cette lourdeur de lycée à laquelle je ne comprenais pas
grand-chose, goût amer de l’ennui, quolibets de profs et vexation d’un monde
qui balaie d’un revers de torchon de tableau l’adolescence et les rêves.
Mettons donc que je sois revanchard, c’est une motivation comme une autre
(heureusement, ce n’est pas la seule !), ceux qui ont toujours été premiers de
classe ne peuvent pas comprendre cet entêtement. Donc, j’ai enfin commencé à
rédiger cette thèse, à extirper ce qui est coincé dans ma tête, à trouver un vague
plan et à m’atteler à écrire mot après mot cette faconde universitaire qui ne
m’est pas naturelle. Combien écrire un roman est plus facile ! Mais ça à
l’air d’être bien parti. Peut-être que je me souviendrai de Bordeaux pour
cela, pas de la ville mais de cette ambiance studieuse qui a présidé à l’écriture
dans la petite chambre sous les toits, à me trimbaler en peignoir sur la terrasse,
laisser mon regard errer sur les cheminées, invisible du monde, reclus. Peut-être, sans
doute même, que le lycée Montaigne qui m’avait invité avec trois autres auteurs
aura opéré une alchimie subtile, laissé pénétrer en moi quelques grammes d’une
poussière d’études, quelques résidus d’humanités comme on disait avant cette
appellation prétentieuse de sciences humaines. L’endroit pourtant est austère,
vieux bâtiments, style Napoléon III, tout ce qu’on avait voulu enfermer entre ces
pierres solides, l’idée de la continuité d’un monde ancien, église, armée,
devoir. Il en reste des vestiges coincés entre les murs et les lambris, comme par exemple
cet étonnant parloir, vaste salle, raide comme une cour d’évêché, tribunal de
chaises en cuir sur le pourtour. Un vitrail laisse pénétrer une lumière
spectrale : heureux ceux qui vont mourir pour une guerre juste est-il écrit devant
une allégorie de poilus tombé au champ d’honneur. Voilà pour l’ambiance et
c’est ici qu’ont encore lieu les conseils de classe, de discipline, tous les
rituels qui président à la vieille hiérarchie de l’éducation. Pourtant,
c’est dans ce parloir que j’ai été accueilli, et très bien, avec beaucoup de
sympathie, par l’équipe éducative comme on dit, je préfère parler de quelques
femmes et hommes convaincus que de tels lieux dépassent le rôle qu’on leur a
assigné. C’est sans doute cette ambiance donc qui a présidé à l’écriture.
C’est aussi celle-ci qui a facilité les échanges, combiens riches et non surfaits
avec Véronique Olmi et Victor Cohen Hadria avec qui j’aurai partagé ces deux
journées. En ressortant, heureux encore de
ces conversations, j’ai regardé l’appellation parloir sous un sens plus doux et
amical. Quant à Bordeaux, je visiterai la ville une autre fois, en attendant, il me reste
des photos.
(16/02/2011)
Mon premier
lecteur n’est plus. C’est ainsi que se désignait Yvon Lallemand, 62 ans, que
j’avais rencontré en 1998 et qui fût effectivement « mon premier
lecteur ». J’avais entassé quelques manuscrits dans mes tiroirs et
j’avais fini par extirper celui qui allait devenir
(09/02/2011)
Naïvement,
je pensais que les sollicitations qui avait suivi la parution de RMS, amplifiées
par la sélection au Goncourt, prendraient fin avec Noël, seraient balayées d’un
revers de torchon râpeux ou de serviette moelleuse par la semaine du blanc en janvier,
voire seraient englouties dans une part de
galette de l’Épiphanie et les parutions de la nouvelle rentrée littéraire. Force
est de constater que l’élan persiste comme un éclat de fève : avec la même
constance, les sollicitations s’amoncellent, j’en reçois une à plusieurs par
semaine que je regarde toujours avec une grande attention et une envie de participer à
tout. En même temps, le temps n’étant pas extensible à l’infini (même si
j’ai souvent cette impression), je regarde avec crainte mon agenda se remplir au
rythme parfois d’un week-end sur deux occupé à cette représentation : dans
les creux, il faut glisser le travail nourricier, l’écriture, Feuilles de route, la
thèse et les activités familiales. Parfois le voyage est bref : le hasard a
regroupé trois manifestations dans ma ville en une semaine. Je suis allé rencontrer mes
voisins dans la belle librairie L’Attente-l’oubli, puis deux classes de lycée
m’ont accueilli, visites au bout de ma rue, impressions déstabilisantes et trac
associé comme à chaque fois que je rencontre des lycéens, tant l’enjeu me paraît
important (c’est à cet âge de fragile équilibre que se déclenche tous nos
réflexes de lecture/écriture). Ce week-end, c’était Paris, moins de stress
paradoxalement malgré la difficulté intellectuelle de ces enjeux contemporains :
versé dans l’inconscience d’un amphithéâtre du Petit Palais, en compagnie de
Jean Rolin, on éprouve moins d’appréhension mais plus de timidité devant une
centaine de personnes assises dans la pénombre. Parfois, la désagréable sensation de
l’exposition devant autrui, la peur de n’être pas à la hauteur et la perte de
temps dans des transports fastidieux me font presque regretter l’acceptation de ces
contraintes. Enfin quoi, je ferais mieux de consacrer mon temps à écrire, plutôt que de
le passer à tenter d’expliquer dans diverses manifestations ce qui, de toutes
manières, demeure par essence un mystère. Mais c’est plus fort que moi, ces
échappées voyageuses m’attirent à la manière de Rimbaud, je m’en vais, sac
au dos ou valise à roulettes, les poings dans mes poches, crevé parfois, toujours
enthousiaste à pousser mes semelles devant, je descends ces fleuves impossibles.
Liberté ! Ah, liberté d’aller et de venir sous le ciel de la
littérature ! Écho grisant des mots, embruns de tout ce qui constitue mon enveloppe
de phrases, mon univers de langage, j’y trouve un intérêt certain qui dépasse la
simple sensation d’appartenir à l’acte entier d’écrire. Pareils
sentiments de fuites heureuses se retrouvent chez Blaise Cendrars (« quand tu
aimes, il faut partir »).
Le ciel de la littérature était très clair ce week-end : journées incomparables
de janvier avec l’azur figé par le gel. (voir en webcam). Des pas qui résonnent à
l’unisson sur les pavés des quais de Seine, des cygnes qui s’envolent, les
pierres blondes des façades, l’ombre au sous-sol du Petit Palais, des rencontres,
des retrouvailles, la place Saint-Michel derrière les vitres d’une pizzeria, le
reflet blond des bières, les mots qui se bousculent, tant de choses à dire, la rue du
bac au soir tombé, la lente remontée vers Saint-Germain dans la nuit, des pensées
éparses, les visages aperçus, les sourires, tout est à retenir et le bonheur avec.
(02/02/2011)
S’astreindre
à un programme régulier la thèse l’écriture le travail les mises à jour les
sollicitations doubles triples ou quadruples recevoir donner accompagner partir revenir
voyager saluer revoir dormir courir cuisiner (dernière fierté un cuissot de sanglier au
miel et au cidre parfaitement réussi) rouler téléphoner vivre vivre vivre cœur qui
bat s’essoufler manger moins de chocolat plus de légumes s’astreindre à un programme régulier la thèse l’écriture
le travail les mises à jour les lessives les courses les soldes j’ai pas eu la fève
cette année rire être heureux pas eu la grippe non plus douter s’énerver la télé
glander glousser gloser se fatiguer ça tourne ça tourne (vertiger) souffler avaler
chanter la boulangerie la maison écrire écrire écrire écrire rêver s’astreindre à un programme régulier la thèse l’écriture
le travail les mises à jour prévoir faire des plans sur la comète peigner la girafe se
monter le carafon jurer rire partir revenir marcher voiturer trainer respirer retenir
ranger chercher l’aiguille dans la botte de foin se raser se couper se laver les
dents écrire écrire écrire Lille Amiens Saint Quentin Paris Châlons attention radar
les collègues les entretiens de recrutement écouter écouter rouler en sens inverse
manger sur le pouce déjeuner rubis sur l’ongle y penser en se rasant radoter raboter
chat botté ceux qui comprennent ceux qui ignorent ceux qui s’en foutent dormir
s’astreindre à un programme régulier la
thèse l’écriture le travail les mises à jour et quatre ratons laveurs remplacer la
courroie du sèche linge le buzz quel mot stupide dormir ah ah la retraite quand les
poules auront des dents le chat le poisson rouge à part ça ça va un peu lent en ce
moment jouer chanter travailler réunioner téléphoniquement réunioner physiquement
écrire écrire mettre à jour soliloquer monologuer colloquer s’astreindre à un programme régulier faudrait quand même
changer le papier peint refaire la cuisine le couloir la chambre les toilettes la thèse
l’écriture le travail travailler rencontrer ça tourne ça tourne (vertiger) courir
une bière mon empire pour une bière fraîche chanter imiter la poule l’expression
rire comme une tarte décousue travailler tourner vertiger s’énerver conduire
piloter accélérer s’étonner attention radar voir apercevoir se mouvoir
s’émouvoir comment ? (être sourd) gigoter se démener rêver voyager tourister
téléphoner smser e-mailer nettoyer ranger lessiver ramasser suer épaissir maigrir rire
lire à voix haute répéter jouer de la guitare rencontrer (des lecteurs des lycéens)
expliquer se sentir imposteur (s’imposter) crier encrier vivre écrire vivre écrire
à part ça ça va un peu lent en ce moment.
(27/01/2011)
Témoignage
émouvant tout à l'heure de la part d'une collègue téléopérateur qui a lu Retour
aux mots sauvages et que je croise dans l'escalier avec un autre : " Tu tombes
bien, je parlais justement de ton livre. Figure-toi qu'il y a quelques jours je l'ai
prêté à ma mère pour qu'elle puisse le lire. Et j'ai eu honte. Honte. Honte de
jusqu'où j'avais été dans l'acceptation et que ma mère le sache. Toi, bien sûr tu ne
t'en rends pas compte, tu l'as écrit avec une distance. Tu connais notre métier mais tu
ne le pratique pas au quotidien. Mais là, devant ma mère qui ne connaît pas non plus ce
que je fais. Elle me l'a rendu hier. Elle m'a déconseillé de le lire si toutefois je ne
l'avais pas déjà fait. Elle avait les larmes aux yeux et moi j'étais dans la honte.
"
(19/01/2011)
38297,
c’est le nombre de visiteurs venus sur mes Feuilles de route en 2010. Effet
médiatique du Goncourt oblige, les deux derniers mois ont dépassé 4800 connexions, je
suis donc sur une trajectoire de plus de cinquante mille visites. Au demeurant, c’est
parce que j’ai changé d’hébergeur depuis plus d’un an que je suis capable
à nouveau de produire ce chiffre. Mes pages perso ne
sont plus suivies mais continuent d’alimenter un petit reliquat de quelques centaines
de connexions par mois. Depuis la création de
Feuilles de route, donc, plus de dix ans auparavant, je dois approcher les trois cent
mille visites, chiffre qui m’indiffère, ne veut pas dire grand-chose, à la fois
beaucoup pour moi et très peu dans l’univers du web. La première année pleine
(2001), j’avais obtenu 3900 connexions ! Mais le Web était encore bien désert
et l’engouement pour Internet des années suivantes a fait croître la fréquentation à mesure :
quatorze mille visites en 2002 pour dépasser les vingt mille en 2003 et en 2004 et les
trente mille chaque année jusqu’en
(12/01/2011)
D’abord,
dire que de résolution à révolution, il n’y a qu’une lettre d’écart,
proximité qui éclaire d’une manière différente les bonnes résolutions de début
d’année. Comme dirait Roland dans Retour aux
mots sauvages « la révolution, ce n’est jamais qu’une course autour
de soi » (p. 286 – Voilà que je me cite moi-même à travers mes personnages ,
où va le monde ?) et ainsi les résolutions que je prends en ce début d’année
n’ont-elle qu’une incidence minime. Néanmoins, tout comme la lecture de
l’horoscope de l’année, on ose y croire dans un élan d’optimisme et dieu
sait si la nature m’a gâté dans cette générosité insouciante. Allez, je les
proclame à la face du monde :
1°) Ma thèse, je rédigerai :
En effet, il ne me reste qu’un an et demi avant de pouvoir prétendre à accéder à
la plus haute marche universitaire, encore faut-il m’atteler à cette tâche
opiniâtre. Le meilleur moyen me semble-t-il est de me replonger dedans un peu chaque jour
et de construire patiemment l’écheveau des cinq cents pages qui me semble être un
minimum de bon aloi pour un tel travail.
2°) La littérature, je servirai :
J’ai eu le bonheur et le plaisir avec RMS de répondre à toutes les
sollicitations qui m’étaient possibles et j’entends bien continuer ces voyages
et ces rencontres, d’où la nouvelle rubrique Agenda, d’où des projets à venir
et qui déjà me passionnent.
3°) La course à pied, je continuerai :
« Orandum est, ut sit mens sana in corpore
sano », comme disait Juvénal. Et justement, les voyages, la vie irrégulière a
besoin de ces parcours de remise en forme.
Voilà : pas plus de trois résolutions, rien de révolutionnaire. Les autres
douceurs, famille, boulot, bricolage et imprévus divers suivront sans effort dans le
quotidien des jours, même si on se prend à rêver de véritables révolutions, histoire
de mettre du piment, de bouter la morale bien-pensante et consensuelle, de rire devant nos
peurs frileuses dans cette année qui précédera les présidentielles.
L’écriture ? C’est une tâche de fond comme le travail invisible d’un
ordinateur, cela ne s’arrête jamais, c’est inscrit dans mon inconscient nuit et
jour. C’est encore une révolution mais cette fois-ci dans le sens astronomique,
quelque chose d’elliptique qui s’inscrit dans la nuit des temps et qui ne
s’arrête jamais.
(05/01/2011)