|
Etonnements La
Réserve, Paysage et portrait en pied-de-poule 1937 Paris -
Guernica |
|
Notes d'écriture 2018
Service de Presse pour ST :
je retrouve avec plaisir Fayard, rue du Montparnasse. Plaisir de sonner à l’accueil,
de voir Dominique et Jean-François, de croiser Carole et Pauline (failli pleurer de rire
avec elle en évoquant ensemble nos périples à Morges en 2014 - voir Webcam du 10/09/2014)). Le Service de Presse, le
SP comme disent les pros, est un exercice fastidieux, autant le faire dans la bonne
humeur. Dominique m’a préparé une liste de journalistes divers et variés, à peu
près deux cents, auxquels je dois envoyer mon nouveau livre, agrémenté d’une
dédicace, que, généralement, je personnalise. Autant dire que l’écriture ne
chôme pas pendant trois à quatre heures. Pour ce faire, je suis reclus dans une petite
pièce à côté de l’open-space des attaché(e)s de presse, endroit dont la porte
reste ouverte et donne sur les casiers dévolus au courrier. Ainsi pas mal de monde passe
par ici et c’est plus sympathique.
Mais surtout, c’est l’occasion de découvrir le livre, tout juste
fabriqué : il est vraiment très beau avec un bandeau du plus bel effet, une belle
photo de moi (la photo est belle, elle est de Richard
Dumas ; l’image du type dessus m’indiffère même s’il a une vague
ressemblance avec celui que je croise dans le miroir de la salle de bain). J’ai
apporté un sac pour ramener mes propres exemplaires d’auteurs, mais le premier de la
pile que je touche devient mon exemplaire, c’est comme cela depuis mon premier livre,
vieux fétichisme… Bref je m’attelle au SP à un rythme d’enfer toute la
matinée et découvre dès les premières dédicaces que le titre long, s’il
présente un désavantage pour le retenir par cœur, est en revanche parfait pour
personnaliser celle-ci, car il sonne comme un début de phrase qui attend sa conclusion.
Ainsi Il se pourrait que je disparaisse sans trace
est complété au gré des exemplaires par « le plus tard possible »,
« mais pas avant que vous ayez parlé de mon livre » et autres
mentions loufoques. En début d’après-midi, Gaspard-Marie
Janvier vient me saluer, nous étions ensemble à la rentrée littéraire de septembre
2012 et avions obtenu tous deux notre nomination au Goncourt, lui pour Quel trésor ! et moi pour Ils désertent. Nous partageons à nouveau une
rentrée littéraire, cette fois-ci en janvier et échangeons nos livres. En route
maintenant pour de nouvelles aventures !
(17/12/2018)
J’ai
pris la mer. Je me suis éloigné, je n’ai plus la côte en vue, je suis au milieu
des vagues, ballotté, chahuté, en même temps excité et heureux, spectacle de la houle,
longs frémissements hauturiers : je suis banalement en train d’écrire, mais au
long cours. Au long cours veut dire une traversée lente, dix-huit mois d’écriture
à venir, opiniâtre, régulière (enfin j’espère). Pour l’instant, les vents
me sont favorables : vingt pages la semaine précédente, trente pour celle qui vient
de s’écouler. J’ai besoin de ce rythme, la traversée sera longue, mille pages
pourquoi pas ? Se jeter à l’eau donc, à tous les sens, le travail,
l’écriture, les recherches, tout ce qui préoccupe, mange les heures, le calcul
incessant de la trajectoire comme avec un sextant tendu vers les étoiles : un
plaisir. Frissons de la fiction aussi, de l’invention (cette matière impalpable
surgie de notre cerveau comme un rêve éveillé) et l’impression que les choix pris
sont irrémédiables, qu’on ne peut faire marche arrière, à peine corriger le cap
de quelques degrés. Reste alors l’illusion que la langue peut seule sauver le
texte : on se relit, on peaufine, on brique le pont du navire. Le livre en cours, au
long cours, m’absorbe comme un buvard et fixe des mots définitifs sur des
impressions vagues, mais des certitudes aussi vitales que le vent et l’eau.
(10/12/2018)
Dernière rencontre de l’année et fin du Beinstingel
world’tour comme aurait dit l’ami Delatour (qui visitera sans moi ce mercredi la maison du handball de Créteil où sont accrochées à demeure
quelques toiles et textes de Instant Handball : grande fierté), dernière rencontre,
donc, à Chartres pour fêter la fin de la résidence d’Anne Savelli avec l’ami
Pierre Cohen-Hadria. Nous attendions tous trois cette manifestation avec impatience :
se réunir ensemble n’est pas si courant et ça faisait longtemps. La rencontre a
lieu à l’Esperluette, la très belle librairie d’Olivier L’Hostis. Peu de
monde mais des échanges très intéressants sur la manière dont chacun d’entre nous
mélange numérique et publication traditionnelle. J’évoque FdR, bien sûr, Anne l’évolution récente de
son site devenu annesavelli.fr et Pierre, ses contributions
partagées, notamment sur Pendant le week-end. Côté publication, Anne
espère des nouvelles bientôt pour son magnifique roman sur Marilyn et ses photographes
(incompréhensible que personne ne se soit pas encore rué sur cette somme
inédite !) et Piero continue à commenter avec son style si particulier, à la fois
détaché et profond, les beaux clichés de Denis Pasquier : dernier livre paru Et alors, Venise ? Finalement, tout cela
représente pour nous trois un important travail. La soirée se termine dans des
sourires : voici nos vies…
(03/12/2018)
Ma vie littéraire
est étrange, où plutôt éclatée devrais-je dire. D’un côté, il y a les livres
parus à faire vivre dans une sorte de service après-vente comme Vie Prolongée d’Arthur Rimbaud dans les
librairies de Neufchâteau et Charleville, ou Retour
aux mots sauvages et Ils désertent
évoqués à Lyon et à Échirolles, de l’autre, la parution imminente de ST pour janvier, deux ans et demi après le
précédent, se précise chaque jour un peu plus et je commence déjà à prévoir des
rencontres.
En même temps, j’ai commencé depuis le 2 août dernier le projet Y, un récit important qui me trotte dans la tête
depuis longtemps. Ceci dit, les occupations de l’été, les vacances en Bolivie, les
diverses relectures nécessaires à la parution de ST
ne m’ont pas permis une écriture très régulière. Lorsque j’ai repris Y en rentrant de Bolivie, il végétait depuis fin
septembre. J’ai eu en effet jusqu’à présent l’impression d’un début
difficile et assez lent. J’ai cependant une idée assez précise de ce qui devrait
être une saga assez longue (500, 700 pages ?). Je sais où je vais et, ce qui me
rassure, j’entrevois quel est mon rôle en tant qu’auteur et quelle place je
dois occuper vis-à-vis de ce récit. Je m’aperçois au fur et à mesure de mes
parutions que cet aspect est l’un des plus important : savoir se situer en tant
qu’auteur dans le récit. Pour ST qui se
décompose en trois histoires entremêlées mais distinctes tout de même, je n’ai
pas trop su comment me positionner et c’est pourquoi j’ai eu un peu de mal à le
voir se diriger vers la publication, un peu comme si l’histoire m’avait lâchée
en route. Ceci dit, avec la réalité de la parution qui s’affirme, cette impression
s’estompe, heureusement !
Pour en revenir à Y, cette histoire me demande
beaucoup d’informations qui sont difficiles à recouper. Je dois constituer cette
partie documentaire sans vraiment savoir où chercher tant la collecte est éclatée dans
différents lieux et différentes langues (par exemple, pour Vie prolongée d’Arthur Rimbaud, fortement
argumenté, l’essentiel de mes recherches s’est concentré sur quelques livres,
certes épais, une bibliographie probablement d’environ dix mille pages mais facile
à cerner). J’ai donc l’impression d’une écriture qui avance lentement et
comme je prévois un gros livre, j’ai peur de ne pas avoir un rythme suffisant, même
si le temps imparti pour rédiger ce récit est encore long. En remuant toutes ces idées
dans le train qui me menait à Lyon, j’ai eu l’impression qu’il fallait
néanmoins que j’avance régulièrement, qu’il me fallait « accumuler les
signes, augmenter les phrases ». Ces deux réflexions me sont venues et je les ai
notées. En effet, l’histoire néanmoins se structure en « livres », un
peu comme Les Misérables de Hugo ou La Guerre et la Paix de Tolstoï. J’en suis
donc au « livre premier » et il me faut en effet délayer la vie romanesque
que je prête à un premier personnage. Les journées de Lyon et Échirolles, les hôtels
et les transports m’ont ainsi permis « d’accumuler les signes,
d’augmenter les phrases » à raison d’une vingtaine de pages
supplémentaires (en format roman). Je vais tâcher de respecter cette cadence
hebdomadaire, assez proche aussi des visées de course à pied que je me fixe (vingt
kilomètres par semaine). Allez, en route pour ces deux objectifs !
(26/11/2018)
ST, bandeau et autres préparatifs : une semaine après le choix de la
couverture, ma maison d'édition me demande mon avis pour un bandeau amovible avec photo,
qui doublera mon nom. Cette option a été prise dès la rentrée littéraire
précédente, sans doute histoire de donner une plus grande lisibilité au rayon "
littérature générale " qui le mérite bien. Le cliché de mézigue est de Richard
Dumas, excellent photographe qui m'avait fasciné par sa manière de travailler uniquement
à l'argentique. Anecdote : alors qu'on échangeait sur la difficulté de trouver des
appareils de ce type, il m'avait raconté en avoir acheté un en Russie, très rustique,
qui avait consenti à ne livrer que douze photos sur une pellicule de 36 poses. Et
d'ajouter avec un sourire désarmant : " C'était forcément les meilleures ! ".
Il est donc temps de dévoiler la couverture :
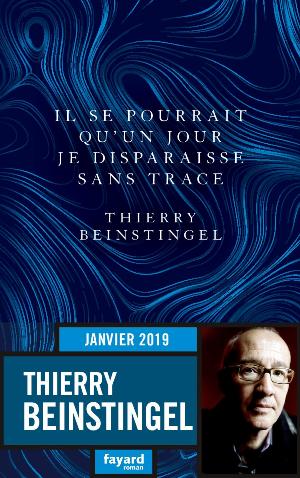
(19/11/2018)
ST se précise. Il est temps, car la parution aura lieu dans deux
mois, pour la rentrée de janvier. J'ai corrigé les premières épreuves avant mon
départ et au retour voici les traditionnelles secondes et dernières épreuves avant le
fameux " bon à tirer " qui lancera la production du livre. Restait aussi à
finaliser la " couv. " comme on dit, l'illustration de couverture. J'ai toujours
aimé ce moment où d'une façon collégiale avec l'éditeur nous choisissons parmi les
différents projets. Le titre de ST qui commence a circuler parmi les sites en
ligne des libraires est long. Une fois n'est pas coutume, j'ai voulu essayer un titre
imagé, une phrase complète qui renseigne le lecteur (ou le fourvoie…). Bref (enfin
si l'on peut dire), ça s'appelle Il se pourrait qu'un jour je disparaisse sans trace
(quatorze syllabes, d'où le sigle ST, plus rapide pour nommer mon machin). C'est
une citation de Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique et il y
a forcément un rapport avec l'histoire. Ça fait aussi Marc Levy comme titre (ou Fred
Vargas). En fait, j'espère secrètement attirer par ce truchement quelques dix mille
lecteurs supplémentaires… Trêve de plaisanterie, avec un titre pareil,
l'illustration de couverture ne pouvait être qu'abstraite, histoire de ne pas ajouter à
la surenchère d'images provoquée par cette longue suite de mots. Nous avons donc choisi
une couverture " bleu pétrole " avec un entrelacs de vagues bitumeuses. Et
comme j'en ai déjà beaucoup dit, je la laisse encore un peu en suspens.
(12/11/2018)
J'ai été invité à la vallée aux loups. On pourrait croire à la dénomination à un
lieu reculé, situé en pleine campagne, il n'en est rien : la vallée aux loups est
située à 15 km de Paris, sur la ligne B du RER. Ce vaste parc agrémenté d'une demeure
bourgeoise a été une des maisons de Chateaubriand. En fait, pour moi, la vallée aux
loups a surtout été le siège de la clinique du docteur Le Savoureux. Ce psychiatre,
admirateur de Chateaubriand, avait acquis le domaine en 1914. Paul Léautaud s'y éteignit
en 1961, venu presque en voisin de Fontenay-aux-Roses.
La vallée aux loups, dénommée maison de Chateaubriand, est maintenant propriété des
Hauts-de-Seine et est proposée à la visite. On trouve ainsi en traversant les belles
pièces un musée consacré au poète, mais ce lieu doit surtout son charme au vaste parc
qui l'entoure, le préservant dans une tranquillité étonnante, si proche de la capitale.
Endroit propice à la méditation, à la réflexion, la maison accueille des colloques,
des expositions, des conférences, des animations consacrées à ce premier romantique
mais pas seulement. Anne Savelli y
réalise des ateliers d'écriture et c'est dans le cadre de sa résidence qu'elle a eu la
très bonne idée de m'inviter, histoire de confronter Rimbaud à son prédécesseur
illustre. Il a donc été question de Vie prolongée d'Arthur Rimbaud, qui vient de
paraître en poche. Mais avant d'aborder la discussion dans la très belle bibliothèque
de la maison, il y a eu la visite de la maison, du parc, la très bonne glace dégustée
en regardant les perruches voler d'arbre en arbre, le repas de midi avec Anne et Gilda à
Saint-Michel (Gilda que j'avais loupé au Sedan-Charleville, voir la note d'Étonnements
de la semaine précédente), toute une amitié joyeuse qui nous a réunis toute cette
journée. Avec Anne, nous nous connaissons en effet depuis longtemps, du temps de
Remue.net, 2ème AG, 2003 : dit comme cela ça fait un peu souvenir de campagne de Russie.
A savoir que nous nous sommes retrouvés par la suite et avons même écrit un livre en commun, Autour de Franck, en 2011. Autant dire
qu'Anne n'a eu aucune difficulté à animer la soirée, connaissant bien la genèse de
" mon " Rimbaud à travers les discussions fréquentes que nous avons eues, que
nous avons d'ailleurs toujours régulièrement, nos regards croisés sur l'élaboration de
nos textes (tandis que j'écrivais sur Arthur, Anne écrivait sur Marilyn, deux mythes
finalement assez semblables). Au final, il était évidement facile de transmettre au
public (peu nombreux) l'enthousiasme qui sied à nos échanges littéraires. Cette
première intervention d'automne était importante pour moi, même si je me sentais encore
un peu comme un touriste au sortir de l'été, il était essentiel de pouvoir renouer avec
ce genre d'échanges. Même avec l'habitude, il n'est jamais facile de présenter ce qu'on
écrit. En novembre, cinq autres rencontres sont notées dans mon agenda, et ST, le livre qui paraîtra en janvier prochain,
m'impose aussi de pouvoir en discuter facilement, à commencer par prononcer son titre
correctement, n'est-ce pas Anne ?
(19/12/2018)
Un numéro des Cahiers de l'Herne est consacré à Joyce Carol Oates
(nommons-là JCO comme elle s'appelle elle-même, c'est plus facile). Paru à peu près au
même moment que celui qui concernait Pierre Michon, évoqué dans cette même rubrique le
21 septembre dernier, il me paraît intéressant de comparer JCO donc à notre auteur
français. Beaucoup de choses les séparent. En premier lieu, l'activité débordante de
l'universitaire de Princeton et sa boulimie d'écriture n'ont rien à voir avec les
maigres opus fournis par Pierre Michon, sa vie en apparence retirée et contemplative.
Peut-être vient de là la manière dont les contributeurs du cahier réservé à Pierre
Michon ont presque tous insisté à le dépeindre comme un écrivain majeur, comme s'il
fallait se persuader qu'une œuvre maigre est autant digne d'intérêt qu'un nombre
fourni de publications. Ça en dit long sur notre vision persistante à confondre
quantité et qualité dans nos jugements (et surtout dans les chiffres de vente). Mais
plus crispant et typiquement français, est le syndrome du grantécrivain
évoqué déjà largement dans mon article consacré à Michon. Pour JCO et dans l'optique
américaine, la question ne se pose pas, l'écrivain ne semble pas comme chez nous devoir
son statut à une sorte de don surnaturel qui lui tomberait dessus et qui mériterait ad
vitam eternam l'admiration béate des lecteurs. En particulier pour JCO l'écriture
c'est beaucoup de boulot, ça s'enseigne (elle l'enseigne), les livres se succèdent et ne
sont pas tous des chefs d'œuvres, le suivant chassant le précédent. Tout cela on le
pressent en lisant les témoignages qui jalonnent le Cahier de l'Herne. On apprend par
exemple que les universitaires qui tentent d'étudier son œuvre sont rebutés par la
quantité faramineuse de manuscrits à dépouiller. On constate combien elle est capable
d'être présente pour ses amis en plus de ses multiples activités. Cela, on le savait
déjà : il suffit d'aller visiter son compte twitter pour s'apercevoir que JCO n'est pas
un écrivain reclus dans une tour d'ivoire (voir en particulier cette anecdote qui ne figure pas dans les Cahiers de l'Herne mais qui
en dit long sur les différences de vues USA et France à travers la rencontre loupée
entre Jeanne Moreau et JCO). Au final, le Cahier de l'Herne spécial JCO nous la rend plus
sympathique encore, plus ouverte et non pas enfermée dans une posture inutile d'écrivain
consacré telle que le cahier consacré à Michon nous le laisse entrevoir.
(12/10/2018)
La parution prochaine de ST en janvier bouscule le calendrier. Je
feins de m'en étonner, pourtant quoi de plus normal de prévoir déjà en octobre la
réunion des " repré. ", abréviation de représentants que les " pro.
" de ma maison d'édition laissent parfois échapper. Le représentant est à la
maison d'édition ce que l'ancêtre de mon roman Ils désertent est au papier
peint : tous deux sont des sortes de grossistes et travaillent avec d'autres
professionnels, qu'ils soient libraires ou revendeurs en tapisserie. Le rôle du "
repré. " est important : il vise à la bonne visibilité de ces livres, il annonce
les nouveautés. Pour Fayard, il y a beaucoup à faire, le catalogue est diversifié et la
littérature française occupe une place, certes méritable, mais pas exclusive de sa
production. C'est justement cette variété qui m'a toujours plu dans cette maison : ne
pas être exclusivement sur la sellette d'une collection exclusivement littéraire, mais
voisiner avec des essais politiques, sociaux, des documents historiques. Bref, me voici ce
mercredi confronté avec les " repré. " de la maison, une bonne trentaine
réunis dans un hôtel de Paris. Je repère des visages connus, ce n'est pas la première
fois que je me frotte à l'exercice. Comme d'habitude, j'ai bafouillé pendant quinze
minutes, j'ai essayé d'être vivant et de persuader, mais ce n'est jamais facile. Pour
autant, je serai " repré. ", je serais content qu'un auteur vienne m'expliquer
pourquoi il a conçu un livre, un roman, un essai. J'ai l'impression qu'on retient mieux
l'argumentaire qu'on va présenter aux libraires. Et puis, c'est l'occasion pour moi
d'entériner cette future parution : elle devient réelle, je l'explique, j'en suis très
heureux.
Autre motif de satisfaction, j'ai reçu les premières corrections concernant mon texte.
Elles sont importantes : on commence à travailler dans la cohérence du texte, on
déniche les lourdeurs, les répétitions, la concordance des temps, on débusque les
maladresses, les fautes. Je travaille ainsi sur une version du texte qui sera proche de ce
qu'on appelle les épreuves, donc qui donnent déjà l'aspect final du livre : celui-ci
dépassera comme je le pensais 300 pages. Je me suis ainsi glissé avec beaucoup de
plaisir dans ces premières corrections. J'ai toujours été sensible à l'aspect physique
d'un livre et tout ce qui peut m'en rapprocher est évidement bienvenu. Et puis c'est une
manière de me réapproprier le livre, d'en devenir son premier lecteur et dieu sait si
pour ST je me suis senti bizarrement loin jusqu'à présent. Nouveauté : pour ce
livre, je procède de deux manières : d'abord je valide et j'intègre les suggestions
dans le texte, puis, chose inédite, j'enregistre le chapitre à voix haute (j'ai ainsi
une version audio complète de mon livre). Il n'est pas rare que je débusque alors
d'autres corrections à apporter. En plus d'être le premier lecteur, je suis ainsi le
premier auditeur à écouter la voix de l'auteur qui est moi : quelle schizophrénie !
A noter que j'en ai profité pour repérer deux contrepèteries, évidemment
volontairement intégrées : c'est une manie, une sorte de porte-bonheur voulu par mon
esprit carabin. Chacun de mes romans en contient au moins une. Avis aux amateurs : pour ST,
elles figurent aux chapitres 32 et 34.
Au final, je suis très content que la réunion des " repré. " de mercredi ait
coïncidé avec cette série de premières corrections, d'abord je me suis aperçu que
j'arrivais à mieux en parler, ensuite certaines appréhensions que j'avais au sujet de
cette histoire emberlificotée se sont dissipées : le titre, que je jugeais trop long par
exemple passe bien, et l'histoire qualifiée de " magnifique " m'a fait
évidemment très plaisir.
(05/10/2018)
" Ils sont trois.
Elle enseigne l'allemand dans un lycée mais tente aussi d'inculquer des notions de
français à des migrants accueillis par une association humanitaire.
Lui a accepté le travail le plus étrange de sa vie : gardien d'une station de pompage
même plus en service et si isolée au milieu d'interminables champs de maïs que son
employeur a dû l'y faire déposer en hélicoptère.
La troisième, encore aux études, gagne sous le manteau un peu d'argent en rendant visite
à un garçon autiste que celle qui se présente comme sa mère cache aux services sociaux
dans un immeuble de la périphérie voué à une démolition prochaine.
Tous les trois vont faire, à des degrés divers, l'expérience de l'effacement, de la
perte des repères et des habitudes qui tiennent lieu le plus souvent d'identité. Mais si
c'était pour mieux découvrir ce que vivent d'autres gens, et notamment les plus faibles
? "
Voici l'argumentaire pour ST proposé par ma maison d'édition.
Je le trouve simple, efficace, allant droit au but. C'est drôle parce que la plupart du
temps, je ne sais pas évoquer l'histoire (l'intrigue ?) de mes propres livres. En
particulier pour ce dernier, je bredouille vaguement qu'il s'agit d'une histoire à trois
voix, et rapidement j'oblique vers le rapport avec Robinson et Vendredi, parce que mes
éternelles questionnements sur les îles désertes, l'impossibilité de découvrir des
terres vierges, notre instinct à vouloir toujours refaire ce que nous connaissons, notre
peur devant le trublion qui vient nous déranger, ont été à la base de ce livre. Mais
je confonds cette cuisine interne qui a mené au livre avec un résumé. Elle n'est pas la
préoccupation première du lecteur. Il veut savoir ce que ça raconte (à ce propos, le
titre d'un roman de la rentrée littéraire Ça raconte Sarah est un argumentaire à lui
tout seul…). Seulement, je suis persuadé qu'un auteur est probablement le moins apte
à décrire son livre parce que bien des réticences l'empêche de le formuler. Le mot
" migrants ", par exemple, il est vrai que pas mal de migrants traversent cette
histoire, ce ne sont des personnages principaux, ils se fondent dans le paysage comme
actuellement, mais en même temps ça m'importune de réduire cette histoire à ce thème
actuel qui traverse la littérature française, mais il y aurait beaucoup à dire sur ma
réticence, sur ce thème aussi, pourquoi est-il si émergent ? (dans une future note
d'écriture ?). En même temps de voir étalé ainsi le résumé me place devant le fait
accompli : c'est bien un roman que j'ai fait. Ce n'est pas si évident de se l'avouer.
" L'ère du soupçon ", expliquée par Nathalie Sarraute nous taraude encore,
nous qui avons entrepris d'écrire avant la fin du siècle dernier. Avec un roman de
facture classique, je bafoue les interdits littéraires alors édictés, je choisis "
mes personnages ", je bâtis " mon histoire ", bref je prends le pouvoir
comme les romanciers du XIXème, et le pouvoir c'est le mal, disait-on alors.
(28/09/2018)
Chez moi, on dit facilement, pour quelqu'un qui se met en avant, qui se
pousse du col : " Il se croit " ce qui donne avec l'élision des consonnes pour
mieux marquer l'affirmation : " ys'croit " ou encore " ysla' raconte
", voire plus trivial, " ysla' pète ". Balayons de suite l'ambiguïté :
non, pas de procès d'intention pour Pierre Michon, dont un des Cahiers de l'Herne lui est
consacré depuis novembre dernier. On ne pense pas qu'" ysla' pète ",
peut-être qu'" ysla' raconte ", ce qui paraît normal pour un romancier. Reste
à croire, y croit-il ? Croyance, croix à porter, églises de campagne, calvaires
essaimés sur des chemins déserts, on retrouve le décor habituel de Pierre Michon, vies
minuscules, ambiance minimale, écriture maxi. Mais voilà : sa consécration en vie de
saint, en lettres majuscules, en hagiographie ne va-t-elle pas son encontre ? Je voulais
commencer par cette interrogation, car elle a pollué la lecture de cette publication (au
demeurant fort intéressante et variée). C'est évidemment une séance d'admiration pour
les contributeurs (plus de soixante-dix !) coordonnés par Agnès Castiglione et Dominique
Viart : on n'accepte pas d'y participer sans ressentir quelque affinité avec l'écrivain
soumis à la questionnette. Admiration excessive : " C'est le plus grand écrivain
français " déclare sans rire François-Henri Désérable (p.335) ; admiration
matoise : " Pas un exercice d'admiration ", insiste Marie-Hélène Lafon en
enfonçant le clou " Je l'appelle PM " (p.331) ; bref, "comment survivre à
tant d'admiration ? " se demande Patrick Boucheron (p.251). Il faut donc éliminer à
la lecture toutes ces scories et c'est évidemment crispant, d'autant que le rigolard
Pierre Michon se compose un personnage de lui-même à l'écart du grand bruit en riant
tout de même bruyamment. Ce qui est crispant n'est pas l'admiration en soi, mais la
perpétuation d'un système grantécrivain typiquement français me semble-t-il.
Gracq parti, il faut des successeurs. L'un des contributeurs appuie : Non, Michon n'est
pas un écrivain mineur. D'où vient cette hantise d'être versé dans la catégorie
maudite ? René Fallet se réjouissait au contraire d'être un écrivain mineur. Je n'ai
pas abordé avec la même réticence le cahier de l'Herne consacré à J.C. Oates (article
à venir…), mais probablement parce que je suis éloigné de la scène américaine.
En revanche, une fois cette défiance écartée, le cahier de l'Herne de Pierre Michon
nous apprend une foule de choses, notamment sur l'ambiance littéraire contemporaine. Les
meilleurs textes sont ceux de l'auteur récipiendaire, attentes, désillusions, toute la
cuisine de l'écriture, de la réception des œuvres. On apprend par exemple qu'il n'a
été vendu que 1917 exemplaires de VM au départ. On applaudit des deux mains lorsque
Michon évoque Jean Valjean, sa lecture fine des Misérables (je suis en plein
dedans, ça fait écho). D'autres textes viennent parfaire parfaitement le fait : par
exemple, ce " journal en public " de Maurice Nadeau, En fait le génialissime
intérêt de ce cahier est de permettre, pour qui le souhaite, de fouiller dans le
détail, comme on le ferait dans des étals de brocante pour dénicher, ici une tirelire
en forme de petit cochon, là un pichet vernissé, céans une clé à molette rouillée.
On reste ainsi dans le vrai sans prétention, dans la vie minuscule de l'écriture, "
matérielle " aurait dit Duras.
(21/09/2018)
Oups le Goncourt ! Je me suis souvenu il y a deux jours que la sélection
du fameux prix avait dû paraître. En fait, cela fait déjà une semaine qu'on connaît
les quinze heureux lauréats. Je connais peu de monde, à part Clara Dupond-Monod (qui
publie La Révolte) qui m'avait accueilli dans une émission sur France Culture
à la sortie de RMS en 2010. Certains sont de parfaits inconnus pour moi,
certains noms me disent quelque chose, mais je ne connais pas ce qu'ils ont écrit
auparavant. Les maisons d'éditions sont toujours les mêmes, une paire de Grasset,
d'Albin Michel, de Stock, quelques Gallimard, le reste se répartit chez Flammarion,
Seuil, Minuit, Actes-Sud (où un seul candidat semble une initiative dosée, le jury
Goncourt adressant un salut amical à madame la PDG-Ministre). Les titres sont soit
percutants (Quand Dieu boxait en amateur), histoire d'éveiller la curiosité du
lecteur, ou d'une évidence de bon aloi (La Vraie Vie) ; les titres avec
compléments de nom s'utilisent toujours (Les Malheurs du bas, L'Ère des suspects,
L'Hiver du mécontentement) (moi aussi, je l'ai pratiqué notamment avec Journal
de la canicule). Chez Minuit, normal, on ose un titre très beckettien (Ça
raconte Sarah) issu du fameux " bon qu'à ça " répondu par le Nobel à
qui lui demandait pourquoi il écrivait. Bref, voilà quinze auteurs lancés dans les
affres de l'attente de la prochaine sélection, sollicités également pour le tour de
France du Goncourt des lycéens, qui est le principal intérêt d'en être.
C'est drôle, je regarde cette vie littéraire avec indifférence, ou plutôt
désintérêt. Je ressens l'éloignement des deux sélections du fameux prix qui m'avait
gratifié il y a déjà 8 et 6 ans. Ma vie (et j'ose espérer que mon écriture aussi) a
continué à avancer, tant mieux. Trois romans sont parus. J'étais presque soulagé de ne
pas voir Faux nègres dans la sélection, j'aurais été très embarrassé en
2014 avec une troisième publication de suite. Quant à Journal de la canicule,
il a paru en octobre 2015, histoire d'être éloigné de la course au prix. J'aurais aimé
un succès pour Vie prolongée d'Arthur Rimbaud en 2016, mais probablement que
s'attaquer au mythe de Rimbaud a joué en ma défaveur. Le suivant paraîtra en janvier,
donc, pas de course aux prix non plus. Bref, je retombe dans un anonymat serein et
j'attends déjà les prochaines critiques : il y a toujours un journaliste qui pense,
parce qu'il n'a jamais entendu parler de vous, que vous êtes un nouvel auteur, de
surcroît jeune et ça c'est top !
(14/09/2018)
En ce moment, je lis le cahier de l'Herne, consacré à Joyce Carol Oates
(de même que celui qui concerne Pierre Michon, tous deux parus en 2017). Nous en
reparlerons, mais en attendant, deux citations de J.C.O. m'ont interpellée :
" N'importe quelle activité créatrice a des chances de provoquer des angoisses.
Plus l'angoisse est forte, plus vous avez l'impression que vous vous dirigez dans la bonne
direction. La facilité, la détente, le confort vont rarement de pair avec un travail
sérieux. "
" Écrire un roman c'est s'embarquer dans une aventure très romantique. On a des
visions et l'étape suivante consiste à les représenter. "
La première citation au départ m'a interpellé. J'ai pensé qu'elle ne me concernait
pas. Le terme d'angoisse est fort. Pour moi écrire est une somme de problèmes à
résoudre, rien à voir avec une peur irraisonnée. L'inquiétude existe bien-sûr, celle
de savoir d'abord si l'idée initiale est bonne, si le livre projeté tiendra la route.
Elle ne cesse il est vrai de continuer, parfois de s'amplifier au fur et à mesure de
l'écriture. J'ai souvent comparé l'écriture à une course de fond : avant la moitié du
parcours, on ne sait pas si on va la terminer. En revanche ce qui m'interroge dans la
phrase de J.C.O., c'est la corrélation entre l'intensité de cette inquiétude et la
certitude d'avancer dans la bonne direction. En un certain sens, c'est vrai. Chez moi,
l'angoisse (mais je ne la ressens pas comme telle, plutôt une préoccupation, parfois une
anxiété) se manifeste de différentes façons. J'évite de me retrouver devant le texte
à écrire, je multiplie les occupations qui vont m'en détourner, je me sens faible et
indécis, où alors j'y pense tout le temps, j'avance avec opiniâtreté, avec certitude.
J'imagine que c'est cette échelle de sensations qu'elle a voulu indiquer : plus on est
conscient de la difficulté du thème que l'on veut traiter, plus on va chercher à la
résoudre : qu'il s'agisse de manière technique (choix du sujet, de la " voix
", du temps narratif, du style…) ou de manière intime (qu'est-ce qu'on cherche
à prouver, comment le livre nouveau s'inscrit dans le parcours d'écriture, où je me
situe en tant qu'auteur au milieu des personnages…).
Joyce Carol Oates ajoute, en complément à sa pensée, que " la facilité, la
détente, le confort " ne correspond pas à un " travail sérieux ". Cet
adjectif, je dois dire provoque chez moi, oui, une angoisse, ou du moins la crainte de ne
pas avoir fourni de travail suffisant (sérieux, donc) pour le livre à paraître ST.
Pourtant, facilité, détente, confort ne m'ont pas forcément accompagné pendant la
rédaction. Au départ, je voulais me remettre vite à l'écriture d'une fiction, tant je
pensais que la rédaction continue pendant plus d'un an de ma thèse avec la nécessité
permanente de l'argumentation, de la preuve à apporter, avait complètement occulté la
liberté apparente que propose l'écriture romanesque, au point peut-être de la pervertir
durablement. ST m'a prouvé que ce n'était pas le cas, mais en même temps,
cette précipitation à reprendre l'écriture d'invention m'a empêché de réfléchir à
la pertinence de ce que j'aborde avec ce roman. D'ailleurs, lorsqu'on me demande de quoi
ça parle, je suis gauche, comme si je n'y avais pas réfléchi avant (c'est évidement
faux), comme si en fait le sujet m'intéressait peu (c'est toujours faux bien-sûr). Du
coup, oui, c'est une véritable angoisse : avoir écrit un livre " de passage "
vers un autre projet, un roman qu'on juge soi-même plus faible que les autres, une sorte
d'enfant chétif, advienne que pourra…
Et c'est cette impression d'un livre " de passage " que vient renforcer la
deuxième citation de J.C.O. Oui, écrire un roman est une aventure romantique. Alors que
je terminais ST, j'avais déjà les visions dont elle parle à propos de Y,
celui qui devrait suivre. J'en suis donc maintenant à l'étape suivante qui "
consiste à les représenter ", maintenant que ST est lâché à sa vie
pré-éditoriale. Le sujet de Y (mais je le sais depuis vingt ans) est pour moi
primordial, obligatoire. L'angoisse donc est à la mesure de l'enjeu, omniprésente,
intense, mais je préfère ici le synonyme d' " émoi ", sa racine latine movere,
à la fois s'émouvoir, mais aussi remuer, danser, bouger, se mettre en mouvement,
avancer.
(07/09/2018)
J'avais envie de découvrir J.D. Salinger. On en fait tout un cas, le
groupe Indochine lui a même consacré une chanson, des écrivains répètent à
l'envi que L'Attrape-cœur a été une lecture essentielle pour eux, bref,
j'avais l'impression de louper quelque chose. Une biographie parue il y a quelques mois (Salinger
intime, de Denis Demonpion) m'a donné l'occasion d'en apprendre plus, je suis donc
parti en Sicile avec le bouquin et ce qui a été traduit en France de Salinger,
c'est-à-dire peu de choses en version poche, L'Attrape-cœur et un recueil
de quelques nouvelles.
De Salinger, je ne connaissais que son aversion à être épié comme une bête curieuse :
éloigné des mondanités depuis la parution de son principal succès en 1951, d'aucuns
cherchaient à l'apercevoir dans sa retraite (connue) et à publier des scoops juteux.
Souvenir triste d'avoir aperçu un cliché du vieil écrivain, avec toujours le même
visage anguleux, frappant au carreau d'une vitre d'une voiture avec colère. Profond
irrespect donc pour ce type de plus de quatre-vingts ans. Ça me rappelle quelques
clichés volés du grand Beckett par François-Marie Banier. Et puisque je suis dans ces
façons qui m'importunent, dire aussi que la biographie de Salinger ne m'a pas convaincue,
trop tape à l'œil, trop désireuse de rameuter le public. Pourtant, son implication
est sincère et ses recherches sont précises. Il me semble que Denis Demonpion a éludé
le véritable itinéraire d'un homme au profit de cette incompréhension au sujet d'un
écrivain qui a recherché la discrétion dans la deuxième partie de sa vie. Eternel
débat : ça fait cent cinquante ans que ça dure pour Rimbaud, incompréhension devant
son choix de quitter la poésie. Les titres des chapitres pour Salinger exposent bien le
hiatus entre le biographe et son sujet. Par exemple, intituler " une vie au ralenti
" un chapitre consacré au quotidien du vieil écrivain est stérile : c'est
simplement la vision que l'auteur a de la vie de Salinger et non le reflet que l'auteur
possède de son existence, qu'il trouve peut-être, lui, trépidante. Dans une postface,
par ailleurs, le biographe règle ses comptes en détail avec le monde des lettres, ce qui
montre que Salinger l'intéresse moins que son petit projet personnel. A noter que
Beigbeder avec Oona et Salinger apparaît dans le vaste complot éditorial. Car
enfin, pour en revenir à Salinger, il faut savoir qu'il a eu une liaison avec la future
femme de Chaplin, Oona O'Neill, de la même manière que ce qui intéresse les biographes
de Rimbaud, c'est sa liaison sulfureuse avec Verlaine.
Bref, le coup est réussi : à vouloir parler de l'insaisissable Salinger, on évoque ceux
qui le narrent : on raconte l'itinéraire d'un homme caché par qui veut se faire voir.
Au final, l'histoire doit se conclure avec le principal protagoniste, l'écrivain Salinger
: héros de guerre, rencontre avec Hemingway, succès littéraire mais espoirs déçus,
s'apercevoir qu'on est l'auteur d'un seul livre qui compte et balaie tout sur son passage
est probablement l'expérience la plus terrible pour un auteur.
(31/08/2018)
Lorsque je suis revenu de mon périple, j'ai retrouvé un paquet sur ma
table : j'ai aussitôt deviné qu'il s'agissait de mes exemplaires d'auteur de Vie
prolongée d'Arthur Rimbaud, dont la parution au Livre de poche était prévue pour
le jour même. J'ai d'abord rangé mes affaires, mon vélo, je me suis octroyé une
demi-heure de repos comme il sied à celui qui vient de terminer 130 bornes et puis, avec
gourmandise, j'ai ouvert le paquet.
La couverture est très réussie : elle reprend le fameux portrait de Carjat, fondu dans
des couleurs où domine le bleu, à l'exemple de la couverture bariolée de l'édition
Fayard. Au dos, le résumé est une copie conforme à l'édition originale, agrémenté de
deux extraits de critiques journalistiques : "Thierry Beinstingel donne à cette
existence inventée une incroyable tangibilité. Palpitant de bout en bout."
(Jean-Claude Lebrun, L'Humanité) ; " Un Rimbaud-roman au style élégant et fluide,
qui joue avec l'obsession contemporaine de la vérité biographique." (Fabrice
Pliskin, L'Obs). Ça a l'air bien, en tout cas, ça donne envie de lire le bouquin,
j'aimerais bien connaître ce Thierry Beinstingel au style élégant et fluide…
Trêve de plaisanterie : la parution en livre de poche est toujours un grand moment, je
rejoins le rayon des morts, je vais m'aligner à côté de Balzac, de Beckett, pas loin de
Cendrars, de Duras. L'édition précise que j'ai déjà 4 titres au Livre de poche (Retour
aux mots sauvages, Ils désertent, Faux nègres, Journal de la canicule) avec
celui-ci, cela fait 5. L'avantage est d'abord le prix (8,20 euros pour VPAR), ce
qui rend le livre plus abordable notamment pour leur étude en lycée ou en collège (en
ce moment, Retour aux mots sauvages connaît un petit succès à l'éducation
nationale). Autre étonnement, VPAR en édition de poche compte 548 pages, plus
que dans la version d'origine qui en compte 415. Mais il faut dire que Fayard avait choisi
un grand format pour éviter d'effrayer le lecteur ! (j'avais calculé que pour une
édition habituelle, le bouquin aurait approché probablement 780 pages). A noter aussi
que dans la liste des œuvres parues, figure Instant handball avec l'ami
Delatour, ce qui porte à treize le nombre de mes parutions.
Justement, en parlant de publication, ma maison d'édition m'a gentiment contacté hier
pour le futur projet ST : quel plaisir d'entendre à nouveau parler de projet de
couverture, de quatrième, bref, tout ce qui s'annonce. Les affaires reprennent donc, sans
compter Y, nouveau nom de code, donc de futur bouquin (enfin j'espère).
Etrangement, je pensais à cela en me remémorant mon périple entre Marne et canal, Y
devrait être un " roman-fleuve ", dans tous les sens du terme. Mais il est
encore temps d'en parler même si l'impatience de m'y mettre est grande. En attendant, en
route vers la publication de ST et la sortie de VPAR en poche !
(24/08/2018)
Partir en Sicile chaque année est à la fois une conclusion de celle qui
vient de s'écouler et une renaissance du corps et de l'esprit pour celle à venir. J'ai
toujours considéré ce dépaysement comme vital, j'ai toujours pensé que chaque année
commençait à cette époque, comme pour les profs et les scolaires, et non en janvier.
D'ailleurs auparavant, j'achetais une recharge septembre / septembre pour mon organiseur.
Il me fallait une page par jour pour noter les pense-bêtes du boulot, les rendez-vous
personnels et les choses à ne pas oublier. Je l'ai réduit et délaissé, car même si
j'ai toujours un semainier en cours, force est de constater que la dernière mention qui y
figure est celle du marathon que j'ai effectué le 10 juin dernier. Bref, je n'en ai plus
l'utilité, l'agenda du portable (qui a le mérite de pouvoir se partager) le remplace
suffisamment. Ceci dit, cette désaffection me fait peur : j'ai la crainte que le temps,
privé de ses repères quotidiens, passe encore plus vite. Cette fuite du temps hélas est
probablement un phénomène qui va s'amplifier. Ma fille me faisait part de cette
sensation qu'elle perçoit de plus en plus et elle a tout juste trente ans ! (elle m'a
fait remarquer aussi à mon anniversaire que j'ai vécu maintenant autant d'années sans
elle qu'avec elle). En fait cette renaissance sicilienne est l'occasion d'échanges
familiaux, nous qui sommes séparés la plupart du temps. En dehors de ces temps en
commun, il y a aussi les heures passées dans les pensées individuelles : qui lit sur un
transat à l'ombre ; qui prépare ses cours (deux profs parmi nous) ; qui effectue des
recherches universitaires ; qui écrit…
Cette année, contrairement à 2017 où je me suis astreint en villégiature à la thèse
pendant quatre à six heures par jour, l'activité littéraire a été plus relâchée,
mais non moins riche. J'avais prévu de rédiger une nouvelle pour la belle revue Les
Amis de l'Ardenne, de corriger ST en vue de sa parution prévue en janvier
prochain. J'avais emporté des livres pour le futur projet d'écriture qui devrait être
conséquent et me tenir pendant deux ans. La nouvelle pour Les Amis de l'Ardenne
est rédigée et je n'ai pu m'empêcher d'essayer une ébauche de début pour le futur
bouquin (nom de code Y). En revanche, la tâche de correction de ST m'apparaît
plus ardue que je ne pensais : l'un des trois personnages principaux est un peu faible au
regard des deux autres, je m'en aperçois à la relecture, je dois l'affirmer, le
préciser davantage et cela va encore me prendre probablement une quinzaine de jours. J'ai
hâte aussi de le terminer parce qu'il me semble que Y est d'une autre dimension
et ce projet commence déjà à retenir toute mon attention et ma disponibilité d'esprit.
J'ai aussi beaucoup lu pendant ces vacances : découvert le magnifique Martin Eden
de Jack London (voir en Notes de lecture), mais aussi Les Misérables de Hugo
dans sa version initiale et complète ; j'ai lu une biographie de Salinger et les quelques
nouvelles de lui qui ont été traduites en français. L'expression de renaissance est
vraiment l'impression qui me reste de ces trois semaines de coupure sicilienne : des
jalons pour les mois (années ?) à venir sont posés.
(17/08/2018)
J'étais habillé dans ma tenue favorite, sandales, bermuda et T-shirt, j'allais
tranquillement à pied à la boulangerie sous un soleil radieux lorsque mon téléphone a
sonné : Celui qui m'a appelé est Sylvain Bourmeau, producteur de "La Suite dans les
idées" sur France Culture. De suite, m'est revenu le nom de ce journaliste des
Inrockuptibles, connu à l'époque de Central voici tout de même dix-huit ans,
et fondateur, il me semble, de Médiapart. Il me proposait d'intervenir trois jours plus
tard dans son émission consacrée aux émotions du travail avec la sociologue Aurélie
Jeantet. Programme alléchant tant l'angle irrationnel de nos émotions est rarement pris
en compte à propos de nos missions professionnelles.
J'ai donc eu grand plaisir à retrouver les couloirs courbes de la célèbre Maison de la
Radio à Paris, perpétuellement en travaux d'ailleurs. Les études d'Aurélie Jeantet me
sont proches à plus d'un titre. Elle a en effet consacré sa thèse au travail des
guichetiers de la poste, activité que j'ai exercée pendant six ans et se dévoue
maintenant à analyser l'apport des affects et des émotions dans le domaine
professionnel.
Depuis quelques années déjà, favorisées par de nouvelles générations mieux
disposées, l'expression de nos sentiments est devenue plus naturelle. L'actualité
(hélas triste) a permis depuis le tournant du Onze septembre ou la mort de la princesse
Diana, de ne plus les réserver à la sphère individuelle. Attentats, mais aussi
disparition de personnages célèbres, voire faits divers, l'actualité est en permanence
placée devant nos émotions. Les images tournent en boucle et présentent, ici des
cortèges de recueillement, là des hommages permanents à Mickael Jackson ou Johnny
Halliday. Le jour du bac, on présente la liesse des candidats, ou celle de la population
un soir de finale (voir en Webcam cette semaine). Tout cela est-il vraiment innocent et
spontané ?
Non bien sûr, l'émotion, les larmes, les rires sont universels et ainsi représentent
une force de vente non négligeable, apportent de nouvelles activités. Sans remettre en
cause l'apport de cellules psychologiques mises en place lors de drames, ou celles
d'organismes spécialisés dans les risques psycho sociaux, force est de constater qu'un
glissement a eu lieu : les émotions, jusque-là réservées à la sphère privée sont
devenues collectives. Autant auparavant, il paraissait indécent de s'épancher devant des
tiers, autant désormais, c'est l'inverse qui se produit : ne pas réagir collectivement
est devenu choquant, preuve d'un désintérêt pour autrui. Cependant j'insiste : la
manipulation de nos émotions, replacée dans la communauté, est un marché économique
inépuisable et juteux pour peu qu'on sache en tirer parti.
En effet, pour en revenir au domaine du travail, lors de cette émission à France
Culture, j'ai donné l'exemple du glissement qui s'est produit dans les entreprises entre
les concepts de qualité-client et d'expérience client. La qualité (d'un produit, d'un
service irréprochable) coûte très cher on le sait, alors que " vivre une
expérience " - c'est-à-dire ressentir une émotion positive et même négative
devant un produit mal fini, un service mal ficelé - est un acte gratuit qui ne coûte
rien. Pour preuve : regardez les publicités : voitures, portables, parfums, services,
toutes sont orientées vers l'émotion ressentie à la possession. Et elles sont
incontestables.
Ainsi, la survalorisation de nos émotions permet de modifier des enjeux financiers réels
: plus rien ne compte que l'affect de l'instant, on évacue toute analyse rationnelle,
cela coûte peu et rapporte beaucoup.
J'aurais aimé que ces aspects économiques soient beaucoup plus développés lors de
cette émission. Il reste à mon avis encore beaucoup à faire pour démonter les
mécanismes de cette manipulation organisée de nos émotions, qu'elles soient dans le
domaine du travail ou non.
L'émission est ré-écoutable ici.
(20/07/2018)
Nouvelle toute fraîche : j'ai rencontré hier mon éditrice de la grande
maison Fayard. J'évoquais dans la précédente note d'écriture l'envoi du fichier
correspondant à ST le 28 juin dernier. Cette rencontre a entériné le projet : ST
devrait effectivement paraître en janvier prochain. Même si l'affaire avait toujours
été engagée sur ces bases, il y avait toujours le risque que le texte complètement
achevé ne plaise pas. Or, ce n'est pas le cas, donc youpi.
Il me reste à peaufiner quelques relâchements du texte, un début un peu trop
tarabiscoté, des relations entre personnages à affirmer. Peu de choses au final,
quelques paragraphes à modifier, quelques phrases à ajouter pour lever des ambiguités.
J'aime ce travail du texte et j'aime aussi que l'éditeur joue ainsi pleinement son rôle.
Mes deux précédents éditeurs avaient à chaque fois refusé le deuxième manuscrit que
je leur avais présenté (à juste raison d'ailleurs), je n'ai jamais insisté, ni
adressé ailleurs ces projets. J'ai toujours pensé qu'en agissant ainsi, ils avaient en
quelques sorte gagnés leurs galons d'éditeur, capables d'encenser un texte, mais aussi
capables de stopper quelque chose qu'on ne sent pas. Pas de refus cette fois-ci pour le
premier vrai projet suivi en entier par mon éditrice dans un réel rôle de décideur, de
l'idée initiale à la conclusion. Ce qui n'exclut pas une lecture fine et des suggestions
judicieuses et c'est vraiment ce que j'attendais. Je suis parfois du genre à ne pas voir
l'arbre qui cache la forêt, à laisser une structure bancale s'installer et il est bon
que ces aléas obligatoires de la créativité me soient signifiés. J'ai toujours pensé
que l'écriture était un travail d'équipe, dont acte.
En même temps, notre rencontre a permis d'éclaircir ce qui se dessine par la suite,
d'imaginer quelques échéances futures. Beaucoup de choses se mettent en place, il est
trop tôt pour en parler mais déjà il convient d'organiser tout cela. Et relater ces
perspectives encore floues sur FdR un vendredi 13 me paraît la meilleure date.
Je ne suis pas superstitieux, mais je ne passe pas sous les échelles.
Au fait, le titre, s'il est accepté, sera long et portera comme initiales ISPQUJJDST :
avis aux amateurs de devinettes.
(vendredi 13/07/2018)
J'ai terminé ST. J'en avais déjà parlé dans cette même
rubrique le 12 juin dernier. Poser le dernier mot d'un livre, sentir que c'est fini est
une joie considérable. Presque un peu incroyable. On se demande si le récit entrepris
est vraiment achevé. Parfois c'est évident : Pour VPAR (Vie prolongée
d'Arthur Rimbaud) la prolongation de vie que j'avais imaginée de Rimbaud prend fin
à la seconde mort que je lui invente. Pour ST, c'est différent. Tout d'abord il
a fallu que je renoue avec les réflexes de la fiction. L'écriture argumentative de ma
thèse pendant un an avait entamé plus que je ne le pensais ma capacité de création
romanesque. Pendant toute l'écriture de ce nouveau récit, j'ai souvent eu l'impression
que j'en faisais trop, ou pas assez. Et puis, même avant la thèse, les derniers romans
avaient été différents : en 2016, VPAR était marqué à la culotte par la
véritable histoire de Rimbaud, au jour le jour ou presque. En 2015, j'avais repris Journal
de la canicule à partir d'un texte conçu en 2009. Il faut peut-être remonter à
2013-2014 au moment de l'écriture de Faux nègres pour retrouver ces moments de
doute, tous relatifs d'ailleurs. La triple histoire que j'ai conçue pour ST est
par ailleurs assez déstabilisante. Je n'ai cessé de me demander si je faisais le bon
choix de disperser ainsi mes protagonistes.
C'est pourquoi au moment de la dernière phrase, il m'a paru essentiel de tout reprendre,
de donner du liant, de la cohérence au récit, cohérence qui existait bien sûr, mais
bon, je voulais me rassurer. C'est chose faite.
J'ai noté en bas de mon tapuscrit cette petite mention " Dimanche 12 novembre 2017,
vendredi 08 juin 2018, fin des corrections le 28 juin 2018 ". J'aurai donc mis sept
mois et seize jours avant d'envoyer le jour même de la fin de mes corrections le
manuscrit/tapuscrit à mon éditrice. D'ailleurs comment nommer le fichier numérique que
l'on remet par messagerie ? Manuscrit est impropre : rien n'est manuel chez moi, je
n'écris jamais au stylo. Tapuscrit ? Mais cela suppose que j'imprime au préalable sur
papier un document, or je n'en fais rien non plus. Je n'imprime jamais rien. Lorsque j'ai
envie de relire certains passages d'une manière confortable, je transforme mon fichier en
version pdf, plus facile à récupérer sur ma tablette. En fait, la véritable fin d'un
livre pour moi revient au moment où j'essaie d'imaginer l'apparence qu'il aura en tant
qu'objet livre. Par exemple, je suppose que ce nouveau roman devrait approcher (atteindre
? dépasser ?) 300 pages. Toutefois rien n'est fait et ce projet, bien qu'il ait été
régulièrement suivi par ma maison d'édition, n'est pas encore officialisé. Pour rester
dans l'air du temps, je me sens un peu comme un footballeur qui vient de déposer son
ballon au point de pénalty : le plus important est à venir.
(03/07/2018)
J'ai été invité la semaine dernière à donner une conférence à
Meilly-sur-Rouvres. Doctement intitulée " Le travail contemporain en héritage du
naturalisme : vers de nouvelles utopies ? ", elle s'inscrivait dans le cadre d'un
atelier de lecture consacré à Zola et aux naturalistes et qui se réunit régulièrement
dans cette petite bourgade à une demi-heure de Dijon. Pourquoi dans ce village qui compte
moins de cent habitants ? Parce que Jeanne Rozerot y est née en 1867, y est enterrée
depuis 1914, enfin plutôt à Rouvres-sur-Meilly, car cette commune a également la
particularité d'être double : Meilly-sur-Rouvres et Rouvres-sur-Meilly jouissent de deux
mairies installées dans le même bâtiment et d'une seule église avec cimetière
attenant, size quant à elle à Rouvres-sur-Meilly. Cette légitimité fluctuante n'est
ainsi pas sans rappeler celle de la jeune Jeanne Rozerot qui fût la maitresse d'Émile
Zola, mais également l'unique mère de la descendance de l'écrivain, deux enfants
prénommés Denise et Jacques. Alexandrine, l'épouse du romancier, on s'en doute vivait
mal cette double vie, mais a fait en sorte que les deux enfants soient reconnus.
Ainsi l'année précédente, à l'occasion des 150 ans de la naissance de Jeanne Rozerot,
quelques admirateurs zoliens ont inauguré cet atelier de lecture des écrivains naturalistes auquel j'ai
participé. L'universitaire Jean-Sebastien Macke, qui m'avait invité avec Aurélie
Barjonet deux ans auparavant au prestigieux colloque de Cerisy sur "Lire Zola au XXIe
siècle" (note d'écriture du 04/07/2016)
est déjà intervenu. A noter que Henri Mitterand, le grand spécialiste de Zola y
interviendra le 13 juillet prochain. Il faut saluer ce genre d'initiative, peu fréquent
dans nos campagnes.
(26/06/2018)
Je m'internationalise en ce moment. Pas cependant à travers une
quelconque traduction de mes romans en quechua, en lapon ou autre destination singulière.
C'est d'ailleurs un de mes grands regrets : je n'ai jamais été traduit même pas en
anglais banal, en allemand voisin, en espagnol répandu ou en italien chantant. C'est
d'ailleurs en italien qu'il me conviendrait le plus d'être traduit en premier : je compte
quelques lecteurs. J'ai même eu une nouvelle publiée en 2010 dans le premier numéro de
la revue Atti Impuri, traduite par Claudio Panella. Pour la petite histoire,
cette nouvelle est devenue le premier chapitre de Retour aux mots sauvages.
Je ne sais plus comment nous avions fait connaissance, probablement travaillait-il déjà
à sa thèse sur l'écriture et le travail, soutenue il y a déjà quelques années à
Turin. Par la suite j'ai rencontré Claudio en 2011, où nous avions tous deux participé
à un colloque à Porto intitulé La
littérature et le monde du travail. En fait, mon rapport aux lettres
internationales est surtout lié à ce domaine de prédilection et à ses prolongements
académiques. Être à la fois étudiant et objet d'étude d'un thème pareil m'a garanti
quelques invitations où, par moment, je ne savais plus qui, de l'étudiant ou de l'objet
d'étude, était invité. Souvent même, je participais au titre de mes recherches, sans
bien-sûr citer mes livres, pour m'apercevoir qu'un(e) participant(e) les commentait
abondamment dans une intervention ultérieure. Bref, j'ai parfois frôlé la
schizophrénie.
Pour en revenir à l'international, à part le Portugal, je suis intervenu en Suisse en
2015, à Londres en 2016. C'est d'ailleurs à la suite de cette journée d'étude qu'on
m'a demandé une publication pour la revue en ligne Modern & contemporary France.
Celle-ci est en ligne depuis un ou deux mois, d'où cette rubrique. Avis aux
amateurs : l'article entier, disponible pendant 24 heures est accessible pour la modique
somme de 36 euros si vous n'êtes pas déjà référencé chez Taylor & Francis
Online.
Plus exotique est aussi la publication qui me concerne : Le monde de l'entreprise dans
l'œuvre de Thierry Beinstingel, publiée au Presses Académiques Francophones, par Mme Hajar Sayed
Abdelnasser. Il faut débourser 67,90 euros pour obtenir ce livre. C'est cher ? De même
que la publication anglaise ? On en reparlera lorsque j'aurais obtenu de Nobel de
Littérature dans quelques années… Plus sérieusement, cet ouvrage est le
prolongement d'un magistère soutenu par une enseignante égyptienne à l'université Ain
Shams, au Caire. J'en suis très fier d'autant plus que j'éprouve un attachement
manifeste pour ce pays, ainsi que pour tous ceux du Moyen-Orient que j'ai visités lorsque
c'était encore possible. La littérature assume ainsi pleinement son rôle : nous
rassembler avec bienveillance au-delà des troubles de l'histoire.
(20/06/2018)
ST : nom du fichier sous lequel j'enregistre les versions
successives du roman en cours. Et justement, je suis en train de terminer ST
précisément. J'ai fini ce qu'on pourrait appeler le premier jet et qui n'est que le
moment où l'on achève le dernier chapitre : c'était vendredi dernier. Fin provisoire,
il reste des corrections à faire, mais on se sent finisher tout de même, et, à deux
jours du Marathon que je relate en rubrique Étonnements, il m'a semblé important que
l'écriture puisse s'achever avant, il y a tout même un ordre des priorités dans ma vie
et celle de mes passions.
J'ai donc aligné ce vendredi une somme importante de phrases pour m'acheminer vers la
ligne d'arrivée ; j'ai ainsi dû rédiger pas loin de vingt pages (l'équivalent de 20 km
?). Lorsque je reprends ce fichier le lendemain du marathon, à la relecture, il me semble
que la fin de ST tient la route et je décide de laisser tel quel ce premier jet.
La tête encore dans les nuages de ma course à pied, je me sens ainsi double finisher.
D'un côté, cinq heures et vingt-neuf minutes pour la course à pied, de l'autre
exactement six mois et vingt-sept jours pour l'écriture. Reste à vivre le plus
intéressant : se plonger dans le futur livre pour tout relire, corriger et harmoniser.
(12/06/2018)
Le printemps, somme toute très ensoleillé, les activités du dehors qui
se multiplient, m'ont souvent éloigné de la table d'écriture. Même si, à la
réflexion, rares sont les jours où je ne me suis pas assis devant l'ordinateur, symbole
des projets qui avancent.
Tout d'abord, savoir que la littérature est tout sauf une entreprise solitaire, et, par
exemple, j'ai eu dernièrement grand plaisir à retrouver pour la troisième année
consécutive les membres du jury " Écrire le travail ". Sortir des lignes que
l'on écrit dans l'isolement fait un bien fou (la semaine prochaine, j'interviens dans un
lycée de ma ville qui propose Retour aux mots sauvages (2010) au bac), de même
que partager ses préoccupations avec d'autres auteurs : ce que je nomme " parler
popotte ", regarder la cuisine de l'écriture. J'ai toujours eu à cœur de
privilégier quelques rencontres et quelques échanges avec les écrivain(e)s qui me sont
proches.
Mais cela ne dispense pas de faire un point avec soi-même sur les affaires littéraires.
Coté paperasse, IRCEC, AGESSA, SACD et autres vous rappellent que les droits d'auteurs
s'expriment en monnaie sonnante et trébuchante et vous incitent à diverses cotisations
dont vous ne verrez jamais le bénéfice. Côté éditeur, Fayard me tient régulièrement
au courant des comptes. Je constate à leur dernier relevé de droits d'auteurs que Journal
de la canicule (2015) s'est vendu assez faiblement, même s'il bénéficie maintenant
d'une sortie en poche. En revanche, Vie prolongée d'Arthur Rimbaud (2016)
également prévu en poche pour août prochain a eu un volume de ventes quasi comparable
à Ils désertent (2012), lequel avait dû sa notoriété à sa nomination au
Goncourt. Je me rapproche d'André Dhôtel qui s'étonnait dans une interview de ses
cinq à sept mille lecteurs fidèles. En parlant d'Ils désertent, grande joie
encore pour moi d'avoir vu se renouveler un contrat d'adaptation pour un long métrage.
Tout cela est à suivre.
Côté créativité, le futur bouquin au nom de code ST s'achemine vers sa fin.
Sans heurt mais sans passion exagérée, ce devrait être un format court, du moins plus
court que VPAR ou Faux nègres, de la taille de ID ou RMS.
Je pense l'envoyer en juillet à mon éditrice, comme déjà convenu. D'autres projets me
tiennent à cœur, notamment un roman familial dans lequel il faudra bien que je me
lance. D'autres encore : une histoire de travail et un récit de sport, mais tout cela est
encore flou. C'est probablement pour ces raisons qu'il me semble que ST sera un roman, non
pas de moindre importance, mais un roman " de passage " vers d'autres
inspirations nouvelles.
J'avais aussi imaginé publier ma thèse, d'abord dans son intégralité, à usage des
universitaires, puis peut-être sous forme d'essai, plus tard. Ceci dit, j'ai rapidement
autorisé la diffusion sur le web de ma thèse (voir par exemple ici),
tant il me semble que la (relative) gratuité de l'éducation doit bénéficier au plus
grand nombre. Et puis je ne suis pas du genre à restreindre les recherches que j'ai
menées, le pouvoir que certains croient détenir en donnant des informations au
compte-gouttes n'est pas dans ma nature. Je vais donc probablement abandonner la
publication universitaire, à moins que les sollicitations déjà reçues de presses
académiques se fassent insistantes. Reste cependant en mémoire un ouvrage à commettre
sur l'état du travail dans la littérature contemporaine, donc, le versant " essai
" demeure dans mon esprit.
De nombreux projets vont donc s'effilocher au fil du temps. Il y a aussi des échéances
à venir, parfois rapides (une conférence en Bourgogne dans 15 jours sur le naturalisme,
le travail et l'utopie : rien encore commencé !), une nouvelle pour le numéro d'hiver de
la revue Les Amis de l'Ardenne. Et dire que certains me croient en retraite…
(01/06/2018)
Imaginez : vous êtes là, comme d'habitude, jetant un œil distrait
sur votre Smartphone lorsqu'un message de Philippe Rahmy s'affiche sur l'écran.
Évidemment vous ne lisez que le nom de l'envoyeur " Philippe Rahmy ", et
reviennent instantanément à votre mémoire les messages que vous avez reçus de lui,
toujours généreux, gais, poétiques. Revient aussi ce pincement au cœur : Philippe
est décédé six mois auparavant. Évidemment, le cœur bat plus vite en ouvrant le
message : Philippe vous a envoyé une invitation… Une invitation à le rejoindre ?
Déjà ? Vous comprenez alors que la plate-forme du réseau social professionnel au nom
imprononçable (linne'keudin'?) est à l'origine de ce message. Sauf que ce réseau vous
fait croire que votre ami vous envoie en personne cette invitation à rejoindre son
réseau. Et persiste : je reçois dans les quinze jours qui suivent deux autres messages
qui me relancent : Philippe aimerait vous rajouter à son réseau, l'invitation de
Philippe Rahmy attend une réponse de votre part… Et à chaque fois le même
pincement dans la poitrine.
On peut ne pas prendre garde, ne pas faire attention, même considérer ce harcèlement
comme logique, voire une manière de se souvenir de ceux qui ont disparu. Mais
décidément, je n'aime pas ces manières de prendre parole à la place de qui s'est tu
définitivement. Je n'ai jamais eu beaucoup de considération pour l'immense gloubi boulga
des réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu besoin de me désintoxiquer d'un quelconque
Facebook, ni de piquer une crise de nerfs devant les informations librement consenties que
je laisse sur la toile.
Le monde numérique est confronté sans cesse à la disparition d'amis, de ceux qui
œuvraient sur la toile. Philippe
bien sûr, mais aussi Ronald
Klapka ou Maryse Hache. Les
véritables sites ou blogs Internet dans lesquels ils s'adressaient directement à nous ne
sont pas des impostures. Ils demeurent sur la toile, arrêtés à la date de leur passage
dans le troisième monde, l'au-delà des mondes concrets et virtuels.
(25/05/2018)
Notes d'écriture d'André Dhôtel, tirées de La littérature et le
hasard :
" Littérature : déclaration de sauvagerie - écrire dans un genre tel qu'il ne
permette pas au lecteur de pénétrer l'auteur, ou de telle façon que l'auteur n'y livre
jamais rien de lui. "
" Je retrouve cette sauvagerie jusque dans la sécurité placide des petites villes,
des vies régulières, humbles, même édifiantes. Je retrouve une pire sauvagerie dans
l'honnêteté, la morale - aussi bien que dans la bravoure que dans la lâcheté - dans la
courtoisie - dans la sottise, l'intelligence. "
" J'appartiens à la sauvagerie bourgeoise d'une petite ville. "
" Pour vivre j'ai un emploi stable, mal rétribué, qui me laisse peu de loisirs. Je
fais des écritures. Je suis paresseux et je pratique la paresse avec une attention
studieuse. L'important n'est pas de dormir, mais de savoir que l'on dort. "
" La dernière maison d'une cité ouvrière. L'homme est rentré vers six heures et,
sur le seuil, il feuillette maintenant un roman, tandis que le soir tombe mais il ne lit
pas.
- C'est à toi ce bouquin-là ? demande-t-il à sa femme.
- On me l'a prété.
Il jette le livre sur le banc jusqu'où retombent des fleurs grimpantes.
Il hausse les épaules.
- Demain, j'arracherai ces pommes de terre. "
" Ce ne sont pas des êtres exemplaires, mais simplement quelques-uns parmi eux qui
souvent m'apparaissent je ne sais pourquoi. "
" Nous aimerions que chaque livre veuille donner à tous les hommes le droit à
l'enthousiasme, à la paix du cœur. "
" Il m'a semblé que c'était au lecteur de faire le premier pas pour améliorer
cette situation. "
" La chose qui nous manque le plus c'est le temps. Je cherche une machine à
fabriquer du temps (c'est la littérature sans but). "
" Pas de règles dans la littérature (surtout le roman). Le lecteur est comme
emporté par un courant, ou par une direction - l'auteur aussi. Et je ne croix pas qu'il y
ait (au contraire) aucune finesse dans la littérature. Les matériaux doivent être
extrêmement grossiers (mettons que je n'ai rien dit). "
" Littérature : demandes dont la réponse évidente n'est pas dans notre vie sans
doute, mais qui prouve qu'elle est possible, peut-être ailleurs, à un moment donné, qui
sait où et quand ? "
(11/05/2018)
Le Prix d'un Goncourt proposé en note de lecture cette semaine évoque le destin
du roman de Jean Carrière L'Épervier de Maheux en 1972. Ce récit qui se situe
dans les Cévennes raconte le destin des habitants d'un petit hameau voué à disparition,
leurs dures conditions de vie et la malédiction qui les entoure. Ce roman n'est pas sans
rappeler par son sujet dépressif le récent Règne animal de Jean-Baptiste Del
Amo, sauf que la visée de ce dernier auteur se relie à la souffrance animale dans les
fermes, thème à la mode, tandis que l'idée de Jean Carrière était de rendre hommage
au peuple besogneux qu'il connaît bien. Qu'on se soucie maintenant outre mesure de la
condition des animaux par rapport aux hommes dans la ruralité montre bien le cynisme de
certains et le chemin pris par notre pays dans un aménagement du territoire devenu
inexistant et dans la négation d'une campagne qui n'intéresse plus grand monde.
Or, à l'époque de L'Épervier de Maheux, se souvient-on qu'un mouvement inverse
avait eu lieu en France ? Ce retour à la terre était dans la lignée de mai 68, idées
généreuses en réaction aux grands ensembles qu'on avait fait fleurir dans les
banlieues. Dans cette fin des Trente Glorieuses où le plein emploi avait encore cours,
chacun aspirait à une vie plus saine, on fuyait les villes, direction les villages. On
retapait des fermes, on s'essayait à des vies communautaires. Au cinéma, on prônait
l'amour libre (Les Valseuses, 1974 ; D'Amour et d'eau fraîche, 1976),
les films de David Hamilton érotisaient des jeunes filles en fleurs.
Pour moi, (" En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans
et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance " comme disait Blaise Cendrars dans La
Prose du Transsibérien), ce retour à la terre se manifestait dans mes éternelles
campagnes par des fêtes incessantes, on écoutait Smoke on the water et les
Stones à fond dans des granges de villages, on fréquentait des bals montés, on partait
guitare au dos pour des feux de camp, on se moquait des chevelus tout en barbe et en
sabots, on portait des chemises de grands-pères, des peaux de moutons. C'était l'époque
des premières brocantes, on se prenait de passion pour la moindre roue de charrette, le
plus petit pot au lait.
En littérature, c'est à cette époque que Jean Robinet, que je ne connaissais pas
encore, a fondé l'association des écrivains-paysans. Le retour à la terre s'est
manifesté par un goût accru du public pour les contes et légendes du terroir ou les
chroniques villageoises, comme Le Cheval d'orgueil de Pierre-Jakez Hélias paru
en 1975. Les livres de Claude Michelet évoluent dans cette même vogue : J'ai choisi
la terre ou la saga commencée en 1979 Des grives aux loups.
Ces exemples, qui ont rencontré un grand succès public, cachent malheureusement les
œuvres d'authentiques paysans plus discrets, comme Jean Robinet. Conséquence directe
de cet engouement, " l'École de Brive ", avec sa Foire du livre fondée en 1973
marque la récupération par l'intelligentsia des lettres et ainsi l'inévitable déclin
qui sied à toute mode sucée à l'extrême.
De nos jours, le monde rural est cantonné au folklore, à d'insipides niaiseries comme
" L'amour est dans le pré ". Petite réussite toutefois dans le cinéma, alors
que la daube Normandie-nue continue à déverser les clichés habituels sur
l'agriculture, Petit Paysan, long métrage magnifique salué par plusieurs
Césars dresse un état des lieux réaliste de l'élevage. Hubert Charuel, le
réalisateur, connaît bien ce milieu qu'il a filmé dans la ferme de ses parents, à 20km
de chez moi : " Je remercie l'Académie d'avoir récompensé un film de ploucs sur
les ploucs, fait par un gros plouc " a-t-il déclaré.
Et côté littérature, un nouveau retour à la terre se profile-t-il ? Hélas non,
toujours pas de livre de ploucs à venir…
(27/04/2018)
C'est une photo que je connais depuis longtemps. On y voit André Dhôtel
prenant la pose dans le capharnaüm d'une chambre (d'une chambre Dhôtel dans tous les
sens du terme). En fait, il s'agit de son appartement parisien, qui se situait rue des
Entrepreneurs dans le 15ème, pas très loin de la tour Eiffel, presque en face de la
Maison de la Radio et surtout, à peine à un kilomètre de la fameuse impasse Florimont
chère à Georges Brassens. On sent que l'espace est compté : dans l'angle de vue, un
lit, une table, deux fauteuils, deux chaises, l'ensemble encombré de bagages, comme si
l'espace n'était pas suffisant pour y déposer tout ce qu'on possède. Ce que possédait
le couple Dhôtel ? Un cabas de toile déposé à son pied gauche, une sacoche de voyageur
en cuir à son pied droit, une valise de carton posée sur le lit, plus grande que celle
qu'il transportait sur sa moto Terrot dans les années cinquante. Mais on est en 1987,
André Dhôtel avait l'âge actuel de mon père, il reste à l'écrivain trois ans à
vivre, à Suzanne, deux ans. Le photographe Gérard Rondeau qui a pris ce cliché a lui
disparu en 2016 (Un numéro de la revue Les Amis de l'Ardenne lui est consacré,
voir en Notes de lecture). D'après le photographe, tout semblait prêt pour le grand
départ de l'écrivain et de sa femme. Dans un coin, le souvenir de la Terrot attendait
qu'on les hisse jusqu'au ciel. Dans un coin surtout, le bureau encombré de papier et on
devine, sous son écrin usé, une machine à écrire.
(20/04/2018)
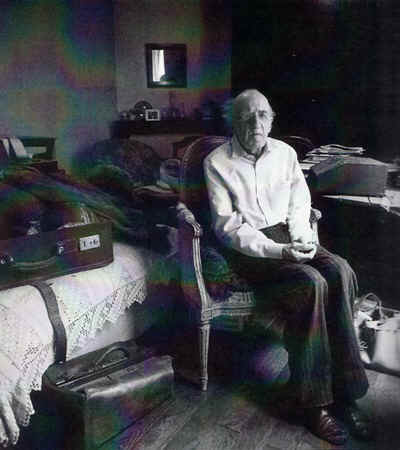
Je dois à mon père mon exemplaire de La Guerre et la Paix de
Tolstoï (et non pas ce raccourci de titre simplifié des deux articles). C'est une
édition de La Pléiade, d'ailleurs le seul exemplaire de la prestigieuse collection
jamais possédé mon père. Ce volume a été achevé d'imprimer le " trois juillet
mil neuf cent soixante-quatre ". Je ne sais plus quand nous lui avions offert,
probablement vers mes neuf ou dix ans, nous habitions alors au centre de Langres, un
appartement qui posséda longtemps un seul point d'eau sur l'évier et les toilettes au
fond d'une cour, communes à trois familles. C'est dire combien notre vie était modeste
et combien ce roman en édition de luxe a été un cadeau important. Je ne sais plus à
quelle occasion, anniversaire ou autre, je me souviens seulement de la gravité du moment,
bien entendu magnifié depuis dans mon imaginaire d'écrivain. Il me reste des sensations
: voir mon père ouvrant " son " livre, geste qui me paraissait miraculeux,
fantastique, extraordinaire. Le français n'est pas la langue natale de mon père, le
serbo-croate a bercé ses dix premières années avant que la seconde guerre mondiale
chasse ces slaves du Sud en un interminable exode. Mon père a complété ses relations
aux autres en hongrois, en tchèque, en allemand (je crois même qu'il possède un brevet
en cette langue), partout où l'existence sommaire imposait une communication rudimentaire
: manger, dormir, travailler. Proche de Berlin en 1945, sa connaissance des langues slaves
a déterminé sa survie auprès des russes, bref, une vie de légende dirait-on
aujourd'hui, mais une vie banale à l'époque pour des millions d'humains pris dans cette
tourmente. Le français a été la langue de la paix, celle du bout de l'exil, là où on
peut poser le peu de valises qui restent, là où on se fait oublier : travail dans les
fermes, ramassage du lait, travail en fromagerie, puis on a besoin de camionneurs. Il sera
chauffeur-routier jusqu'à sa retraite. Le français donc, appris sur le tas, dans des
accents francs-comtois, bourguignons, manière de rouler les " r ". Un jour, je
l'accompagnais dans son camion (grande joie de gosse !), nous avions déjeuné dans un
restaurant routier, il avait dû montrer ses papiers pour payer, je ne sais plus, toujours
est-il que la serveuse en encaissant le repas, l'avait félicité pour la qualité de son
français : revoir son sourire et sa joie. La Guerre et la Paix de Tolstoï a
entériné ce succès et a fait le lien avec son passé : pouvoir lire dans sa nouvelle
langue le fameux roman slave, peut-on rêver meilleur symbole ?
Mon père connaît mon attachement à cette anecdote familiale, grande joie lorsqu'il m'a
offert son luxueux exemplaire. Je l'ai en ce moment sur mon bureau. En le feuilletant il y
a peu, j'ai trouvé précisément à la page 1250, trois trèfles à quatre feuilles. Je
n'ai jamais trouvé de trèfles à quatre feuilles : aussi, qu'on puisse en placer trois
dans un livre qui représente tant à mes yeux est un signe évident, non pas du destin,
mais de la vie plus prosaïquement. Aucune leçon à recevoir ou à donner, juste savoir
où se situe pour chacun de nous le (porte) bonheur : moi j'ai la chance de l'avoir
trouvé au fond d'un livre.
(vendredi 13/04/2018)
Écrire pourquoi ? Tandis que je relatais la semaine dernière cette
question qui m'avait été posée ainsi qu'à un collectif d'écrivains, c'est plutôt
l'inverse cette semaine : " écrire pourquoi ne pas " tant je constate
l'évitement à continuer le livre en cours. Pourtant tout fonctionne bien : le livre au
nom de code ST a reçu l'assentiment de mon éditrice et c'est le principal. Je prévois
qu'il sera terminé au début de l'été. J'ai dépassé 200 pages en format roman et
l'histoire s'achemine dans son dernier tiers probablement. Mais depuis une quinzaine de
jours, force est de constater que je n'avance pas beaucoup. Pour ma défense (ou plutôt
celle du livre), la semaine dernière a été chargée, Paris, Tiers, Clermont, et
jusqu'à neuf personnes chez nous pour le week-end pascal.
Il a toutefois d'autres explications à ce ralentissement. L'idée d'abord que ce livre
n'est pas essentiel pour moi, ou du moins, n'est pas (ne sera pas) remarquable dans mon
parcours. C'est une sorte de livre " de passage ", un livre " en attendant
". En effet, il m'importait tout d'abord de me remettre en selle rapidement dans
l'écriture d'invention, romanesque, après l'année 2017 consacrée entièrement à
l'écriture pointilleuse et argumentée de ma thèse. La question de savoir si les
réflexes qui président au roman reviennent, n'était pas si évidente que cela : au
moins je suis rassuré, c'est déjà cela. L'histoire de ST, en revanche, ne m'apparaît
pas essentielle. Rien de déconnant par ailleurs, je laboure les terres que je connais,
les thèmes qui me sont chers, c'est du Beinstingel, on n'est pas dépaysé.
Mais justement, est-ce vraiment très neuf ? Ou peut-être ai-je justement envie
d'emprunter d'autres voies ou de revenir à d'anciennes ? Deux livres me trottent dans la
tête. L'un, qui doit s'écrire à la culotte des choses, pourrait me faire revenir de
plain-pied dans le monde du travail, délaissé depuis "Ils désertent ".
L'autre est un projet qui me tient beaucoup à cœur, mais c'est aussi le genre
d'histoire qui marque un écrivain, le genre de chose que l'on repousse, à se demander si
tout ce qu'on a écrit précédemment ne va pas se cristalliser dedans, bref, cette
fois-ci un livre essentiel à mes yeux. Je l'ai longtemps repoussé, ce n'était pas
encore le moment, mais l'échéance approche et j'ai moins peur de m'y atteler. Voilà :
écrire, pourquoi ne pas…commencer, continuer…etc., petits atermoiements
momentanés me semblent liés à une période un peu charnière.
Par ailleurs, charnière aussi me semble ma situation dans le monde : après cette année
de retrait, revient la grande envie de participer à nouveau, d'autant plus que le monde
change, politiquement et socialement pour du moins bien, je sais que je ne pourrais pas
taire longtemps les énervements qui me font réagir (d'où Contre-feux de Pierre
Bourdieu en note de lecture cette semaine, baume au cœur).
Quant à ST, nulle inquiétude, il avance de son train de sénateur, et sait-on jamais, le
succès d'un livre est toujours une histoire de malentendu.
(06/04/2018)
La question de la semaine dernière, développée dans cette même
rubrique (" Mais quand écrivez-vous ? ") m'a fait me souvenir de ma
participation à l'ouvrage collectif fondateur des éditions Argol, Écrire, pourquoi
? Nouvelle question fréquente, donc, liée à l'écriture. Je sais gré à Catherine
Flohic de me l'avoir posée, même, si, à la réflexion, j'ai biaisé ma réponse en
écrivant quelques paragraphes un peu intellos (mon texte s'intitulait Barthes et moi). Je
terminais mon texte par une formule un peu (beaucoup) facile : " Entre le mot et la
mort, juste un " r " de différence, celui qu'il me faut pour respirer "
(seule citation en ce qui me concerne qui figure dans ce
dictionnaire).
A la réflexion, en lisant les réponses des quarante auteurs qui avaient participé à
l'exercice treize ans auparavant (l'ouvrage date de février 2005), bien peu échappent à
la formule, au procédé, à la recette. Les textes proposés oscillent entre une réponse
convenue et une originalité obligatoire, histoire de se démarquer des autres
participants : il faut s'inventer une posture. Écrire, pourquoi ? place
d'emblée l'auteur dans ce trip : contraint, il se voit en train d'écrire, fait cet
exercice acrobatique de se démancher le cou pour se regarder composer d'en haut. On se
regarde : d'abord l'environnement, les livres, la bibliothèque, le chat qui ronronne, la
tasse de café, Beethoven en sourdine (ou mieux, Gustav Holst ou Franscesco Geminiani, ça
montre l'étendue de votre culture musicale). Si l'on préfère l'aventure d'une table de
bistro, d'un expresso et de voisins parfois bruyants, le résultat reste le même : on se
voit d'en haut ou de côté l'assise des fesses calée sur une chaise de paille ou un
fauteuil de cuir, avec une main qui écrit ou qui tape, l'autre qui tient la tête lourde
de phrases à pondre et les yeux mis clos pour y parvenir. Bref, il s'agit de "
prendre posture ".
Ce n'est pas honteux (voir cette même semaine en rubrique Étonnement). Le pendant de la
posture est l'imposture. Curieusement la prononciation des deux termes est si proche, il
en est peut-être de même de la facilité avec laquelle nous passons de l'état
d'imposture à la légitimité, de l'ignorance à la connaissance, de la reconnaissance à
l'indifférence, de nos contradictions à nos acceptations. Je me souviens de la
réception qui avait suivi la publication et ainsi l'inauguration des éditions Argol. J'y
avais assisté avec mon épouse. J'en avais fait une note d'écriture dans Feuilles de route le 20/04/2005. Je
garde de ce moment plutôt l'hébétude dans laquelle je me trouvais alors, au paroxysme
d'une crise personnelle qui entraînait tout sur son passage. Peut-être d'ailleurs
n'ai-je souhaité me souvenir de cette publication collective que pour me replonger dans
l'esprit qui était le mien à cette époque ? En ce cas, la question n'est pas "
écrire, pourquoi ? " mais " vivre, pourquoi ? ". Longtemps d'ailleurs que
j'y ai répondu dans l'enchainement d'une logique qui me tient lieu de pensée (j'allais
dire de " feuille de route ") : vivre pour être heureux et le bonheur pour
écrire.
Quant à la question " écrire, pourquoi ? ", la seule réponse possible en ce
moment me semble être : écrire, pourquoi pas. Si tant est que cette activité est
symboliquement la plus libre, la plus libertaire, la plus diffuse. Il suffit d'une
poignée de mots, d'un poignet pour la plume ou le clavier. Ne s'ensuit rien, aucune
obligation, ni dans la productivité attendue, ni dans le désir que ces mots soit lus. La
décorrélation entre lecture et écriture, entre le lecteur et le scribe est le maximum
de la liberté qu'on puisse espérer. A ce titre, la peinture par exemple est différente
: le spectateur ne peut ignorer le choc d'emblée du tableau entrevu. Idem pour la musique
qui ne se transmet qu'à travers un tempo et une succession de notes dans un temps
déterminé. En revanche, le lecteur, même en possession du livre, choisit si cet art
doit demeurer obscur pour lui. Il choisit le moment, le temps de sa lecture ou de son
renoncement, le séquencement et sa durée. Il passera quelques minutes à feuilleter le
livre, deux heures pour le lire en continu. Il peut aussi le relire sur plusieurs années.
En ce sens, l'écrivain, je l'ai souvent pensé, fabrique littéralement du temps le plus
libre possible, et c'est forcément un merveilleux métier.
(30/03/2018)
Mais quand écrivez-vous ? C'est la question rituelle, souvent posée lors
de rencontres en lycée, d'entrevues collectives, de rendez-vous en tête à tête, bref,
chaque fois qu'un interlocuteur prend en considération le drôle de type en face de lui.
Cette question, pourtant habituelle, me désarçonne toujours. Je dois répondre quelque
chose du genre " Je n'ai pas de moment particulier ", préciser " J'essaie
d'écrire le plus régulièrement possible ". Je ne sais pas quantifier le temps
d'écriture et c'est probablement ce qui m'étonne le plus, moi qui suit plutôt du genre
à calculer tout et n'importe quoi, à projeter des statistiques.
Je suis plutôt organisé ou, du moins, je note pas mal de choses : dans la prochaine
quinzaine, je sais qu'il y aura deux visites chez le garagiste, un rendez-vous médical,
une virée à Paris, une autre à Clermont Ferrand en passant par Langres. J'aurai de la
plomberie à faire et du jardinage. J'ai des contacts à prendre, des mails à répondre.
Aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours savoir où j'en suis, je sais toujours ce qu'il
y a dans le frigo, je connais les lessives à faire : la vie domestique (matérielle
aurait dit Marguerite Duras) est jalonnée en permanence. Par exemple, je suis capable de
dire à 100 m près combien j'ai couru la semaine dernière (20,8 km en deux fois).
Pourtant, si j'essaie de la même façon de me rappeler combien d'heures et de temps j'ai
passé à l'écriture pendant les sept derniers jours c'est presque impossible. Je connais
en revanche le résultat : j'ai mis à jour mes Feuilles de route lundi 12, j'ai
rédigé probablement l'équivalent d'une petite dizaine de pages du livre à venir. Si je
creuse un peu plus dans la sphère littéraire, j'ai lu (en ce moment Le journal
particulier, année 1936 de Léautaud), j'ai passé deux heures avec quelqu'un qui
est en train de finaliser un très bon manuscrit et j'ai peut-être trouvé le titre de
mon futur bouquin. En fait, l'écriture est un tout insécable, fait de rédaction
bien-sûr, mais aussi de tous les à-côtés. Mon père m'a raconté une anecdote qui se
passe à Oderberg, je sais qu'elle figurera dans un livre à venir. J'ai cherché des
citations, j'ai relu Beckett à cet effet, Je me suis réjoui de la nomination de Michel
Bernard pour le prix France Télévision, tout un tas de micro éléments qui ne rentrent
pas dans le temps d'écriture proprement dit, mais qui se déversent dans le grand faitout
de l'écriture.
Je peux être toutefois plus précis. Lorsqu'on me pose la question " Mais quand
écrivez-vous ? ", je me vois dans mon bureau, là où je suis en train d'écrire ces
lignes. Ce matin, par exemple, j'ai rejoint mon bureau vers 8h30, comme quasiment tous les
jours, j'ai allumé l'ordinateur, je n'ai pas écrit pour autant, mais je me suis mis en
disposition pour. Et c'est bien cela qui m'importe : chaque matin, c'est le même rituel,
je me rends disponible pour l'écriture. De là à en conclure que j'écris en permanence,
il y a un pas que j'hésite à franchir. Force est de constater que je ne reste pas rivé
à mon bureau. Je traverse les pièces de la maison, je m'égaille dans les différentes
bibliothèques, je consulte un site littéraire sur mon IPad en faisant la cuisine, je
reviens à l'ordinateur, j'écris quelques mots ou j'y passe deux heures. Certains ont
raconté les affres de la création perpétuelle et le bagne de l'écriture, ce n'est pas
mon cas. Blaise Cendrars à un moment de sa vie a déclaré en avoir eu marre d'écrire.
Pierre Bergounioux parle de son bureau comme de sa " table de peine " : je ne
réagis pas ainsi. Ça semblerait vouloir dire que l'écriture se ramène en permanence à
vouloir enfermer sa pensée dans un livre projeté, alors que c'est l'errance de la
création que j'aime par-dessous tout, le voyage et sa liberté. En ce sens je me
rapproche plus de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier qui écrivait dans L'Usage du
monde : " Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations
". D'ailleurs, c'est une idée : je peux toujours répondre par cette galipette à la
question " Mais quand écrivez-vous ? " qui taraude mes semblables.
(19/03/2018)
Le nouveau livre (nom de code ST, annoncé dans cette même rubrique le 28/11/2017) avance assez
vite, à un rythme d'environ 80 pages par mois (du moins retranscrit en pages habituelles
d'un format de roman). Je pense avoir dépassé la moitié de cette histoire, ce qui me
remplit d'aise : si je fais un parallèle avec la course à pied, c'est souvent à partir
du 12ème kilomètres pour un semi-marathon, par exemple, que l'on devient à peu près
certain de terminer une compétition de fond. Donc, je devrais mener au bout cette
histoire qui commence par ailleurs à fabriquer elle-même sa propre logique, sa propre
explication, ce que j'ai l'habitude d'appeler le roman du roman. C'est un grand
soulagement pour moi, car jusqu'à début février, je n'étais pas persuadé avoir choisi
un bon sujet, ni commencé à trafiquer quelque chose qui me correspond. Maintenant, je
n'ai plus d'hésitation. Pour ce livre, mais de plus en plus comme pour les précédents,
lorsque je m'assois à mon bureau (ma table de peine, comme dirait Pierre Bergounioux)
pour reprendre la suite de mon écriture, je relis à haute voix le chapitre écrit les
veilles. Cependant, pour ST, ce gueuloir à la Flaubert s'est modernisé : je me sers du
micro intégré à mon micro-ordinateur pour enregistrer ma lecture. Je peux ainsi
repasser ma lecture numérique indéfiniment à la manière d'un livre audio. Ces écoutes
supplémentaires me permettent de savoir si le texte tient bien en bouche, mais surtout
contribuent à me rassurer. Je trouve ainsi que j'ai une très belle voix c'est déjà ça
!
(12/03/2018)
Lorsqu'on creuse la biographie d'Alain Bosquet, on tombe sur des
photographies qui le représentent toujours en posture sévère, lunettes fortes, front
dégagé, l'ensemble cerné par des cheveux indisciplinés. La notice Wikipédia précise
qu'il est né en 1919 et qu'il s'est impliqué dans la seconde guerre mondiale dans le
camp de De Gaulle en devant choisir pour les alliés les villes normandes à bombarder
lors du débarquement : il acquiescera pour toutes les villes et n'exprimera aucun
remords. Ça fait donc froid dans le dos, et Alain Bosquet rejoint ainsi les poètes qui
se sont illustrés dans l'histoire. On pense d'ailleurs à Saint John Perse (Alain Bosquet
lui consacrera sa première biographie), qui, à la même époque, commit l'erreur de ne
pas prendre les mêmes options de résistance que lui. De Gaulle ne lui pardonnera jamais
et ignorera la remise du Prix Nobel à Saint John Perse. En revanche, on aurait pu croire
que l'action d'Alain Bosquet pour la libération aurait mérité une reconnaissance plus
visible du général. On ne trouve rien à ce sujet, peut-être parce qu'Alain Bosquet est
resté belge jusqu'à sa naturalisation française en 1980. D'ailleurs malgré sa vie
parisienne et son implication dans le monde des lettres francophones, il échouera à
rejoindre l'Académie française tandis que l'Académie royale de Belgique le consacrera.
Bref, cette relégation est assez étonnante, à moins que le souvenir des bombardements
de Normandie, les déclarations à l'emporte-pièce du poète, sa (trop) haute idée de la
poésie l'ait écarté du monde policé des lettres. N'avait-il pas déclaré, alors que
Brassens venait de reporter en 1967 le Grand Prix de poésie de l'académie française :
" Pourquoi pas Fernandel ? ". L'année suivante il remporte le même prix. On
ignore si Brassens ou Fernandel eurent une réaction à sa nomination.
(28/02/2018)
Deux faits m'ont fait retourner récemment à André Hardellet. Une
intervention tout d'abord vers un public d'enseignants dans laquelle j'ai cité le poète
pour aider à un concours sur l'écriture du travail. En effet, dans La Cité Mongol
(note de lecture du 27/03/2002), André
Hardellet invente des métiers extraordinaires : le charmeur d'orages, le chercheur
d'échos, le chef des baisers, le semeur de bruits, le poseur de grillons, le surveillant
des glaces… Tant de poésie laisse rêveur dans le monde impitoyable du travail (voir
cette semaine encore ma note d'Étonnements)… Ensuite, René Fallet, qui fût son ami
et dont je relis une biographie, l'a beaucoup soutenu lors de " l'affaire Hardellet
".
René Fallet, donc, connaissait André Hardellet depuis 1947, présenté par André Vers,
probablement à la suite de la parution de son premier roman, Banlieue Sud Est
que le futur " écrivain bourbonnais " venait de publier à l'âge de 19 ans
chez Domat. André Hardellet lui écrivait d'ailleurs en 1958 : " L'amitié n'est pas
une chose vaine, ni un vain mot ". Il lui dédiait régulièrement des poèmes, comme
Film ou ce texte de Faubourgs et villes (tous deux dans La Cité
Mongol). On y trouve des phrases délicieuses : dans Film, André Hardellet
évoque des couleurs " peu usitées et difficiles à trouver en tubes dans le
commerce ", ainsi la couleur " légende ", un peu " celle du tilleul
séché, répandu sur une nappe de soleil " ; dans Faubourgs et villes, rien
à envier à la " métropole crue moderne " d'Arthur Rimbaud, c'est la même
illumination : " Villes inapprochables, dômes, flèches qui se découpent sous des
volées d'oiseaux, versants des toits, rues vides parce que les habitants célèbrent une
fête incompréhensible, sérails sans garde ".
Il faut citer André Hardellet, sa poésie magnifique, pour mieux mesurer la connerie
humaine qui l'atteignit en 1973. Il avait publié (4 ans auparavant !) une ode à la
beauté des femmes chez Pauvert, Lourdes, lentes. A l'occasion d'une réédition
par Régine Desforges dans une collection de luxe uniquement vendue sur catalogue, une
plainte pour outrage aux bonnes mœurs fut déposée par la Ligue de l'enfance et de
la famille. Le procès donna lieu à condamnation, saisie et destruction des exemplaires
du livre à tirage limité, tandis que la première édition était toujours disponible en
librairie, comble de l'absurde. Ce procès qui dura entre mai et novembre 1973 a usé le
poète. Malgré l'intervention et le soutien de Julien Gracq, du prince Murat, alors
directeur des cahiers de l'Herne, cités comme témoins, les éloges du livre par
beaucoup, comme Jean-Louis Bory, malgré la pétition que René Fallet fit circuler, la
censure fût inévitable. L'affaire fit une victime : le poète lui-même. André
Hardellet mourut de chagrin quelques mois plus tard, le 24 juillet 1974, il avait 63 ans.
Le très beau livre de Françoise Lefèvre Les Larmes d'André Hardellet (en note
de lecture cette semaine) lui rend hommage, il faut le lire.
Bien-sûr, à l'heure de la pornographie accessible sur smartphone, on ne peut que se
gausser de cette censure d'un autre temps. En sommes-nous sûrs ? Certains textes
autrefois permis ne passeraient probablement plus, les réseaux sociaux se chargent d'une
fausse morale, les dénonciations sont incitées, à la mesure d'une information
facilement accessible. En 2010, Zoé Shepard en a fait les frais pour son livre Absolument
dé-bor-dée ! : mise à pied de son boulot, la littérature du travail n'échappe
pas à la censure. En fait, la censure s'est étendue à tous les domaines, à tous ceux
qui mettent les pieds dans le plat et dénoncent un système en place.
Cependant, comme pour Hardellet, le prétexte de la protection de l'enfance est facile à
invoquer. Initialement initiée par une loi datant de 1949, son but est de contrer les
œuvres qui ne doivent pas montrer sous un jour favorable " le banditisme, le
mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche […] de nature à
démoraliser l'enfance ou la jeunesse ". Elle a toutefois été complétée en 2011.
Les publications pour la jeunesse " ne doivent comporter aucun contenu présentant un
danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est
susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine […], aux atteintes à la
dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de
substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes et délits
". On ne peut a priori qu'être d'accord, mais à la vague approximation qualitative
aux bonnes mœurs succède un catalogue des interdits dictés par l'actualité,
l'opinion, soumis à une grande variété d'interprétations. La très grande majorité
des publications ne formulant pas de restriction d'âge, on peut penser que cette loi
s'applique ainsi à tous. Et que l'affaire Hardellet est appelée à se multiplier dans
les années futures.
(19/02/2018)
Le hasard fait que j'interviens en ce moment pas mal sur Retour aux
mots sauvages dans les établissements scolaires. D'abord à Chazelles-les-Lyon en
janvier (accueil très agréable, merci à tous) et maintenant dans trois classes de ma
ville, suite à un cycle " cinéma, travail et justice " pour lequel le film Corporate,
paru il y a un an, a été diffusé. Comme ce long métrage sur le harcèlement en
entreprise s'est inspiré des drames à France Telecom, quelques enseignants m'ont
demandé d'intervenir au sujet de Retour aux mots sauvages qui fait écho.
D'une manière générale, intervenir sur le sujet du travail en collège ou en lycée est
toujours délicat. Les élèves ne connaissent pas le monde du travail, on leur demande de
se projeter dans l'avenir, donc de choisir un métier, et lorsqu'on aborde le sujet du
travail, on leur présente les aspects négatifs et noirs : harcèlements, suicides…
Un comble. Si mes interventions portent à la fois sur l'histoire de ce drame et
l'histoire de mon écriture (le roman de ce roman en quelque sorte), j'essaie de prolonger
le débat en insistant sur la manière dont le dialogue a été renoué : l'histoire des
entreprises n'est jamais linéaire, par extension, la manière dont on aborde sa vie
professionnelle comportera forcément des hauts et des bas.
Ce retour à mon livre me replonge dans la façon dont j'avais vécu son écriture,
l'étonnant mélange d'invention et de réalité. Le personnage que j'avais créé
travaille dans une entreprise tétanisée par les suicides, à savoir qu'au fur et à
mesure que je l'écrivais, ses questions étaient aussi les miennes. La suite qui n'a
jamais été écrite (le faudrait-il ?) a été plus sereine. Mon entreprise a renoué un
dialogue sur les seules bases qui étaient possibles : respecter les hommes et les femmes
qui y travaillent, arrêter de leur dire qu'ils doivent quitter la boîte et discuter avec
eux sans arrière-pensée.
A l'heure où je n'ai plus aucun lien avec mon entreprise, cet apaisement me reste en
tête. Pour autant, il convient d'être vigilant, les mauvais signes se multiplient ces
temps-ci : la rupture conventionnelle n'est souvent qu'un moyen à moindre frais de
maquiller les licenciements économiques. La baisse des recours au tribunal des prudhommes
n'est pas l'indice d'une amélioration du dialogue social, au contraire, celui-ci devient
individuel, adapté à chaque salarié et on sait combien est démuni celui à qui on
demande de s'en aller sans faire de vagues. Autre signe inquiétant : le procès des
dirigeants de France Telecom n'a toujours pas eu lieu, ça fait neuf ans que ça traîne :
autant de signes d'impunité pour les autres patrons. Le système habituel où les forts
sont toujours protégés et les faibles toujours plus exposés ne s'est pas arrangé. Les
réformes prévues par le gouvernement, les lois sur le travail, ne vont pas profiter aux
travailleurs de base, le Medef se frotte les mains un peu trop ostensiblement. La réforme
prévue de l'éducation va entériner l'inégalité pour la génération future, pas
besoin d'être devin pour voir que cette usine à gaz ne va profiter qu'à ceux qui en
détiendront les codes. Bref, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augures, un
nouveau retour aux mots sauvages et à la sauvagerie tout court n'est peut-être pas si
loin, que ça…
(13/02/2018)
L'arrêt de mon travail avant l'âge idoine provoque de plus en plus des
conclusions hâtives chez la plupart de mes connaissances et amis. L'année de refuge à
domicile que je me suis imposé pour terminer ma thèse ne m'a pas fait y prendre garde
outre mesure, mais la situation que l'on me prête désormais commence à m'insupporter :
on affirme donc que je suis " en retraite ". Cette appellation est bien commode
pour nommer une situation qui y ressemble dans les faits. Et comme il n'en existe pas
d'autre, ou parce que notre imagination collective peine à désigner celui qui a bouclé
son travail nourricier, cette conclusion hâtive s'impose. D'où la fâcheuse propension
de beaucoup de personnes de mon entourage à vouloir remplir mon agenda de jeune
retraité, " puisque maintenant j'ai du temps ", disent-ils. On m'a donc
proposé pêle-mêle de présider une association, de passer trois jours chez des parents
âgés, bref, on imagine à ma place une sorte de bénévolat actif destiné à remplir
des journées forcément oisives. J'ai fait mon tort, aussi, faut dire : le nez dans le
guidon de ma thèse, j'ai éludé les questions sur ma nouvelle vie en ne démentant pas
la case " retraite " dans laquelle on m'a précipité. J'ai aussi accepté de
mettre sur pied une exposition dans ma ville et les heures que j'y ai passées ont pu
laisser croire aux autres une disponibilité sans fin.
Mais il s'agit d'un malentendu : le retour aux affaires (littéraires s'entend) est
programmé, l'agenda se remplit, je le crie donc haut et fort, notamment à ceux qui
croient devoir occuper mes journées " puisque j'ai du temps ". La notion de
temps est toujours complexe et le ressenti de chacun est individuel, absolument pas
duplicable. J'ai toujours clamé que le temps était une réserve inépuisable, parce que
c'est une question de choix : c'était souvent la manière dont j'expliquais mes multiples
activités qui en étonnaient beaucoup : études, écritures, travail, activités
sportives, familiales, voyages… Je continue à le penser, de même que j'ai toujours
affirmé accomplir deux métiers, celui, nourricier, dans la famille Orange et l'autre, de
cœur, au chaud des livres et des romans. Le premier métier continuant sans moi,
reste le second : écrivain. Je suis donc maintenant exclusivement écrivain et non
retraité. J'insiste : pourquoi cette activité qui est une évidence pour beaucoup de mes
" collègues " n'en serait pas une pour moi ? Les écrivains qui ont maintenant
l'âge de la retraite sont-ils affublés du terme " d'écrivains retraités " ?
Allez expliquer cela à François Bon, Pierre Bergounioux, Bernard Chambaz, Jean Echenoz
(en note de lecture cette semaine) ou Haruki Murakami… La toute jeunette Muriel
Barbery qui a quitté l'éducation nationale après le succès de L'Élégance du
hérisson est-elle considérée en retraite ? Pourtant le choix qu'elle a fait
quelques années auparavant s'apparente au mien maintenant. J'avais deux métiers, je n'en
ai plus qu'un : je suis encore plus écrivain qu'avant, qu'on se le dise…
(05/02/2018)
En 1719
paraît le roman de Daniel Defoe Robinson Crusoé. Il est inspiré par une
histoire réelle, celle du marin anglais Alexandre Selkirk qui fût débarqué en 1704 sur
une île déserte de l'archipel Juan Fernandez et y vécut pendant 4 ans. Récupéré au
hasard d'un bateau, son retour et son aventure fait le tour de l'Angleterre, avant que le
marin ne renoue avec la mer à bord d'un négrier et y périsse de la fièvre jaune ou de
noyade en 1721, à l'âge de 45 ans. En réalité, le récit de Defoe qui connut un grand
succès, est considéré comme un écrit précurseur de la forme prédominante du roman
occidental, de même que le Don Quichotte de Cervantes, rédigé en Espagne un
siècle plus tôt (selon Marthe Robert, Origine du roman, roman des origines). Ce
dernier, qui appartient à la littérature picaresque, a en commun avec Robinson, son
inépuisable énergie qui dote pareillement les deux héros, et aussi l'accompagnement
d'un tiers dévoué mais qui reste dans l'ombre : Sancho Panza et Vendredi. La question de
l'invention d'un romanesque est importante car les caractéristiques d'une telle fiction
n'ont pas changé : irruption du hasard et des péripéties, œuvre d'imagination,
tension avec le réel (notamment pour Robinson qui s'appuie sur une aventure vécue). Le
thème en particulier du monde neuf qui est à construire avec Robinson connaît un
engouement. L'irruption du " bon sauvage " cher à Rousseau (qui tenait le roman
de Defoe en grande estime) rassure un monde à l'aube d'un colonialisme européen qui
s'accapare les dernières terres à découvrir. Les robinsonnades inspirées par le récit
de Defoe vont dès lors fleurir. Le principe est toujours le même : le héros échoué
seul (ou pas) dans une contrée inhospitalière doit organiser sa survie. Évidemment, de
nos jours, il n'y a plus beaucoup d'endroits inhabités (quoique : la désertification
qu'induit l'aménagement mondial du territoire vers les grandes villes va probablement
révéler des zones de moins en moins habitées, par exemple, mon département rural a
perdu 25% de sa population en 50 ans...). Les robinsonnades nouvelles manières mettent
souvent en scène la science-fiction, planètes à découvrir, stations spatiales
abandonnées, guerres nucléaires en regard desquelles le film Seul au monde
demeure une robinsonnade classique. On peut aussi imaginer d'autres déserts : virtualité
du Web, solitudes urbaines… Peu importe l'intrigue, en fait la robinsonnade met en
jeu toujours trois éléments : Robinson, Vendredi et l'environnement. Ou, décliné
autrement, notre prise avec la sauvagerie, notre allégeance à l'institution,
l'éducation, le besoin de règles et, a contrario, notre créativité qui a besoin de
s'affranchir d'un monde pensé par d'autres, de trouver des voies originales : on le voit,
la robinsonnade est très actuelle. Tour à tour, nous sommes dans une même journée
Robinson, en accord avec le monde, Vendredi en révolte, et nous prenons souvent la place
de l'institution avec nos incessants yakafaukons. Michel Tournier, à l'aube de
la génération 68, avait tout misé sur des thèmes philosophiques pour sa robinsonnade,
notre rapport à la mort, à la vie… L'actualité est plus prosaïque : on cherche
maintenant des préjudices d'anxiété pour exorciser nos peurs. Nous voulons des vies
lisses, Robinson est devenu trouillard et Vendredi se cache parmi les migrants.
(22/01/2018)
" Car il
en est des écrivains comme des coureurs : il y a des sprinters et des spécialistes du
fond et du demi-fond. Certains bouclent leur œuvre en trois semaines. On dit que
Stendhal dicta La Chartreuse de Parme en cinquante-deux jours. Á d'autres, il
faut du temps, beaucoup de temps. Ce sont des marathoniens. J'appartiens à cette sorte.
Un manuscrit mûrit dans ma tête et sur ma table quatre ou cinq années. Je comparerais
volontiers à une grosse marmite mijotant à très petit feu et dont je soulèverais à
tout moment le couvercle pour ajouter quelque ingrédient nouveau. Ou à une maison que je
construirais seul autour de moi, n'ayant rien d'autre pour m'abriter, et donc grelottant
au début sur un chantier informe battu par tous les vents, puis aménageant un espace de
plus en plus avenant. La dernière année est angoissante et délicieuse à la fois. Parce
que le roman approchant de son achèvement, mon esprit parcourt avec un bonheur naïf ses
pièces et ses dépendances, apportant par-ci, par-là des améliorations de détail, mais
il est fatigué en même temps de cet édifice trop lourd, trop compliqué dont il est le
seul habitant et dont il a hâte de se débarrasser pour se livrer à des jeux nouveaux et
en attendant interdit. Car rien n'est plus séduisant que les œuvres futures, rêvée
pendant que s'achève dans la douleur un travail de longue haleine. Elles ont toutes la
fraîcheur gratuite et légère qui manque au livre en chantier, Sali par les efforts et
les incertitudes. Il n'empêche que la rupture est blessante et marque le début d'une
période errante et désemparée. " (Michel Tournier, Le Vent Paraclet,
Pléiade, p. 1435-1436.)
(15/01/2018)