|
Notes d'écriture 2006
Remonté, il fit deux mots croisés, découpa minutieusement une réclame des sels Kruschen qu'il colla dans un cahier déjà rempli de grands-pères farceurs descendant des rampes d'escalier. Ceci fait, il se lava les mains et se mit au balcon. L'après-midi était belle. Cependant le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. Lui suivait chaque homme du regard avec attention et le lâchait une fois hors de vue pour revenir à un nouveau passant. C'était d'abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessus du genou, empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petites fille à gros nœud rose, aux souliers noirs vernis. Derrière eux une mère en robe de soie marron, bête monstrueuse entourée d'un boa, un père plus distingué, une canne à la main. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du quartier, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré avec une pochette brodée et des souliers à bouts carrés. Ils allaient aux cinémas du centre et se dépêchaient en riant très fort. Après eux, la rue devint peu à peu déserte. Les spectacles étaient partout commencés. Maintenant le quartier était livré aux boutiquiers et aux chats. Le ciel, quoique pur, était sans éclat au-dessus des ficus qui bordaient la rue. En face de Mersault, le marchand de tabac sortit une chaise devant sa porte et l'enfourcha en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout-à-l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café Chez Pierrot, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. Meursault retourna sa chaise, la plaça comme le marchand de tabac et fuma deux cigarettes coup sur coup. Il rentra dans sa chambre, cassa un morceau de chocolat et revint le manger à la fenêtre. Peu à peu, le ciel s'assombrit et de suite se découvrit. Mais le passage des nuages avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui la rendait plus sombre. La Mort heureuse, Albert Camus * |
Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris
un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé minutieusement une réclame des sels
Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les
choses qui m'amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et,
pour finir, je me suis mis au balcon. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau. Cependant le pavé était gras ; les gens rares et pressés encore. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que des boutiquiers et des chats. Le ciel J'ai retourné ma chaise, et je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé deux cigarettes L'Etranger, Albert Camus * |
Voici une comparaison précieuse à étudier. Albert Camus a souvent renié La Mort heureuse qui est resté non publié : logique, L'Etranger avait pris sa place, avec toute l'importance et le succès que l'on sait. On peut ainsi considérer, tant ces extraits sont proches, que La Mort heureuse a servi sinon de brouillon du moins d'épreuve pour L'Etranger. J'ai balayé de même ce premier texte et j'en ai marqué les différences, les ajouts (en italique), j'ai biffé les expressions disparues, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Camus, réécrivant. En réalité, l'action du texte, qui est une scène de rue, une description très précise presque à la Claude Simon (on pense aussi à Georges Perec...), diffère très peu et c'est remarquable. La scène semble être gravée dans le cerveau de l'écrivain. Mais c'est sans doute plus sûrement la réécriture pointilleuse du texte, du mot à mot qui donne cette impression. Le changement le plus radical est le narrateur qui devient "je" et qui rompt avec les canons caractéristiques du récit traditionnel avec lesquels Camus avait commencé son histoire : récit à la troisième personne (il, Mersault) et narration au passé simple. La rupture est parachevée grâce à l'emploi du passé composé. Ce temps du passé, en effet ne réagit pas pareil que le passé simple : autant une série de verbes conjugués au passé simple indique une réelle succession (il fit deux mots croisés, découpa minutieusement une réclame des sels Kruschen qu'il colla dans un cahier.../.... Ceci fait, il se lava les mains et se mit au balcon) autant la même série au passé composé doit-elle être précisée par des marqueurs temporels pour donner l'impression de suite chronologique (Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé minutieusement une réclame des sels Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier.../.... Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.). Cependant, Camus n'abuse pas de ces locutions complémentaires. L'impression d'actes non concertés, successifs mais ne semblant pas avoir de liens causals les uns avec les autres est conservé, amplifié même puisque c'est le narrateur lui même qui raconte, comme "étranger" à lui-même. On voit bien le virage essentiel de ce nouveau texte avec la version de La Mort heureuse. Je ne détaillerai pas davantage les ajouts et suppressions mais ça vaut le coup d'y revenir très en détail, lentement, et de se faire sa propre opinion sur ces différences de perception ressenties en tant que lecteur entre les deux extraits. On remarquera néanmoins la disparition de l'embarrassant "Lui suivait chaque homme du regard avec attention", ce "lui" marquant les limites de la perception d'un récit classique à la troisième personne où le narrateur, agissant comme témoin, est obligé de prêter des intentions au personnage... En utilisant une narration avec "je", en effet, le champ de vision est vécu de l'intérieur, des yeux même du narrateur confondu avec le personnage, principal de surcroît. Ceci dit, ça ne change finalement pas grand chose puisque dans La mort heureuse, le parti pris d'observer le narrateur donnait à voir les mêmes descriptions. Enfin, pour terminer, ajoutons que pour renommer son personnage Meursault, Camus n'a pas eu d'autres moyens que d'utiliser une technique de discours, en réalité, un discours rapporté où l'on déduit son identité dès la troisième page (Il a consulté un dossier et m'a dit : "Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans.".). Cela semble logique, le récit apporté par "je" s'apparente à un monologue intérieur et il est rare que l'on se nomme soi-même dans les pensées censées vous traverser...
* Emprunt des textes et concepts linguistiques : Claire Despierres,
Université de Dijon
(20/12/2006)
Je sens un titillement certain du côté de la plume, une prostate de
l'ordinateur portable, une incontinence du traitement de texte. J'ouvre et je referme des
fichiers, je trace et j'efface quelques mots, je me soulage dans des rêves chimériques
et quand je ne dors pas, l'envie me taraude d'inventer des histoires, des intentions de
bouquins, des visions de récits incomparables, des mirages de romans à succès. La nuit
me laisse fièvreux, le jour me trouve pantois. Je cherche, je ne trouve pas. J'essaie de
rallier mes muses, je me lance, je recule aussitôt. Quand ce n'est pas la forme, c'est le
fond qui ne va pas : une histoire trop banale, trop vue, trop noire, trop fleur bleue.
Quant à la forme… Trop intello, trop stylisée. Ou pas assez, trop commune, trop de
mots. Je fatigue, je m'essouffle, je renonce. Je guette l'accalmie, j'appareille, je
m'emballe mais faux départ encore, je rentre au port. C'est pourtant simple : j'aimerais
une histoire qui me plaise, pas trop prétentieuse, originale, un emballement serein qui
me trouverait attablé chaque matin au calme des pages d'écriture. Je voudrais la musique
de suite, un rythme solide, pas trop puissant, léger. Je souhaiterais un ton plaisant,
puissance de l'humour, vérité de l'amour. Aimez-moi, mes lecteurs, aimez-moi ! Et
soyez nombreux en plus ! Je crie mes désirs sur la grève déserte dans le vent mauvais
de l'hiver : las ! J'éternue une dernière fois et je rentre dans ma maison. Je vois mon
bureau, mon ordinateur, mon lit. Je sens un titillement certain et je rêve à
nouveau…
(13/12/2006)
En complément à la stylistique, ou plutôt à la linguistique de
l'énonciation, c'est l'idée de récit opposé à celle de discours qui me paraît
intéressante. En effet, ces disciplines tranchent les deux concepts d'une façon abrupte
ce qui en dit long sur la façon d'aborder la littérature et comment, d'ailleurs
paradoxalement, l'idée d'un "nouveau roman" a pu ainsi voir le jour. En
résumé et d'une façon simpliste, un récit sera marqué par les pronoms personnels
troisième personne,récit généralement édicté aux temps du passé. Un discours fait
l'objet d'un locuteur (première personne) qui s'adresse à quelqu'un (deuxième
personne), les temps utilisés sont variés, sauf le passé simple. Ces formes
traditionnelles se sont complétées par celles plus visibles de la ponctuation et de
l'agencement dans la page : c'est comme cela que Daniel Pennac à pu écrire quelques
pages savoureuses sur ces pavés de feuilles où les tirets annonciateurs du discours,
voire même d'une simple mais bienvenue réplique, apparaissaient comme des rivages
d'îles aux navigateurs perdus dans la mer des récits.
On peut ou non se préoccuper de cette différence entre récit et discours. On peut
encore passer outre avec brio et composer un récit qui mêle les deux académismes avec
un égal bonheur, citons Entresol de Vincent Meyer (Editions Maren Sell). Le
rôle du discours apparaîtra alors comme le vecteur de l'action du livre, lui impulsera
son rythme d'une redoutable efficacité. Le "nouveau roman" a rompu avec ces
académismes mais on présente rarement ainsi cette "rupture tranquille" (pour
paraphraser un terme politique actuel...). Pourtant, quand Claude Simon écrit La
Route des Flandres, le discours devient étroitement mêlé au récit. Les
répliques, ressassées, reprises, réagglomérées dans les pensées du narrateur
finissent par s'intégrer étroitement au récit et restent d'ailleurs dans cette logique
descriptive. Idem pour Nathalie Sarraute et ses Tropismes, où le jeu du discours
est évoqué par une troisième personne, comme si le locuteur était témoin de l'action,
donc du discours en train de se tramer. On peut en citer d'autres, Beckett et Mal vu
mal dit rejoint un monologue extraordinaire ou le narrateur élabore son propre
discours.
C'est sans doute cet équilibre qui détermine ma façon d'aborder un livre. J'utilise des
subterfuges qui joueront comme des dissolvants sur la matière récit et/ou discours.
Absence de pronom, donc de parti pris pour Central, indéfinition d'un
"on" pour Composants, discours impersonnels le plus possible pour PPPP.
En ce moment, je sens que l'écriture me taraude à nouveau, qu'elle cherche à se
faufiler entre les récifs du récit et du discours, je ne sais pas encore ce que je veux,
j'en suis à "avant l'intention d'écrire", je sais seulement qu'il me plairait
que ce fut simple à mettre en œuvre, aussi actif et direct que puisse l'être un
discours mais aussi réflexif et précis dans la langue que le récit.
(06/12/2006)
- J’ai souvent ressenti toute théorie universitaire des humanités (je préfère ce
mot à la froideur des "sciences humaines ") comme un maniement de concepts
en tous sens, une abstraction difficile à suivre, souvent guidée par un scientisme
hérité du dix-neuvième siècle ou du début du vingtième. Dans cet acharnement
scientifique à tout va, force est de constater qu’on en arrive toujours à
l’exclamation pragmatique : je faisais cela sans le savoir ! En effet, à
théoriser ces justes humanités qui nous guident depuis des lustres (la linguistique, la
philosophie, la psychiatrie, la sociologie sous toutes ses formes, tous ces multiples
machins qui se terminent en " ie " ou en
" ique "), on aboutit à forcement des Monsieur Jourdain. Même
s’il faut rester exaspéré devant la prétention d’absolu scientifique qui
préside à ces théories, et ainsi relativiser comme disait Einstein, il faut toujours
garder à l’esprit cette conséquence non négligeable qui conditionne notre attitude
devant ces regards particuliers. Car en effet, certaines réflexions nous touchent plus
que d’autres. C’est le cas pour moi de la découverte pourtant simple que
" la langue est linéaire ", comme l’a montré Saussure, dans son
Cours de Linguistique Générale, donc qu’elle produit du temps. Quelques réflexions
donc peuvent servir de guides et si l'on ajoute à une paire de Saussure, quelques
pensées de Benveniste et autres, on se construit d'utiles références. En effet, simple
comme bonjour est aussi un certain schéma de la linguistique de l’énonciation et de
la stylistique et qui m’attire de la même façon. Cela peut se résumer en quatre
points et cinq protagonistes : l’écrivain invente un narrateur, lui-même crée
un (des) personnage(s) qui élabore(nt) une histoire (diégèse ?) pour un lecteur
fictif désiré par l’écrivain (le narrataire) et tout cela aboutit au final devant
un vrai lecteur en chair et en os (et plus il y a de lecteurs, plus l’écrivain est
content). Voici résumé la théorie exposée mais qui résume particulièrement bien et
simplement la création d’un texte, récit, livre… etc, etc. Cette évidence est
séduisante. D’abord, les relations de cause à effet sont relativement binaires,
fonctionnent en principe dans le même sens et les cinq phases permettent d’observer
les interactions entre elles sans extrapoler outre mesure. Avant de regarder la
réversibilité de cet axiome, regardons justement ces zones frontières du point de vue
de l’écrivain (puisque c’est à peu prêt le seul regard que je puisse offrir
via expérience certes limitée mais quand même).
Partons donc de l’écrivain, inventeur d’un narrateur. A ce stade, le choix plus où moins solide, volontaire d’une tonalité ou d’un angle d’attaque a déjà été avancé. Ce peut être un incipit définitif, quelques notes, c’est toujours la recherche d’une langue particulière, et c’est là qu’intervient le narrateur comme vision plus ou moins personnifiée de cette langue, la " voix " de l’histoire qui se met en place. On connaît tous les dérives qui embrouillent la critique et les lecteurs : faut-il confondre l’histoire racontée avec celle de l’écrivain ? Ce qui pourrait paraître particulièrement vrai pour l’autobiographie. Bien sûr que non : le jeu de l’écrivain est qu’il n’entre jamais dans le " je " et Flaubert en dépit de ce qu’il raconte n’est pas madame Bovary. C’est à mon avis la phase primordiale : pas encore un texte, juste une intention d’écriture dont il faudra se méfier comme de la peste, l’enfer étant pavé de bonnes intentions, cela s’applique aussi au purgatoire de la littérature.
Bon, le narrateur est créé, la voix est trouvée, mettons. Cette deuxième phase consiste à mettre en place le troisième larron, encore plus imaginaire que notre narrateur qui lui découle directement du sang de l’écrivain. Le troisième larron peut-être pluriel et polymorphe : le personnage est joyeux luron ou triste sire, jolie héroïne ou marâtre de la Belle au Bois Dormant, souvent tous ensemble et parfois dans un même corps. Plus il sera multiple, plus il y aura d’interaction et plus l’histoire prendra " corps " justement.
Bien, nous voilà, écrivain, fort avancé dans cette histoire et c’est là qu’intervient notre quatrième protagoniste, le narrataire, ce fameux lecteur fictif. Il a la particularité qu’on ne pense que rarement à lui lorsqu’on écrit, ce qui est une grave erreur. En effet, ce petit relais est le pendant du narrateur qu’on a imaginé, l’oreille en quelque sorte, capable de recevoir la petite voix qu’on a mise en place. Mais il est surtout le dernier maillon avant celui que nous attendons tous, placé sur un piédestal, le Lecteur au front béni, notre raison sinon de vivre, du moins d’écrire… Et il écoute, ce lecteur, notre narrataire lui raconter l’histoire telle qu’il l’entend. Alors il convient de s’en soucier : imaginez un écrivain désireux de retracer une ambiance nostalgique, calme, genre variations Golberg de Bach. Ecrivez un discours, un récit (peu importe) avec des points d’exclamations et le narrataire à qui s’adressera aura l’impression qu’on l’engueule ! ! ! ! ! Du coup votre lecteur aura l’impression d’entendre Wagner à fond les manettes au lieu d’un interprète solitaire ! ! ! ! ! L’écrivain aura loupé son passage ! ! ! ! !
Ce raccourci est plus sérieux qu’on ne pense : en effet, je me suis souvent retrouvé en face d’un éditeur interloqué (l’éditeur interloqué est un éditeur qui fait son travail) et qui lui, refait le trajet en sens inverse : il est lecteur et remonte jusqu’à votre narrataire pour vous dire à vous, écrivain, ce que ce lecteur universel risque d’entendre à travers un propos maladroit. S’il est particulièrement perspicace et attentionné (attention, tous les éditeurs ne sont pas comme cela et tous les écrivains ne sont pas prêt à entendre ces remarques et avis circonstanciés mais pour moi, c’est une qualité précieuse que je recherche et qui me paraît indispensable) il vous indiquera ce qu’il faudrait changer. Il remonte jusqu’à l’histoire, aux personnages, voire même jusqu’au narrateur que vous avez inventé (et là, c’est grave, vous avez beaucoup de choses à rectifier, structure…etc. Etes-vous sûr que vous voulez continuer dans ce projet textuel ?). Bref, l’éditeur est en principe le premier, en tout cas le plus professionnel à reprendre la théorie de la linguistique de l’énonciation à rebrousse-poil. - Moralité, je suis intimement persuadé que l’écriture est en fait la résolution
des étapes évoquées ci dessus mais non pas linéaires et dans un seul sens comme on les
présente, mais plutôt dans une sorte d’oscillation permanente où l’écrivain
se demande sans cesse si son narrateur, sa voix donc, sert l’histoire qu’il
bâtit et comment cet ensemble devient compréhensible pour notre narrataire
(remarque : il vaut mieux tuer les personnages inutiles dans l’œuf car on
s’y attache quand ils poussent, on est comme cela les écrivains, tous fleurs
bleues…). Enfin, notre Lecteur au front cerné de lauriers nous rendra grâce de nos
efforts. Que l’on ne se méprenne pas à son sujet d’ailleurs : à nul
moment je n’ai écrit que je voulais qu’il me loue, simplement le but sera
atteint si ce lecteur embrasse l’ensemble des sentiments que je voudrais que le
narrataire ressente (joie, tristesse, ennui, toute émotion…). C’est à ce prix
que le lecteur ressentira un tout autre sentiment, le plaisir du texte et c’est dans
cette optique que Roland Barthes me semble-t-il l’avait compris.
(29/11/2006)
On peut utiliser Internet de différentes façons. Les écrivains qui s'y
sont mis assez tardivement via les blogs ont cette image d'un journal moderne,
impressions, actualités, étonnements dans l'ordre chronologique de l'apparition. De cet
angle d'attaque découle souvent des créativités surprenantes et vigoureuses, des
"Espèces d'espaces" et des "Penser/classer" que n'auraient pas renié
Georges Perec (qui sait ce que ce dernier aurait pu faire grâce à Internet d'ailleurs).
Ainsi le très beau site des Corps empêchés
d'Emmanuelle Pagano, par exemple.
Ceux parmi les plus anciens, avant l'apparition des "fabriques de blogs", ont
accompli la démarche inverse, le classement de la matière écrite devenait tributaire
des logiciels de production de pages web, obligeant à une architecture, certes
souple, mais réfléchie au préalable. Ainsi ont travaillé les précurseurs célèbres François Bon et Philippe
de Jonckheere dans le souci d'arriver à des structures les plus ouvertes possibles.
Si la logique d'accumulation demeure qui est l'essence même de la "linéarité du
langage" (Saussure, Cours de linguistique générale, la base...), ces sites
se sont souvent renforcé de blogs à l'intérieur même de leur structure et aussi (pas
seulement heureusement) de la matière qui alimente ces blogs, actualités personnelles,
journaux...etc. Le souci du renouvellement permanent, de la matière vivante du web comme
une peau sans cesse en recomposition, a prévalu dans ces modèles remarquables. Remue.net est ainsi exemplaire : le site n'a plus rien
avoir avec celui qui existait il y a quelques années sur tous ces aspects, techniques,
éditoriaux et aussi structurels dans un perpétuel renouvellement. C'est parfait, c'est
l'idéal pour rester en éveil face à la littérature.
Feuilles de Route, à côté, fait figure de dinosaure. Sa peau se renouvelle à
la lenteur d'écailles de sauriens. Le site n'a pas dû évoluer depuis plusieurs années
et le fonctionnement du moteur à trois temps qui a prévalu à sa création voici six ans
(le triumvirat des rubriques étonnements, notes d'écriture et de lecture) continue
cahin-caha à la vitesse d'une deux chevaux. Je suis en face de cette machine hors d'âge
avec la même sensation qu'un curé de campagne : tant que ça avance... Je pourrais
changer le moteur, on me parle parfois de spip, de trucs techniques et de logiciels sans
doute idéaux et qui apporteraient certainement des perspectives nouvelles à ma création
sur le Net. Et c'est vrai qu'il faudra que j'y vienne, mais je n'y vois pas l'intérêt
pour l'instant. Car en attendant, j'ai surtout très peu de temps à consacrer à ces
gouffres d'heures que l'informatique engloutit, hormis l'écriture et la publication de
mes petits articles poussifs chaque semaine.
Ce tableau est volontairement brouillon et gribouillé : je ressemble ainsi dans ma
surdité à l'un de ces paysans matois qui feignent d'ignorer le progrès urbain... Car en
réalité j'arrive toujours à composer à peu près avec une créativité, du moins il me
semble, qui me paraît essentielle, celle de rechercher en permanence autre chose de ce
qui ne constituerait qu'un journal de bord, un blog, bref, la recherche d'une véritable
écriture spécifique à Internet. Ainsi le texte que je propose cette quinzaine, ce
récit d'une balade ardennaise sur les traces d'Arthur "Rimbaud,
dans l'affection et le bruit neufs", cinquante photos dispersée en deux
épisodes. Quand j'y réfléchis, c'est assez souvent que je trangresse le ronron du
moteur à trois temps par des textes de types Feuilleton qui peuvent prendre des formes
diverses, soit des pages spécifiques (comme celle de Rimbaud, comme Langres s'use, via mon antique générateur Front Page
de création de pages Web), soit des blogs créés pour l'occasion comme pour le texte à venir en mars prochain ou le récit d'un
atelier d'écriture par exemple. Mais pour en
revenir à ce "Rimbaud", il me paraît assez refléter une part de création,
d'atelier, de table de travail, toute une cuisine laissée à voir dans ces aspects les
plus édifiants que seul Internet permet de transcender via l'ajout de photographies, la
tentation du texte sous-jacent qui s'élabore. Ainsi, celui-ci prend-il toute sa
réflexivité dans l'illustration des paysages, coins de rue, squares qu'aura connu
Rimbaud, donc à travers sa propre prose, mais aussi dans la sensation et l'émotion qu'un
tel périple m'aura inspiré. Encore fallait-il faire cohabiter les deux écritures et
c'est ainsi que mon sous-texte, apparaît volontairement diminué, peu lisible et
éclairci en regard de celui du poète. Seul Internet permet ce type de parution, de
chantier du moins avec cette facilité.
Et tout ce qu'il me semble être important ne réside pas tant dans la difficulté
technique, la prouesse esthétique, (on aurait pu faire apparaître citations et
photographies de façon plus actives et seyantes à l'exemple du très beau site consacré à Rimbaud) mais dans la logique
d'accumulation qui réside après tout cela : 300 000 km en deux-chevaux ou en Ferrari
importe peu, l'important est d'avoir traversé l'espace.
(15/11/2006)
La guitare de BB King s'appelait Lucille, la mère de Jimi Hendrix aussi
mais moi, c'est ma fille qui se prénomme ainsi, avec un seul "l" cependant.
Anecdotes, anecdotes, mais force est de remarquer que, côté guitare, et depuis tout
petit, j'ai toutes les cartes en main cela pour composer une histoire, que dis-je, une
véritable légende, (si, si, voir en Etonnements). Et comme j'ai découvert que j'avais
de la famille côté paternel, émigrée des plaines slaves du Danube lors de la dernière
guerre vers Chicago ou au Texas, voire même en Alaska et au Canada (une tante), ces hauts
lieux de musiques country, mélanges cajun mâtinés de balalaïka et d'accents tziganes,
confirment bien mon goût du blues ont fini par légitimer mon désir d'acquérir
l'instrument tant rêvé, une "six cordes" électrique de marque PRS avec deux
micros humbucking à double bobinage, les mêmes que ceux des Gibson (marque fétiche de
BB King) ajouté de l'indispensable ampli Fender à lampes véritables pour obtenir un son
chaud et authentique.
Encore faut-il en jouer... Bref, après une période de jardin d'acclimatation, le
quadrupède a fini par dérouiller ses doigts sur les standards ses Stones en premier et
de Jimi Hendrix de l'autre. La parenté est évidente, l'homme descend du singe et du
blues, Keith Richard brutalement d'un cocotier il y a peu (les spectateurs du concert
annulé s'en souviennent), mais l'homme à la Gibson Lespaul avec Jimi et sa Fender
Stratocaster sont brothers. En réalité, leur musique est simple, pas besoin de
connaître douze gammes de solfège pour jouer. Tout au plus apprend-t-on que la gamme
pentatonique est celle du rock'n roll et encore ça ne nous aide pas beaucoup. Le blues
est une musique de feeling (good de préférence). Je connais parmi mes très proches deux
musiciens, de ceux capables de poser n'importe quelle partition devant eux et de vous
jouer une pièce de piano, un mouvement de violon ou le concerto d'Aranjuez avec autant de
simplicité et d'évidence que lorsque je lis une page de Claude Simon ou de Samuel
Beckett et la preuve m'en fut apportée lors du solo de Keith Richard de Sympathy for the
Devil où la partition fut jouée par l'un de ces interprètes sans anicroche (mais avec
force doubles croches), alors qu'il m'est incapable de reproduire le machin sans l'avoir
appris d'oreille. Donc, très justement, c'était propre mais, comment dire, exécuté
avec un tempérament de lecteur (d'auditeur ?) alors que ce qui m'intéresse, c'est de
rentrer dans ces tranches de rythmes avec des sensations d'écrivain (de musicien ?). Et
c'est bien tout l'enjeu de ce qui pourrait apparaître aux yeux de certains comme une
lubie de plus, un vieux rêve d'adolescent attardé qui se réalise : en fouillant les
accords et notes du blues, c'est exactement la même sensation d'écriture que je
retrouve, le même processus. La rythmique en fond comme la petite musique que fait un
texte qui démarre bien, des phrases hésitantes et des notes bleues car, comme dans toute
écriture ce sont les imperfections de grammaire et de style qui accrochent l'âme.
Et de même que je suis persuadé (je l'expérimente même en ce moment) qu'il n'est point
besoin d'apprendre la littérature pour écrire, la connaissance et la technique musicale
m'apparaît dans l'instant superflues, voire gênantes. Je dis bien dans l'instant car, à
l'instar de Jimi l'autodidacte, déjà consacré Roi de la guitare et qui voulait
continuer apprendre la musique auprès des musiciens de jazz, je conçois qu'on se trouve
bloqué à un instant ou à un autre et qu'il faille un petit coup de pouce, de même
celui que je m'inflige celui-ci à travers des études de lettres modernes.
Mais en attendant, c'est bien le blues dans sa spontanéité qui m'intéresse car il
correspond aux thèmes que je recherche dans l'écriture, la réalité, le manque de prise
qu'on a sur nos vies, l'ambiguïté du désespoir dans l'humour, la générosité. Tout
cela doit bien finir par se rejoindre, n'est-ce pas, brothers and sisters ?
(08/11/2006)
Où écrire ? Ce pourrait être la question initiale alors que je
m’apprête à renouveler mes congés formation, donc à retrouver pour
l’essentiel mon bureau style Louis XVI, merisier chaud et onctueux. Le boulot
intermittent (disons que pour simplifier que je suis pour l’instant un intermittent
du spectacle du travail) et qui m’a tenu les six mois précédents ne m’aura pas
permis d’écrire sur mon lieu de travail, trop dérangé, trop absorbé au point
qu’en revenant le soir, il me devenait quasi impossible de commencer une page dans
ledit bureau. Donc l’endroit importe peu finalement, c’est la disponibilité de
la tête qui constitue le principal lieu d’écriture. Et c’est sans doute pour
cela que je m’encombre à remplir ma tête de choses en apparences inutiles ou sans
grand rapport avec l’inspiration. Par exemple, le récent atelier d’écriture de
Dole tout juste terminé et qui m’a pris du temps, des lieux, des trajets m’aura
finalement tellement agrandi ma tête que l’espace disponible s’en trouve
décuplé et à remplir sans doute ultérieurement. Et c’est de la même façon que
j’ai été amené très récemment à annuler un autre atelier au dernier
moment : quelle perspective m’offrait-il dans ce rapport temps employé à
celui-ci et ouverture d’esprit ? A savoir que l’ouverture est pour moi
directement liée à ce que je peux apporter autre qu’une animation de style club de
loisirs, mais une question de survie comme il m’a semblé apporter aux patients du
CHS : ce doit être, non pas mon côté boy scout mais plutôt moniteur de secourisme
qui transparaît. Donc en déclinant le superflu, j’ouvre encore plus l’espace
de ma tête. Je continuerai à la remplir de choses inutiles paradoxalement dans
l’attente confuse de ce que ça m’apportera, à savoir cette dernière année de
licence, la découverte plaisante de l’option du livre illustré période 1820-1870,
le navrant rigorisme universitaire sur Claude Simon au programme cette année, la
continuité de la linguistique, stylistique, latin, matières plus ou moins
superfétatoires. Mais bon, s’ouvrir la tête, la remplir, la déverser sur le bureau
en merisier ou ailleurs, où écrire dans ce rapport indissociable avec la matière
brutale, anguleuse de la langue fourchue de la bouche, la vipère du temps qui serpente,
oui, où écrire et quoi ? Quelle obsession...
(01/11/2006)
Le dix huit septembre dernier, le compteur de mon site a sonné les six
ans d'existence de Feuilles de route. Cent vingt mille visites, six cent cinquante quatre
fichiers répartis dans trente méga de mémoire, c'est bien l'accumulation que je
cherchais et encore est-elle petite et réservée uniquement aux images et textes, sans
communes mesures avec les sites multimédia de François
Bon ou Philippe de Jonckheere, voire même des
blogs récents qui ont du dépasser en un an ce que j'ai entassé en six. Peu importe, il
reste des belles surprises, comme cette collègue de travail qui découvre Feuilles de
route en tapant "grues cendrées" dans un moteur de recherche (coucou
Jocelyne...), ou comme mon épouse qui arrive par hasard sur mon site en essayant de
retrouver la nouvelle adresse de son luthier...
Anniversaire, donc, le sixième. Je fête cela à la manière des supermarchés qui n'en
finissent pas de déployer leurs papiers envahissants dans ma boîte aux lettres et chaque
semaine leur fournit l'occasion d'un happy birthday en lettres multicolores : les dix ans
du rayon charcuterie, les vingt ans du parking, les soixante ans du PDG. L'année
dernière, j'étais plus en avance (note d'écriture du 14/09/2005) mais en retard d'un
jour puisque c'est bien le 13 septembre que l'idée saugrenue a pris corps. Voyons. A
l'instar des supermarchés, que pourrais-je offrir en promotion, en tête de gondole ? Une
réduction sur mes livres n'est pas possible ((aparté : n'osant
répondre non à la question qu'on me pose parfois (ah, tu écris des livres ? Je pourrais
en avoir un ? en payant bien sûr -quelque fois, cette dernière remarque n'arrive
même pas, tant mon interlocuteur est persuadé que notre connaissance commune l'un de
l'autre, parfois très superficielle d'ailleurs, dispense de toute relation d'argent entre
nous-), il m'est déjà arrivé d'en commander dans mes librairies préférées - pas les
chaînes du web, ni les FNAC - sans recourir à la possibilité de les avoir moins chers
chez l'éditeur, histoire de respecter la chaîne de distribution du livre))
, il me faut donc chercher d'autres pistes de promotion. Ma
considération et mes remerciements envers les cent vingt mille visites qui ont eut
lieu depuis six ans, même si elle est réelle et sincère me semble insuffisante d'un
point de vue Marketing. Voyons, j'ai pourtant exercé ce métier dont les rouages ne
devraient pas avoir de secret pour moi. L'information en avant première des parutions qui
entrent automatiquement dans les sujets abordés au fil de l'eau ne constituent pas une
bonne idée non plus. Les regards sur ma vie intime et trépidante qui transparaissent
parfois ont un goût d'autosuffisance et de voyeurisme trop prononcé. Non, il me faudrait
quelque chose d'original, de modeste, de fleur bleue, de banal : faites moi un signe ici, je vous répondrai avec plaisir.
(04/10/2006)
Elle a appelé exactement au même lieu, à Chaumont, un an après avoir
refusé la précédente version (voir note d'écriture du 28/09/2005). C'est le même lieu
qui m'a surpris : on y vient rarement, c'est un de ces petits bâtiments techniques que la
miniaturisation de l'électronique et les réorganisations de service ont vidé de leur
personnel. Il reste juste une poignée d'irréductibles et je crois me souvenir que
c'était déjà pour la même personne que j'étais venu l'année passée, je n'y étais
pas retourné depuis. J'avais écrit mon enthousiasme à l'époque, cette énergie que
provoque l'animation des réunions ou des rencontres que l'on provoque pour le boulot. Je
devais avoir aussi la perspective identique du congé de formation qui approche bientôt,
l'exaltation du temps disponible à venir qu'on imagine faussement plus libre, par contre
réellement dévolu aux études et à la littérature dans son entier. Cette année c'est
pareil, cela va se renouveler.
La seule différence entre ces époques et le lieu similaire est que la version nouvelle
du texte a convaincu : "Un soupir de contentement à la fin de ma lecture",
dit-elle quand je l'a rappelle. Je me suis toujours demandé ce qu'éprouvait un éditeur
à la lecture d'un manuscrit qu'il attend. Soupir de soulagement, peut-être s'apercevoir
que ce que l'on espérait aboutit enfin. Tant mieux. Le texte en question est celui du blog d'essai bien sûr, celui qui me tient depuis
avril (le texte pas le blog) et que je viens de clôturer (le blog, pas le texte) la
veille même de son appel. Etonnant, non ? Je me souviens de ce repas au printemps avec
les deux éditrices, notre enthousiasme devant de nouvelles idées sans même réaliser
que celles que nous avions eues me conduisaient à bâtir un récit entièrement nouveau.
Ce fut fait et rapidement, heureusement. J'ai eu la chance de trouver de suite le ton
juste, enfin j'espère. Les corrections qu'elle m'annonce quand je la rappelle sont
finalement assez légères. Je me suis installé dans la voiture en bas du parking pour ce
coup de téléphone. Je déballe mon agenda pour prendre des notes et m'aperçois que le
critérium Waterman qui me suis depuis des années n'est plus dedans. Je remonte dans le
bâtiment et le retrouve glissé sous une table de la salle de réunion. Bon signe du
destin pour un superstitieux comme moi. Je retourne à la voiture et compose son numéro
sur le portable. J'ignorais qu'elle énumérerait de suite la liste des principaux
aménagements à apporter au texte. ça dure une demi heure et j'annote les deux pages
libres du week-end de mon agenda de travail. Il fait chaud, je baisse la vitre, la remonte
sans cesse à cause du bruit de la circulation. Je suis attentif : j'aime ses corrections
précises et l'élan qu'elle sait donner, la compréhension juste et dosée qu'il faut
apporter. Parfait, plus qu'à s'y mettre. Nous convenons d'un rendez-vous à Paris.
Puis en sortant de Chaumont, je fais un détour sur les traces de mon enfance et de
mes grands-parents paternels. Cette courte virée était prévue, ce sera sans doute
quelques mots à venir, peut-être d'autres pages à écrire, des photos aussi. Dans la
voiture, tout se bouscule, la date à respecter, aux alentours du premier novembre, pas
plus tard si l'on veut respecter les délais de l'édition. Et puis le souvenir encore
frais du central de Chaumont, quasi abandonné comme à Saint-Dizier.
Et je reviens au texte qui m'aura occupé cinq mois dans cette version nouvelle, c'est peu
mais il faut compter les atermoiements du premier récit, celui qui n'avait pas convaincu
ici même, il y a un an. Et je reviens au central, les deux photos prises, l'autre texte
qui était en cours d'ailleurs, je le cite dans ma note du 28/09/2005. Envie dans parler
en Webcam, rapidement, d'un trait, citer les passages du texte
d'ailleurs toujours en instance, en chantier. Et revenir à celui terminé qui l'a doublé
en quelque sorte. Et rouler encore sur les petites routes désertes, chemins de mon
enfance en pensant à tout cela, au boulot, à ses drames (voir en étonnements cette
semaine). Bousculades, les textes, le boulot, celui qui travaille, celui qui écrit, celui
qui se souvient. Enfances, présents, avenirs, bousculades.
Le lendemain, à six heures je m'attable à ce même ordinateur pour commencer les
premières rectifications du texte achevé avant de retourner au boulot.
(27/09/2006)
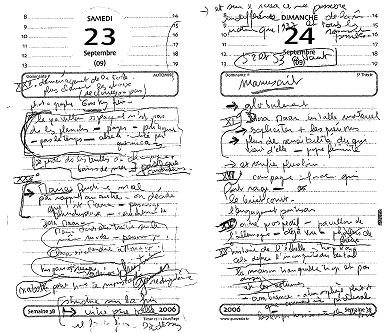
Petit point sur l'écriture en ces moments de rentrée. Les projets en
cours s'affinent. L'objectif prioritaire de terminer le texte commencé le 26 avril à
Saint-Dizier a été atteint le 15 août en Sicile, à raison de deux ou trois heures
d'écriture par jour de vacances. Trois mois et demi pour un texte de la grandeur de PPPP.
Cette rapidité s'explique par un premier texte déjà constitué, réfléchi plusieurs
années auparavant. Il n'empêche que la réécriture est totale : c'est bien un livre
radicalement différent, une autre histoire qui s'est constituée. Je mets aussi fin à ce
blog là
qui tentait de suivre au jour le jour la genèse de ce premier jet. Cette expérience ne
m'aura pas convaincue, je l'avais limitée le temps d'un été, mais même dans cette
brièveté, j'aurais aimé suivre vraiment en parallèle l'écriture, donner à voir ce
que je ressentais. Je n'ai pas eu le temps de m'appesantir sur mes réactions, cela aura
été vraiment de l'écriture dans toute sa brutalité, sans réflexion presque. C'est un
peu décevant, j'aurais aimé prendre plus le temps, m'attacher à la langue et que ma
langue m'attache plus. Reste les corrections qui tardent mais vont venir : la parution est
prévue pour février, je mettrai un dossier en ligne, dévoilerai le mystère vers la fin
de l'année, révèlerai peut-être d'ailleurs la première version. On verra.
Bizarre tout de même, cette époque bousculée, trois notes d'écriture en trois mois, il
est évident que le temps me manque. Le boulot nourricier m'a accaparé comme jamais, des
collègues, des présences sans cesse autour de moi toute la journée, pendant midi aussi,
pas un instant pour rêver, me laisser aller dans l'autre monde. Je réalise combien cette
épreuve a été difficile, à compter les jours qui me sépare de novembre, bientôt
novembre et date à laquelle je réitère un congé de formation de six mois pour terminer
la licence en cours, plus si affinité comme on dit avec l'écriture. Car dans la
précédente et similaire période, beaucoup de projets sont venus compléter le temps
libre, qui d'ailleurs ne l'était plus du tout au final : ateliers à Langres, visite à
Clermont (et bonjour affectueux à Vincent et Françoise, s'ils me lisent !), atelier à
Dole qui va se terminer et combien ce dernier aura été important
pour moi, au point que j'ai eu vraiment à cœur qu'il continue. Dans un mois et demi
maintenant, d'autres projets viendront s'ajouter aux dernières corrections en cours pour
le texte de février : un atelier dans ma ville et combien le parcours initiatique de cinq
heures aller et retour pour aller à Dole va me manquer, même au delà de la fatigue et
du temps qui file avec la voiture et l'autoroute. Je suis un grand voyageur, comme mon
père fut chauffeur routier. Mais enfin, d'autres visions, d'autres enthousiasmes sans
doute sont à découvrir. Et reprendre encore et toujours le fameux CV roman, ajouter
d'autres versions à cette arlésienne de livre, ne pas décevoir mes groupies (selon le
terme utilisé par Anne-Marie !). Me dirigerais-je enfin vers une parution programmée ?
Histoire de corser le tout, mon patient éditeur change aussi de maison, le contrat va
t-il suivre ? Rester ? Où vais-je ? Ah là là, que de moments passionnants encore
en perspective...
(20/09/2006)
Bon. Je ne voulais pas écrire. Pas le temps (ni le temps - voir en
étonnements). Je voulais filer à l'anglaise, partir en vacances, ne rien raconter avant
mon départ. Mais on ne part jamais sans rien dire, ne serait-ce qu'accrocher un mot à
l'attention du boulanger "pas de pain jusqu'à nouvel ordre" ou quelque chose de
ce genre. Donc je pars et je le dis : rendez-vous vers les derniers jours d'août. C'est
la première année où je sens que j'ai été vraiment dépassé par le temps, d'où
cette envie de partir vite, vers un nouveau rythme et d'anciens retards à combler.
D'abord l'écriture, le blog d'essai a continué et s'achemine vers une vingtaine
d'articles, il retrace le projet en cours et le but premier de ces vacances sera d'avancer
vers l'échéance du premier octobre, date fixée pour la remise du manuscrit. Et c'est
sans compter qu'il reste à peaufiner l'autre projet entamé depuis deux ans et la
discussion avec l'éditeur laisse à imaginer que cet élaboration patiente n'est pas
terminée. Ce sera une des grandes découvertes d'écriture de ces derniers mois
(années...) : à savoir qu'il existe des livres à écrire au long court, des cargos
voguants dans des mers remuantes, des coursives infinies à parcourir. D'autres récits
sont plus faciles. Celui qui va le doubler est un voilier de course, plus simple à
manœuvrer. Et tout cela cohabite dans nos têtes sans trop de problèmes.
Comme cohabitent toutes les aventures connexes de nos vies. Pas le temps là non plus de
tout raconter. Je voulais filer à l'anglaise, j'étais il y a dix jours à Liverpool.
Trouverais-je un jour un peu de temps pour montrer quelques photos (ah, si, voir en Blog
à l'essai, seulement deux). Je voudrais aussi monter une page d'autoportrait. Le dernier
en date est cet après-midi : mon pied par la portière de la voiture, j'ai toujours eu
une conduite décontractée. On verra pour cette page à la rentrée peut-être.
Connexes à l'écriture aussi, c'est l'atelier de Dole qui continue : déjà la treizième
séance. Et le parcours en fac qui s'achève pour cette année. Il me reste deux épreuves
à passer en septembre avec cette étrange et sans doute stupide fierté d'être un vieil
étudiant, et de me conforter au conformisme confortable des forts en concours
universitaires. Pourquoi ? Pas trop le temps d'y réfléchir, là non plus, on verra cela
plus tard. Plus tard, Plus tard. La rentrée. Qu'est-ce qui changera vraiment ?
(26/07/2006)
Un blog d’essai pour l’été : déjà 12 articles, essayez
de le suivre, suivez vos commentaires. Le premier, j'en suis fier, c'est Emmanuelle Pagano (le Tiroir à Cheveux, POL,
note de lecture du 28/09/2005).
(21/06/2006)
- Finalement, l'été approche même si le temps reste frais. L'année précédente,
j'avais proposé un feuilleton Langres s'use, histoire de
marquer ce changement de rythme, soirées plus longues, la vie dehors, des voyages,
changements d'horizon. Cette année, la mesure de l'été sera autre : c'est un blog qui
va compléter les notes de cette rubrique sans forcement les remplacer. Il concerne un
travail d'écriture en cours : je vais donc revenir plus franchement à une
"tentative d'exposition", ce qui demeure la préoccupation principale de ce
site. Ce sera une sorte de double de ces notes d'écriture. En effet, le blog dans sa
facilité de publication me permettra de publier quelques réflexions d'une façon plus
libre, plus réactive mais avec aussi tous les aléas que cela comporte, en particulier
l'irrégularité (irrégulier, il l'est déjà puisqu'il est ouvert depuis une quinzaine
de jours). C'est une sorte d'essai, il s'appelle d'ailleurs comme cela, de même qu'il
nous arrive parfois de nommer ainsi un fichier, une transaction informatique hasardeuse.
Essai, expérience, expérimentation, ébauche, esquisse. Des annotations, commentaires,
notules vont l'alimenter en parallèle de la rédaction du texte prévu qui continuera de
s'accumuler la plupart du temps dans les débuts de journée que j'affectionne, ces
aurores que j'espère lumineuses, éveillées de chants d'oiseaux et qui me jettent à la
table de travail dès potron-minet.
L'entreprise est déjà balisée par le temps, c'est là sa contrainte. Le projet a débuté en avril, le 26 précisément (je tiens beaucoup à cette date) et prendra fin à l'automne. C'est une course contre la montre : il faut écrire un livre pendant ce laps de temps. Ce bouquin raconte une autre course contre la montre, où plutôt deux qui se sont réellement produites, chose incroyable, dans le même laps de temps, la même période de l'année. Je me retrouve ainsi placé sur le même pied pied d'égalité que mes protagonistes : vais-je terminer à temps ? Comment réagit-on quand on tente de réécrire une seule histoire et deux actions dans un espace temporel parallèle ?
Mes explications sont volontairement confuses : je crois que c'est la distance qu'il me faut pour donner à voir, pour tenter d'exposer mon travail littéraire.
Suivez-moi là ...
(06/06/06)
- Je reprends à nouveau le thème que j’avais abordé la semaine dernière sur
l’absence de suivi de ces Notes d’écriture. En réalité, j’ai eu
l’impression d’avoir peuplé ces derniers mois de suffisamment de travaux en
rapport avec la littérature pour ne pas culpabiliser sur un quelconque relâchement. Oui,
je ne livrais pas assez matière à réflexion sur ma propre cuisine, puisque c’est
le but de ce site depuis l’origine (exposition du travail littéraire à la vue de
tous) mais en même temps, j’avais bonne conscience : ateliers, livre en cours
dans son élaboration régulière. Je me demande cependant si ce manque de régularité de
ces notes n’est pas un prétexte à entériner la fin de la crise littéraire (donc
existentielle, puisque je fais de la littérature une question de vie ou de mort) et qui
m’a taraudé pendant deux ans. Le fait de ne pas trop en parler au fil des jours est
révélateur comme si la patiente élaboration s’échevelait, se perdait dans ces
méandres d’hésitations. Et si je m’étais trompé sur le livre que j’ai
patiemment élaboré ? Et s’il n’était qu’un livre " de
passage " entre deux romans comme le fut en son temps Trottoirs et
potagers ? J’ai finalement peur d’avoir consacré autant de temps et
vingt versions à ce livre pour rien. CV roman, puisque c’est de lui
qu’il s’agit, me semble essentiel dans son thème, mais est-ce que je ne fais
pas mien le problème social de l’emploi commun à tout le monde, au point de le
confondre avec ma propre préoccupation, et ce, à travers le filtre de la
littérature ? Ou peut-être que le rôle des écrivains est de sentir confusément
l’évolution de ces problèmes sociaux ? Le sujet de CV roman
l’emploi, la difficulté des choix professionnels que l’on doit faire percute
évidemment avec ma propre expérience et ma reprise du travail montre ces évolutions
constantes dont la vitesse est largement supérieure à celle de l’écriture
d’un bouquin. Cette appréhension globale pourrait se résumer ainsi : CV
roman me semble " daté ". Et une question sous-tend cette
impression : est-ce qu’il ne va perdre de sa vigueur au fil des mois ? Ne sera
–t’il pas obsolète au moment de sa parution, si édition il y a ?
J’ai fait un roman sur un thème qui appelait un essai. L’essai aurait été
plus facile car péremptoire et reflet d’un moment donné. Un roman se doit de
traverser une étendue temporelle plus importante il me semble. Pourtant le choix est
catégorique : c’est bien le genre du roman qui est la base de la compréhension
du monde, jamais les essais. J’en suis persuadé et c’est bien pour cette raison
que je tente de l’appliquer aux sujets qui me taraudent habituellement, comme le
travail. Quant au résultat, des doutes me traversent d’autant plus que je trouve
encore inabouti à la relecture de la vingtième version de CV roman, que je trouve
touffu au moment de l’envoyer à l’éditeur : on se demande où je
veux aller où du moins c’est la crainte que j’ai. Mais il ne faut pas que je
réfléchisse davantage, il faut que je m’en sépare auprès d’un tiers pour
quelque temps : il me semble que c’est là un des rôles les plus important des
éditeurs, être tiers de confiance en quelque sorte.
Je me pose toutes ces questions sans doute parce que le nouveau livre que j’ai entrepris, avec un thème plus facile et dynamique, tend à discréditer le précédent roman tout juste terminé. Et le précédent m’apparaît donc tel que je l’ai dit plus haut, dans son éventualité de n’être qu’un livre " de passage " entre deux romans. Un livre chasse l’autre ou bien, pour parodier la SNCF, " Attention avant de traverser un récit peut en cacher un autre ".
(17/05/2006)
- L'actualité des notes d'écriture ne suit pas son chemin. Initialement créées pour
donner un aperçu de la table de travail de l'écrivain en perpétuel mouvement, elle
semble donner lieu à un immobilisme : neuf notes depuis le début de l'année et encore
faut-il compter dedans celles attribuées à d'autres, quelques réflexions sur
l'écriture de René Fallet et les lettres du voyant recopiées de Rimbaud. Pour autant
l'immobilité est toute relative. L'atelier de Dole, notamment,
occasionne une des facettes les plus intéressantes que j'ai eu à creuser dans ce statut
d'écrivain et me donne un travail assez conséquent, prenant et régulier. Cette
impression d'immobilité est peut-être due parce que les travaux d'écriture se sont
polarisés sur un seul texte depuis dix huit mois. Le sujet, pensé, repensé, rebattu,
grossi, devenu familier, se heurte à son épaisseur, à la difficulté d'appréhender
totalement cet OVNI littéraire. Pourtant, force est de constater que j'ai accompli ce
qu'il me semblait important de faire en novembre, dés que j'ai pu avoir un peu plus de
temps libre en raison d'un congé formation, à savoir, reprendre, étoffer et terminer un
deuxième jet de ce roman des CV. C'est fait depuis le 19 avril, avec ce soulagement que
cette version me semble plus complète que la précédente, plus baroque aussi mais c'est
le sujet qui le veut. Je pensais donc pouvoir reprendre plus tranquillement le chemin de
mon travail puisque mon congé formation touche à sa fin.
Il me reste pour autant à peaufiner cette version, disons à en retirer les échardes et à raboter quelques planches avant de remettre cet engin à l'éditeur. A peine terminé, finalement c’est se rendre compte avec surprise du peu de poids, du peu d’importance donné à ce travail, comme si il fallait s'en débarrasser au plus vite, le donner dans l’état d’inachèvement presque, encore chaud, entrailles palpitantes et qu’on en parle plus : dix huit mois de ma vie d’écriture…
J’ai cette impression, à la fois car je ressens une lassitude, une indigestion due au manuscrit remâché, mais surtout aussi parce qu’un autre livre se profile déjà, non pas dans un horizon lointain, mais là, devant ma porte, frappant d’impatience. En effet, j'aurais pu croire que cette vie d'écriture pouvait continuer dans le classique cheminement des corrections du livre en cours mais c'était sans compter un de ces coups du sort que vous révèle le hasard : un livre, non pas un nouveau, mais un qui refait surface, qui repart à neuf. Et bien entendu, on oublie tout le reste, on se jette sur les feuilles à écrire avec l'appétit habituel. Le temps qui m'est imparti pour le refondre est court, une poignée de mois mais cette frénésie me semble comme une respiration au grand air après la brasse coulée du livre précédent. Ne croyez pas que je dénigre le cadavre encore tout chaud du manuscrit précédent et même pas encore remis : j'ai trop travaillé dessus, trop donné pour le délaisser, il qui poursuivra son chemin pareillement, en parallèle, c'est un cargo tranquille, je l'ai déjà dit, solide, imposant et important. Je vais le relire et le remettre, non pas comme une version définitive, il y aura encore beaucoup à refaire sans doute mais j'ai besoin du regard de l'éditeur avant de le reprendre.
Tout cela sera à suivre, donc en notes d'écriture bien entendu si toutefois le temps, le foutu temps laisse une part à Feuilles de Route, ce qui me semble bien aléatoire… J'ai écrit en effet que je pensais reprendre plus tranquillement le chemin de mon travail, la reprise a maintenant eu lieu et cet espoir débonnaire est déjà hors jeu (voir en Etonnements…).
(10/05/2006)
Comment écrivons-nous par rapport au narrateur ? Quelle position
géographique adoptons-nous ? Quelle proximité ? J'ai toujours l'impression que le
narrateur des livres que j'ai écrit se trouve légèrement devant moi, précisément à
trois mètres et, silencieux, je le regarde vivre son histoire, raconter les évènements
qui lui arrivent. Ou plutôt les non-évenements, tant me semblent important chacun de ses
gestes futiles, chaque chemin escarpé qu'il emprunte. Cette sensation est
particulièrement vraie dans Central, je suivais mon narrateur qui arpentait le
central téléphonique de la cave au grenier. Sauf que ce narrateur avait vécu à travers
moi, on dit "faits autobiographiques" ou récit construit avec. Mais j'ai la
sensation incroyable que je ne peux être confondu avec ce narrateur. C'est une sensation
physique : je suis derrière lui.
Je ne suis pas devant, ce serait comme si l'histoire pouvait se dérouler en une sorte de
divination rapide des évènements qui vont survenir au narrateur, celui-ci arrivant une
seconde après moi. Peut-être que Proust a écrit comme cela.
Je ne suis pas sur le côté, il me semble que cela m'obligerait à avoir une sympathie
particulière pour le narrateur, comme si je l'accompagnais, déjà complice et défenseur
de ces faits et gestes, trop proche, comme utiliser le tu pour parler de soi. Apollinaire
a pu écrire comme cela.
Non, la position la plus probable, la plus naturelle, celle qui me vient en premier à
l'esprit est d'être situé derrière, peut-être parce que c'est le meilleur angle pour
voir pénétrer le narrateur dans le décor, le regarder s'enchâsser dans la vie,
percuter l'espace et le temps comme un mannequin d'un crash test automobile. Je pense
parfois que les personnages sont un peu comme des empreintes de fossiles, ils n'existent
pas réellement même à l'intérieur des livres, ils sont comme solidifiés dans l'air
ambiant, juste une trace modelée dans la roche, le décor environnant. Regarder la nuque
du narrateur posté ainsi devant moi, c'est aussi savoir que quoi qu'il arrive, je ne
pourrais rien changer au cours des évènements, ce sera toujours trop tard.
On pourrait imaginer d'autres angles de vue. Je me souviens de Claude Simon qui
explicitait sa démarche : écrire, c'est se tourner de tout côté, imaginer toutes les
positions possibles de descriptions.
Ainsi se tenir suspendu au-dessus du narrateur, comme un témoin distant, vu d'avion.
Peut-être que L'Etranger de Camus a été écrit comme ceci.
Ecrire en dessous, ou à raz de terre : cela peut correspondre au Procès Verbal
de Le Clézio, ou à Voyage au bout de la nuit de Céline, peut-être tout Kafka.
Je ne crois pas qu'il soit possible d'écrire en endossant avec exactitude la robe du
narrateur, Même les plus nombrilistes doivent avoir un décalage de quelques
centimètres, globes oculaires distendus des orbites, respiration échappée du
diaphragme, cœur qui ne bat pas au même rythme. On peut aussi modeler la distance et
regarder vivre son narrateur de très loin jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'un point
tout petit. Peut-être que décrire un paysage, c'est s'arrêter un instant au bord du
chemin et laisser le narrateur s'éloigner avant de le rejoindre un peu plus tard. Ces
zooms successifs, ces plans différents participent au mouvement incessant de l'écriture,
sortes de mécaniques dynamiques, des fabriques d'énergie certainement aussi et qui
aident à continuer.
(22/03/2006)
Petit point sur l’écriture et l’écriture, du moins dans sa phase créative,
c’est toujours CV roman. Non pas que Feuilles de Route ou les ateliers
qui m’occupent en ce moment ne participent pas à cette créativité, bien au
contraire, impression que toute cette énergie participe à l’élan des mots (il
n’y a qu’à voir la logorrhée de Dôle, journal de bord).
Et même ce travail que je m’impose dans les études de lettres reprises, la
contrainte scolaire qui m’obsède, relève d’une raison commune, secrète, à
peine consciente. Mais simplement, l’idée classique du petit tas de feuilles
qu’on aimerait bien voir poindre un jour sous forme de livre et qui justifie
l’appellation d’écrivain jusqu’à nouvel ordre porte un nom : CV roman.
J’avais fait un point " à la première étoile de la nuit ", il
y a deux mois exactement dans cette même rubrique. J’y allais de comparaisons
marines, CV roman, cargo voguant, " renflé, charpenté ".
Où en suis-je ? D’abord les allusions aquatiques et les adjectifs sont toujours
de mise (et jusqu’à Dôle, journal de bord, ce qui prouve bien la même familiarité
globale de l’écriture du moment). N’en doutons pas, CV roman
avance : le premier jet est épaissi des 4/5° du texte projeté. C’est le plus
gros tas de feuilles que j’ai produit jusque là, le voyage dépassera largement le
tropique des 300 pages. Les vents sont suffisants et je devrais aborder les rivages de
l’éditeur dans le délai que j’ai laissé entendre à l’admirable amiral
de la belle maison Fayard, soit avant la fin du premier semestre, même si les zones de
calme plat ne manquent pas et sont perturbants, sans doute dus à l’usure que
provoque cette étrange circumnavigation. Etrange oui de constater comment cette écriture
au long court est différente des autres livres que j’ai écrit, me semble t-il.
D’abord la méthode est bien étayée, la structure efficace, il n’y a
qu’à suivre les plans (les cartes de navigations). Je n’ai jamais écrit sur
une vision préalable, je me suis toujours laissé porté par les aléas et les flots.
Mais là, le projet était bien différent et les hésitations de 2006, les
tergiversations sur la route à prendre ne me laissaient guère de choix, il fallait qu'il
construise sa propre cohérence, où plutôt que je construise celle-ci et qu’elle
s’éclaire au fur et à mesure que je la teste. J’ai testé : CV roman
est charpenté et solide. Pas quelque chose de très fin mais il flotte. Je suis surpris
dans les quelques moments de relecture (je n’aime pas me relire quand le premier jet
n’est pas terminé) du drôle de ton que prend ce livre. Autant PPPP par
exemple me semblait assez lyrique, autant le bois me semble ici rugueux, les effets sont
non pas grossiers mais bruts, des planches à peine ébarbées. Je n’ai pas envie de
peaufiner cette teneur d’écriture. Pas de contrainte, c’est parfois brutal,
mais cohérent, le livre s’assemble bien et le style donc, dans sa beauté, ses
intuitions, m’indiffère. Je n’ai pas d’illusion, ni d’intention pour
ce livre : je voudrais juste qu’il débarque avec sa grosse cavalerie entre les
mains des lecteurs, non pas quelque chose de grossier ou de rustre, encore moins de simple
(ce mot je l’ai en horreur depuis le jour où je m’étais égaré dans un salon
du XVI° à Paris et où une caricature de bonne lectrice tout juste échappée du couvent
des oiseaux me l’a placé pour remplacer ma tentative de lui expliquer ce
qu’était Composants, le récit, d’une vie banale, avais-je dit.
Simple, avait-elle rectifié, on dit simple…). Non, le machin en cours qui se balance
encore à quai sera un peu rude, farouche : voilà, c’est dit, à prendre ou à
laisser.
Par contre, oui, j’aimerai qu’il soit publié : d’abord pour me
retirer cette obsession et parce que je crois qu’il vaut la peine. J’ai
dépassé tous les genres, il a crevé le roman, c’est pourquoi il peut se permettre
sans étiquette (au sens d’usages de la cour et des vies simples…) d’être
un peu brut de fonderie. Et puis si cela ne se faisait pas, j’aurais
l’impression d’avoir une baleine dans mon jardin (comme l’excellent livre
de Bernard Mathieu Un cachalot sur les bras ) un truc dont je ne saurais pas me
débarrasser, disons plutôt une grosse épave rouillée de chalutier au milieu de la
pelouse pour reprendre les comparaisons de constructions navales. Et avouez que ce serait
étrange dans mon coin de l’Est à quatre cents kilomètres de la première mer.
(15/03/2006)
Quoi de plus naturel que d'inserer dans ces notes d'écriture les lettres du Voyant
d'Arthur Rimbaud ?
Je est un autre... Tout y est dit y compris la question de son silence qui s'y inscrit
déjà et qui continue d'en étonner beaucoup (on se demande pourquoi). D'ailleurs, il n'y
a jamais eu de silence pour lui puisqu'il n'y avait pas eu de chant poétique, à
peine un bruit d'eau : "des rinçures" dirait-il bien plus tard. "Le
premier chien dans la rue vous dira cela" (dernière lettre du 09/11/1891, veille de
sa mort).
Article complémentaire : Note de lecture Rimbaud de Claude Jeancolas.
Première lettre du Voyant (à Georges Izambard, 13 mai 1871)
Charleville, 13 mai 1871.
Cher Monsieur !
Vous revoilà professeur. On se doit à la Société, m'avez-vous dit ; vous faites
partie des corps enseignants : vous roulez dans la bonne ornière. - Moi aussi, je suis le
principe : je me fais cyniquement entretenir ; je déterre d'anciens imbéciles de
collège : tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en
parole, je le leur livre : on me paie en bocks et en filles. Stat mater dolorosa, dum
pendet filius. - Je me dois à la Société, c'est juste, - et j'ai raison. - Vous aussi,
vous avez raison, pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie
subjective : votre obstination à regagner le râtelier universitaire, - pardon ! - le
prouve ! Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant voulu
rien faire. Sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse.
Un jour, j'espère, - bien d'autres espèrent la même chose, - je verrai dans votre
principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez ! - Je
serai un travailleur : c'est l'idée qui me retient, quand les colères folles me poussent
vers la bataille de Paris - où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je
vous écris ! Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève.Maintenant, je
m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me
rendre Voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer.
Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances
sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce
n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire : On me pense.
- Pardon du jeu de mots. - Je est un autre. Tant pis pour le bois
qui se trouve violon, et nargue aux inconscients, qui ergotent sur ce qu'ils
ignorent tout à fait !
Vous n'êtes pas Enseignant pour moi. Je vous donne ceci : est-ce de la satire,
comme vous diriez ? Est-ce de la poésie ? C'est de la fantaisie, toujours. - Mais, je
vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni - trop - de la pensée :
Le Coeur supplicié
Mon triste coeur bave à la poupe....
Mon coeur est plein de caporal !
Ils y lancent des jets de soupe,
Mon triste coeur bave à la poupe...
Sous les quolibets de la troupe
Qui pousse un rire général,
Mon triste coeur bave à la poupe
Mon coeur est plein de caporal !
Ithyphalliques et pioupiesques
Leurs insultes l'ont dépravé ;
A la vesprée, ils font des fresques
Ithyphalliques et pioupiesques ;
Ô flots abracadabrantesques,
Prenez mon coeur, qu'il soit sauvé !
Ithyphalliques et pioupiesques
Leurs insultes l'ont dépravé !
Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô coeur volé ?
Ce seront des refrains bachiques
Quand ils auront tari leurs chiques :
J'aurai des sursauts stomachiques
Si mon coeur triste est ravalé !
Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô coeur volé ?
Ca ne veut pas rien dire. - Répondez-moi :
M. Deverrière, pour A. R.
Deuxième lettre du Voyant (à A. P. Demeny)
Bonjour de coeur,
Ar. Rimbaud.
Charleville, 15 mai 1871
J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. je commence de suite par un psaume d'actualité :
(CHANT DE GUERRE PARISIEN)
-Voici de la prose sur l'avenir de la poésie-
Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, Vie harmonieuse. - De la
Grèce au mouvement romantique, moyen âge, - il y a des lettres, des versificateurs.
D'Ennius à Theroldus, de Theroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu,
avachissement et gloire d'innombrables générations idiotes : Racine est le pur, le fort,
le grand. - On eût soufflé sur ses rimes, brouillé ses hémistiches, que le Divin Sot
serait aujourd'hui aussi ignoré que le premier venu auteur d'Origines. - Après Racine,
le jeu moisit. Il a duré deux mille ans !
Ni plaisanterie, ni paradoxe. La raison m'inspire plus de certitudes sur le sujet
que n'aurait jamais eu de colères un Jeune-France. Du reste, libre aux nouveaux
d'exécrer les ancêtres : on est chez soi et l'on a le temps.
On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé ? Les Critiques ! ! Les
Romantiques, qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre,
c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur?
Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa
faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde,
je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les
profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène.
Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse,
nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont
accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs !
En Grèce, ai-je dit, vers et lyres, rythment l'Action. Après, musique et rimes
sont jeux, délassements. L'étude de ce passé charme les curieux : plusieurs
s'éjouissent à renouveler ces antiquités : -c'est pour eux. L'intelligence universelle
a toujours jeté ses idées naturellement ; les hommes ramassaient une partie de ces
fruits du cerveau ; on agissait par, on en écrivait des livres : telle allait la marche,
l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la
plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète,
cet homme n'a jamais existé !
La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance,
entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait,
il la doit cultiver : cela semble simple : en tout cerveau s'accomplit un développement
naturel ; tant d'égoïstes se proclament auteurs ; il en est bien d'autres qui
s'attribuent leur progrès intellectuel ! - Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse :
à l'instar des comprachicos, quoi ! Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des
verrues sur le visage.
Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.
Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous
les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie ; il cherche lui-même, il
épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture
où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous
le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! - Car il
arrive à l'inconnu ! - Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun ! Il
arrive à l'inconnu ; et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses
visions, il les a vues ! Qu'il crêve dans son bondissement par les choses inouïes et
innommables : viendront d'autres horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons
où l'autre s'est affaissé!
- La suite à six minutes. -
Ici j'intercale un second psaume hors du texte : veuillez tendre une oreille
complaisante, et tout le monde sera charmé. - J'ai l'archet en main, je commence :
(MES PETITES AMOUREUSES)
Voilà. Et remarquez bien que, si je ne craignais de vous faire débourser plus
de 60 c. de port, -moi pauvre effaré qui, depuis sept mois, n'ai pas tenu un seul rond de
bronze ! - je vous livrerais encore mes Amants de Paris, cent hexamètres, Monsieur, et ma
Mort de Paris, deux cents hexamètres !
- Je reprends :
Donc le poète est vraiment voleur de feu.
Il est chargé de l'humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper,
écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si
c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue ;
- Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra ! Il
faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire, de
quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de
l'alphabet, qui pourraient vite ruer dans la folie ! -
Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs,
de la pensée accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité
d'inconnu s'éveillant en son temps, dans l'âme universelle : il donnerait plus que la
formule de sa pensée, que l'annotation de sa marche au Progrès ! Énormité devenant
norme absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès !
Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez. -Toujours pleins du Nombre et de
l'Harmonie, les poèmes seront faits pour rester. -Au fond, ce serait encore un peu la
Poésie grecque.
L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne
rythmera plus l'action ; elle sera en avant. Ces poètes seront ! Quand sera brisé
l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme -jusqu'ici
abominable, - lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme
trouvera de l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? - Elle trouvera
des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous
les comprendrons.
En attendant, demandons aux poètes du nouveau, - idées et formes. Tous les
habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande : -ce n'est pas cela !
Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte: la
culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents: locomotives abandonnées, mais
brûlantes, que prennent quelque temps les rails. -Lamartine est quelquefois voyant, mais
étranglé par la forme vieille. - Hugo, trop cabochard, a bien du VU dans les derniers
volumes : Les Misérables sont un vrai poème. J'ai Les Châtiments sous main : Stella
donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de Lamennais, de
Jehovahs et de colonnes, vieilles énormités crevées.
Musset est quatorze fois exécrable pour nous, générations douloureuses et prises
de visions, - que sa paresse d'ange a insultées ! Ô ! les contes et les proverbes
fadasses ! ô les Nuits ! ô Rolla ! ô Namouna ! ô la Coupe! tout est français,
c'est-à-dire haïssable au suprême degré; français, pas parisien ! Encore une
œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean La Fontaine,
commenté par M. Taine ! Printanier, l'esprit de Musset ! Charmant, son amour ! En voilà,
de la peinture à l'émail, de la poésie solide ! On savourera longtemps la poésie
française, mais en France. Tout garçon épicier est en mesure de débobiner une
apostrophe Rollaque; tout séminariste emporte les cinq cents rimes dans le secret d'un
carnet. A quinze ans, ces élans de passion mettent les jeunes en rut ; à seize ans, ils
se contentent déjà de les réciter avec cœur; à dix-huit ans, à dix-sept même,
tout collégien qui a le moyen fait le Rolla, écrit un Rolla ! Quelques-uns en meurent
peut-être encore. Musset n'a rien su faire. Il y avait des visions derrière la gaze des
rideaux : il a fermé les yeux. Français, panadis, traîné de l'estaminet au pupitre du
collège, le beau mort est mort, et, désormais, ne nous donnons même plus la peine de le
réveiller par nos abominations !
Les seconds romantiques sont très voyants : Théophile Gautier, Leconte de Lisle,
Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose
que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des
poètes, un vrai Dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste ; et la forme si
vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnu réclament des formes nouvelles.
Rompus aux formes vieilles : parmi les innocents, A. Renaud, - a fait son Rolla, -
L. Grandet, - a fait son Rolla ; - les gaulois et les Musset, G. Lafenestre, Coran, C. L.
Popelin, Soulary, L. Salles. Les écoliers, Marc, Aicard, Theuriet ; les morts et les
imbéciles, Autran, Barbier, L. Pichat, Lemoyne, les Deschamps, les Des Essarts ; les
journalistes, L. Cladel, Robert Luzarches, X. de Ricard ; les fantaisistes, C. Mendès ;
les bohèmes ; les femmes ; les talents, Léon Dierx et Sully-Prudhomme, Coppée; -la
nouvelle école, dite parnassienne, a deux voyants, Albert Mérat et Paul Verlaine, un
vrai poète. Voilà. Ainsi je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant
pieux.
(ACCROUPISSEMENTS)
Vous seriez exécrable de ne pas répondre : vite, car dans huit jours je serai
à Paris, peut-être.
Au revoir.
A. RIMBAUD.
(28/02/2006)
Visite impromptue dans les terres de l’Allier, chères à René Fallet et c’est l’occasion où jamais d’interroger sa prose abondante en Carnets de jeunesse, entretiens et témoignages. Et s’il a tenu à faire inscrire " écrivain bourbonnais " sur sa tombe, cette réduction n’est pas celle d’un terroir, elle est un simple rapprochement de la langue avec la terre, elle transcende la littérature dans ce quel a de plus noble et de plus prosaïque, les mots. Rien d’étonnant à un mélange des genres : voici l’écrivain bourbonnais, donc, tour à tour hâbleur, frondeur ou tendre et passionné dans quelques notes d’écriture…
" La littérature se pratique tantôt avec les mains, tantôt avec les pieds. On dit aussi : embrasser la littérature ou faire des pieds et des mains… "
" Un romancier n’a pas à connaître le pourquoi des êtres. Il suffit qu’il sache décrire le comment. Je ne veux rien savoir de la cause de l’ennui, mais je sais très bien décrire l’attitude d’un type qui s’ennuie : il est devant une fenêtre et il tambourine sur la vitre avec ses doigts. "
" Je tiens à ces livres sur le vélo et la pèche. J’aurais été très ennuyé de ne pas trouver d’éditeur pour les publier. Car je vis tout littérairement : même le vélo et la pèche. Les boules aussi. Mais c’est techniquement assez ardu. On peut être lyrique sur l’ascension d’un col à vélo ou sur la prise d’une truite. Mais c’est plus difficile de l’être sur un carreau à la pétanque. "
" La littérature est devenue pour moi un métier. Et je ne trouve pas cela honteux. Je suis même fier d’avoir acquis un métier…/… Comme un artisan qui a de l’expérience, j’aime bien travailler à l’instinct et, à partir d’une petite idée de trois lignes, pouvoir dire : " tu vas en faire deux cent cinquante pages. " Mais l’acquisition du métier ne donne pas pour autant des certitudes définitives. C’est Ernest Hemingway qui disait : " à chaque fois je remets mon titre en jeu. " Là est l’angoisse de cette profession : est-ce que je vais pouvoir écrire un nouveau livre ? "
" Il est sûr que les meilleurs livres d’un écrivain sont toujours ceux qu’il rêve, jamais ceux qu’il écrit. C’est un aspect de mon métier qui me chagrine : le passage de l’histoire imaginée à l’histoire écrite a un côté assez dérisoire. Comment un petit bureau, une chaise, un cahier une main et un stylo pourraient-ils vraiment matérialiser un rêve ? "
" Un livre est un enfant qu’on lâche dans la nature. Ce n’est qu’après qu’on voit s’il boite ou s’il a fière allure. Mais après, c’est toujours trop tard pour y changer quelque chose. Les mères de famille préfèrent toujours " leur petit dernier "… jusqu’à l’arrivée du suivant ! Les écrivains, c’est une banalité, sont toujours plus attirés par leur dernier livre qui vient de paraître ou par celui qu’il sont en train d’écrire. "
" En fait peu importe la manière, ce qui compte pour moi c’est ce qui est dit dans un livre et le plaisir que ça me procure. J’ai horreur des écrivains neutres, des petits vieux bien propres de l’écriture même quand ils sont jeunes. "
" Je n’ai jamais mis de frontière entre la vie et la littérature. J’ai toujours pensé qu’il me fallait vivre le plus littérairement possible. "- à consulter, la page Fallet.
(08/02/2006)
- Clermont-Ferrand, côté cour : l’espace est rectangulaire, comporte deux
allées et un terre-plein planté de quelques buissons faméliques. La cour longe deux
bâtiments et semble relier par inadvertance l’IUP Métiers du livre et l’IUP
Métiers du tourisme. Cette proximité assure un mélange heureux : professeurs et
étudiants croisent leurs préoccupations et leurs matières et s’ouvrent par
conséquent des perspectives : comment lit-on avec un regard de visiteur ou de
touriste ? Pourquoi ne pas penser que ce sont aussi les écrivains qui fabriquent
l’attraction d’un endroit ? Il y a intérêt de part et d’autre :
sortir des régionalismes d’écriture (y compris pour Paris que je réduis
volontairement dans son orgueil démesuré à vouloir résumer la production livresque du
pays entier dans l’arrondissement du 6ème) et évacuer les solutions toutes
fabriquées de parcs et autres attractions touristiques parfaitement insipides et
identiques. Mais cette réflexion strictement personnelle n’avait rien à voir avec
ma venue en cet endroit universitaire. Invité par Françoise, j’avais prévu de me
commettre à parler de Littérature du travail. La préparation de ce sujet peu abordé
jusqu’à présent m’a permis de situer Central à l’intérieur de
cette vision, mais aussi de le relier à ma préoccupation actuelle d’écriture (voir
le canevas de cette conférence : Tentative de restitution de
la littérature du travail de 1980 à nos jours, en France). A peine la vision de la
cour, fuite du temps, cours encouru, temps court qui s’échappe, quelques questions,
quelques échanges et c’est déjà fini : j’aurais aimé que cela dure plus
longtemps.
L’après-midi, interview à Radio Campus. Reçu très professionnellement par Marie Berne, gentiment cerné par les questions d’Anne-Laure et Mathilde : heure agréable qui précédait la séance d’écriture du soir dans laquelle je retrouvais Anne Laure et Mathilde, les autres participants habituels de l’atelier mais aussi Françoise et Elisabeth qui, pour l’occasion, avaient rejoint avec un plaisir évident les bancs des étudiants (voir canevas de cette intervention : petite fabrique de temps, rubrique Ateliers d’écriture). A retenir de ces deux heures, la lecture des poèmes de Beckett, la nuit neuve au-delà des rideaux usés couleur or, le silence pendant l’écriture, petits moments magiques et comment on froisse ensemble ce temps suspendu pour entrer en chaque texte et recevoir les mots comme des cadeaux. Un peu plus loin, des chats devaient errer dans la cour entre les deux IUP, des étoiles allumaient le Puy de Dôme, encore le dernier reflux le galet mort le demi-tour puis les pas vers les vieilles lumières.
(01/02/2006)
" Dole, journal de bord " :
l’atelier d’écriture du CHS du Jura n’est pas encore commencé mais les
deux visites préalables m’ont déjà donné l’occasion d’une réflexion
abondante et ce titre m’est venu spontanément. Oui, c’est bien un journal de
bord. J’ai envie de garder trace de ce qui va me tenir (me tient déjà)
jusqu’en octobre sur un drôle de navire. Ces notes prises, au jour le jour, au fur
et à mesure, sans concertation ni vision d’ensemble, se voudront (se veulent déjà)
un reflet de l’instant, un billet d’humeur, un étonnement pour qui ne connaît
pas la structure d’un hôpital psychiatrique, pour qui veut se perdre avec moi dans
les coursives de ce navire de pierre centenaire et gigantesque. C’est cette position
marine de passager particulier que je veux retracer au fil de l’eau. C’est
l’éloignement du téléspectateur que je recherche, aux visions et idées toutes
faites, puisqu’on ne connaît de ces établissements que quelques images
télévisuelles, reportages qui insistent toujours sur les mêmes réflexes sociaux qui
nous animent, l’exclusion, la différence, la nécessaire solidarité en vertu de la
déformation démocratique à travers le prisme des médias. Drôle de navire de pierre
que ces hôpitaux là, étonnants matelots et passagers particuliers… Témoignage ?
Oui, pas seulement : c’est d’écriture qu’il s’agit puisque je sais,
je devine qu’à l’issue des dix mois que je vais passer ici, que mon langage
n’en sortira pas indemne mais, comment dire, griffé par cette expérience. Il ne
peut en être autrement. Dans les faits, c’est un atelier d’écriture que je
vais animer, à raison de 2h, 2 fois par mois jusqu’à préparer la manifestation de
Lire en fête 2006. On imagine aisément que les séances proposées, vécues, auront une
autre répercussion que les expériences déjà pratiquées dans le milieu lycéen : la
logique de l’enseignement, la nécessaire formation, l’accumulation de
connaissances n’ont pas cours ici. Le langage, dans cette distance éducative, dans
cet apprentissage individuel et social, sera ramené, on peut le supposer, à son point de
départ, à la simple communication entre une personne et une autre, ou un groupe. Et
c’est justement parce que la simple communication est complexe, qu’elle peut
aboutir à l’incompréhension, à l’inadaptation sociale, au nécessaire
embarquement à bord d’un navire psychiatrique. Voici l’état d’esprit, les
interrogations qui me semblent préexister avant même d’avoir commencé. Voici le
semblant de certitude, la richesse de ce que je pressens découvrir, qui me motive et me
fera accomplir tous les quinze jours 440 km aller et retour. Ces notes donc, au fur et à
mesure, à laisser, comment dire dans leur authenticité, sans aucun maquillage, dans
"l’état de l’apparition", comme disait Marguerite Duras.
(25/01/2006)
- La première fois, c’était il y a deux ans, peut-être trois. Le hasard nous avait
réunis dans un restaurant à Paris. Enfin, le hasard... qui avait pris la forme
d’une invitation lancée à chacun. Nous étions quatre à fréquenter le même
éditeur, nous avions pris plaisir à nous retrouver, à parler de nos projets, de nos
vies, d’un peu de tout. J’avais l’impression de sentir nos livres en ombres
bienveillantes derrière nous, ceux que nous connaissions les uns des autres, les
édités, plus ou moins proches dans le temps, jamais très lointains. J’avais
l’impression que nous en parlions comme d’une progéniture, étonnés de se
découvrir des lieux communs, des cheminements semblables comme des parents qui discutent
à la sortie de l’école et qui ne se lassent jamais de ces sujets de conversation.
Un beau déjeuner : nous étions ressortis heureux de ce moment en nous promettant de
fixer ce rendez-vous chaque année.
L’année d’après, nous étions ainsi trois à nous revoir, l’un d’entre nous avait (a toujours) un agenda très chargé et nous devinions que l’exception passée ne se représenterait pas de sitôt. Le repas fut encore des plus agréables. Il y avait toujours un livre en suspens, à venir, ou récemment édité par l’un d’entre nous et nous en discutions avec passion. Je n’étais pourtant pas trop dans mon assiette à cette époque. J’aime cette répartie : de mémoire, elle est dans Paris au mois d’août de René Fallet : le héros (ou plutôt anti-héros) Henri Plantin est amoureux d’une touriste anglaise Patricia. " Il n’a pas l’air dans son assiette " disent ses amis, remarquant sa distance. Et son confident Godaille de répondre : " je dirais même que c’est une assiette anglaise… ". Je garde pourtant un souvenir très précis du restaurant et le hasard a voulu d’ailleurs que j’y retourne très peu de temps après et à la même table.
Cette année, nous renouvelons cette occasion très prochainement et au même restaurant. Manquera toujours le quatrième, c’est bien dommage ! J’attends avec impatience ces retrouvailles. D’abord pour prendre une revanche sur l’humeur précédente : oui, merci, en ce moment, ça va très bien… Une revanche, c'est bien celà : peut-être avoir l’impression de repartir du même endroit, comme si on pouvait changer le cours du temps ou quelque chose de similaire. Je savoure par avance ce petit instant annuel où, à la traditionnelle question " bon et toi, que deviens-tu ? ", j’aurais l’impression d’avoir énormément de choses à raconter, toutes aussi passionnantes les unes que les autres : les ateliers, le livre en route, les cours de fac, le temps libre du moment, la joie, tout quoi… Et peut être que je ne dirai pas grand chose, éludant la question par une réponse évasive ne laissant aucun doute sur le bonheur actuel. De plus, mes deux interlocuteurs ont la chance de sortir un livre en cette période : ce sera doux de les écouter. De même qu’il sera heureux de repartir après à travers les rues de Paname, d’aller visiter une expo, le soir, prendre le Métro pour s’inviter chez sa propre fille, étudiante depuis peu, puis repartir le lendemain, l’ordinateur posé sur les genoux dans le train et l’écriture, l’écriture, l’écriture…
Au départ, je voulais faire une note d’écriture un peu aigrelette : j’avais découvert que mes deux amis étaient chacun publiés en poche et j’en avais conçu immédiatement une jalousie enfantine, une sorte de caprice : et pourquoi ne suis-je pas présent dans les rééditions en petits formats économiques ? (remarquez, vu les chiffres de mes ventes…). Puis, en écrivant ces lignes, je ne veux retenir que l’attente, le " ravissement ", comme dirait Duras, de cette excellente journée qui s’annonce. Pas de jalousie, pas la moindre anxiété, juste partager leur joie de leurs publications qui s’annoncent. Et pourtant, je n’ai jamais été aussi éloigné du monde éditorial proprement dit : non pas que rien ne se profile à l’horizon, mais plutôt que ce que j’écris en ce moment me semble tellement loin, tellement en dehors, l’impression d’avoir largué les amarres et d’être tout aux délices instantanés de la navigation, il m’indiffère de savoir si j’apercevrai la terre de l’éditeur un jour, mon rafiot n’est peut-être même pas éditable. Et cette situation, chose nouvelle pour moi, n’est pas source d’angoisse, mais, osons le dire, de sérénité : j’ai pris la mer, j’écris…
(18/01/2006)
Il y a le machin rarement nommé ou alors à contre cœur, une réticence
pourquoi ? Pourtant le truc est à prendre à bras le corps cette année, sans
équivoque et le désigner : un livre, CV roman.
Un livre, mon livre, ce sera ton année, CV roman, l’année de l’éveil.
Et ceci sans aucune ambition, juste pour l’analogie avec le titre de Charles Juliet.
Je me fous de savoir si tu peux t’envoler, convenir, concéder, correspondre, être
éditable. Te prendre à bras le corps, mon roman, est impossible : tu n’es pas
un livre, pas un récit, pas un ouvrage de feuilles aériennes que l’on ouvre et qui
s’égrène comme des ailes de papillon. Tu es trop grand, trop encombrant, tu es un
morceau de plomb, tu vogues épais comme un paquebot.
Blaise Cendrars se rendait au Brésil à bord d’un navire marchand. Tu es ce cargo
renflé, charpenté. J’ai cloué des planches, tu es solide. Non, tu n’es pas
rapide : depuis que j’ai pris la mer, j’ai le temps, je pourrais te faire
avancer à toute vapeur, un sillage de mots derrière toi, une fumée de phrases sortant
de la cheminée mais tu es lourd, chargé de toutes mes peurs, rempli de tous mes livres,
embarqué de toute une vie matérielle. J’aime à te contempler, assis en tailleur
sur le triangle du pont avant, te regardant plonger dans la cuve d’outremer, clignant
des yeux sous un soleil de plomb ou guettant l’improbable Croix du Sud à travers un
crachin de nuit. Je t’écoute craquer de toutes tes plaques de tôles : ainsi je
suis heureux, immobile, ce devrait suffire ? Mais ce sont des sensations
éphémères, il te faut avancer et tu le fais bien lentement, jamais tout seul. Il faut
s’escrimer, descendre dans la salle des machines, mettre les mains dans le cambouis.
J’ai toujours su réparer des moteurs, à seize ans j’ai travaillé dans une
station service, j’aimais l’odeur de l’essence, tu ne me prends pas au
dépourvu. Ton nom de cargo voguant, CV roman, est accroché à la proue,
juste au-dessus de l’ancre déjà corrodée. J’aimerais en sous-titre un port
d’attache qui me ferait rêver : Baltimore, Calao, Aden, Providence…
Déjà, je sens venir le jour où tombera ton nom, CV roman, à force de
craquements, de cahots hésitants, de changement de cap, de rouille de sel, rejoignant le
large remous du sillage, y perdant sa substance, détaché, rejoignant les profondeurs du
grand bleu. Je n’ai qu’un seul souhait : qu’il emporte avec le titre,
le genre : il m’importe peu si je réussis à tenir le cap, à écrire un texte
au long court sans le souci de sa variété, de son espèce, sans l’idée même de
réussir cette traversée. Les livres ont un sortilège : finir en carré de feuilles
dans des géométries de collections, sous les barreaux des rayons de littérature
française avec roman ou récit ou recueil écrit sur leurs couvertures. J’espère
t’achever, mon bouquin, et quel sera ton port m’est indifférent.
Qu’il soit le plus proche, une baie abritée, un dédale compliqué, un mouillage en
Terre de Haut ou le cliquetis de la chaîne qui dépose l’ancre au fond de la baie
d’Along et ce sera un soulagement.
Le sort des livres est de se diluer au dehors, une fois à quai et de laisser juste aux
lèvres de leur auteur un goût de sel connu d’eux seul. Pardonnez-moi à
l’avance cette distance, lecteurs, amis, famille : de temps en temps un regard
délavé, une absence, on me parlera mais je serai loin, retourné dans mes nuits de
veille au bastingage du pont avant.
Mais ce n’est pas le propos, il faut te nommer : CV roman. Te terminer.
J’ai écrit aujourd'hui à l’éditeur qui attend, je sais qu’il patientera
encore, il nous reste du chemin, mon écriture et moi : assez rêvassé, retour à la
cabine, salle des cartes et sextant. Il est temps de faire un point à la première
étoile de la nuit.
(11/01/2006)
Bon, pour faire comme tout le monde, traditionnellement donc, ou plutôt parce que la
magie des chiffres et du hasard change d’année afin de suivre une inclinaison bien
oulipienne, l’époque est au bilan et diverses perspectives pour l’année à
venir. Saut acrobatique d’un cheval à l’autre sur la piste du cirque du monde
ou pieds empesantis dans la neige et cou dans une écharpe de laine dans l’attentisme
actualitaire, chacun, dubitatif ou entreprenant, selon son humeur, va se tourner vers
2006. Et chacun va essayer de deviner l’avenir à travers la paire de jumelles des
zéros du milieu.
2005, pour moi, fut tranché en deux, un premier semestre de doutes, remises en question,
écriture, questions existentielles, mais, qui l’eut cru (surtout pas moi à cette
époque), un deuxième semestre tout aussi basculé à l’inverse, avec un
extraordinaire retour du moral, de la forme, de l’optimisme, de l’écriture et,
osons le dire, du bonheur… Ainsi, quand on relit les premières notes de
l’année précédente, maintenant en archives, histoire de tourner une page,
l’individualité et les questions personnelles qui me taraudaient, laissaient peu de
place à autrui. Individualité peut-être encore visible dans le texte Langres s’use, sorte de feuilleton printemps/été
de Feuilles de Route, qui, comme le catalogue de la Redoute, annonçait des jours
meilleurs, convalescence en tenue plus légère, idées noires laissées derrière, et
finalement, l’écriture, l’écriture, l’écriture, qu’elle soit
difficile ou bousculée aura été autant présente que les années précédentes, une
habitude, une incrustation, un tatouage. Pour autant l’individu, petit nombril au
début de l'année, a étendu son horizon finalement. L’année nouvelle ne sera
pas narcissique : elle sera politique ou ne sera pas, ceci pour plagier la tournure
de phrase d’André Breton.
Politique ?
Oui, il ne faut pas être grand devin pour cela : en 2005, nous avons redécouvert la
politique sous toutes ses manifestations, souvent brutales : clivage de l’Europe,
banlieues, plans sociaux, réflexes sécuritaires à outrance…
Restons mesurés.
Oui encore, car les présidentielles seront en 2007 et c’est bien cette année que
les différentes tendances vont affirmer leurs résolutions et peaufiner leurs ambitions.
Ce n’est pas Pierre Bourdieu qui m’aurait contredit, ayant publié La misère
du monde (voir en Notes de lecture) dans une période similaire… Restons
vigilants.
Oui enfin, car, en dernier lieu, c’est bien nous qui la faisons, cette
politique : retour à l’individu… certes, mais préoccupé des autres…
Restons généreux.
Et finalement, le livre en cours pour moi est tout à fait dans cette optique : ni un
genre littéraire, ni une profession de foi, ni un cri, ni une réflexion, ni dire tout
haut ce que les autres pensent tout bas (on en connaît qui reprennent ce qui fut un temps
le slogan d’un parti xénophobe…), bref, juste " décrire "
dans le sens d’introduire une condition : des-écrire, soit désapprendre ou
écrire des… Ainsi " raconter " et ajouter un préfixe au conte,
un ra-ccroc, une petite ancre pour s’accrocher et ne retenir que le réel.
(04/01/2006)